Ma main à couper...
 Le quartet du saxophoniste Emile Parisien a récemment livré une magnifique bataille musicale sous la forme d’un détonant Spezial Snack, un disque publié sur le label Act Music. Un objet artistique singulier, arythmique, nourri de perturbations sonores et pour tout dire, terriblement addictif. Le boulimique Parisien nous étonne, une fois encore, et c’est tant mieux !
Le quartet du saxophoniste Emile Parisien a récemment livré une magnifique bataille musicale sous la forme d’un détonant Spezial Snack, un disque publié sur le label Act Music. Un objet artistique singulier, arythmique, nourri de perturbations sonores et pour tout dire, terriblement addictif. Le boulimique Parisien nous étonne, une fois encore, et c’est tant mieux !
Mais pour commencer, j’aimerais inviter quiconque serait un peu dérouté par la méchante pochette (Act nous ayant depuis longtemps habitués à ce genre de facéties visuelles, ce ne sont pas les Cheerleaders de Pierrick Pédron qui me diront le contraire), celle-là même qui exhibe une main sans nul doute arrachée au bras d’un Mickey infirme par la force des choses, la souris Disneyenne étant probablement la victime expiatoire d’un grignoteur fou, allez savoir... Tel est peut-être d’ailleurs le sens à donner au titre du disque, celui d’un casse-croûte ou d’un goûter un peu particulier, pour ne pas dire sanguinolent. Non, ne pas s’éloigner à la vue d’un poignet ensanglanté, mais plutôt accepter de se laisser emporter par une musique qui n’aura de cesse de réserver ses propres surprises et de dérouler son tapis sans équivalent.
Tout commence par un drôle de bruit sur lequel vient s’épandre lentement le saxophone soprano d’Emile Parisien. Comme des billes qui rouleraient au fond d’un bol, soutenues par la tension de cordes à l’identité mystérieuse. J’ai mené l’enquête auprès du coupable, Sylvain Darrifourcq, qui m’a fourni la clé de l’énigme : « Ce sont des sextoys que je mets dans mes objets, coupelles, bols etc. Tout ça, couplé avec des ebows sur la cithare pour les sons tenus très purs ». Ah oui, carrément, des sextoys ! Serait-on en présence d’un McCarthy de la musique ? Je précise par ailleurs aux béotiens comme moi que les ebows sont des appareils électroniques qui émettent un champ magnétique provoquant le mouvement des cordes, afin d’obtenir un son voisin de celui produit par un archet. On comprend d’emblée que le terrain de jeu n’est pas banal, d’autant que le quartet va s’ingénier, tout au long d’un « Potofen » introductif et goûteux, à faire monter la tension avec une maîtrise confondante. Batterie puissante, contrebasse d’Ivan Gélugne comme dressée droite dans ses bottes, pendant que le piano de Julien Touéry laisse résonner ses notes graves, non sans une pointe d’emphase. Les quatre s’y entendent à instaurer un climat sui generis... Il y a quelque chose d’implacable dans leur propos, qui ne laisse pas de choix : on en est ou on n’est pas ! J’en suis, évidemment...
D’autant que le dérèglement est en marche et que rien n’arrêtera cette mécanique palpitante : on peut compter sur le fantasque Darrifourcq pour n’être jamais le dernier à perturber celle qui s’était enclenchée peu de temps auparavant. Son « Haricot Guide » a de faux airs d’un blues monkien dont la course serait à chaque instant entravée par des obstacles brandis ici ou là par les autres instruments, amoureux malicieux des syncopes à répétition. Pas facile de savoir où tout ce petit monde a décidé d’aller, le chemin est semé d’embûches, mais le groupe avance, sûr de son fait. La folie gagne le quartet et le batteur s’en donne à fûts joie, crépitant comme une mitraillette aux mains d'un combattant halluciné. C’est totalement jouissif. A intervalles réguliers, la contrebasse vient calmer le jeu, histoire peut-être de rassurer les potentiels suiveurs et de les inviter à garder quelques forces pour la suite. Emile Parisien, de son côté, a l’élégance qui le caractérise depuis belle lurette : il ne s’affiche pas en leader dominateur. Non, il est l’un des quatre, ni plus, ni moins, d’une présence à la fois concise et tranchante. Un sacré monsieur...
Le « Mazout » de Julien Touéry offre pour commencer des couleurs plus impressionnistes, aux allures de fugue, même si les percussions dansent une fois encore leur ballet malin. Saxophone soprano et piano chantent à l’unisson, tandis que la contrebasse s’est parée d’un archet. A nouveau, les instruments paraissent se chercher, comme dans un jeu de colin-maillard ; la mélodie s’est évanouie, cédant la place aux constructions du hasard nées de l’imagination (jamais exempte d’humour, il est important de le préciser) du quatuor. Au beau milieu de cette nouvelle quête un peu folle, le mystère s’installe, froid et métallique, la musique est devenue presque noire. L’achet lance de lancinants appels, les baguettes font crisser les cymbales, ils ouvrent la voie à un piano d’abord interrogateur, avant un final hypnotique et martelé qui n’est pas sans évoquer les noirceurs boschiennes du groupe Présent (les spécialistes me comprendront, eux qui entendront peut-être comme moi les échos inconscients d’une « Promenade au fond d’un canal »).
« Les flics de la police » : un pléonasme pied de nez pour une nouvelle course poursuite ludique où chaque instrument semble d’abord vouloir égarer l’autre... Une fausse piste, en fait, un trompe l’oreille qui est en réalité le prélude à une construction puissante, sous l’impulsion de la batterie et de la contrebasse, sur laquelle Emile Parisien saura s’épanouir en toute confiance. La netteté de son phrasé, la précision de ses attaques ne sont certainement pas étrangères à la sécurité de fer offerte par ses compagnons. C’est du grand art, l’imagination est au pouvoir. Cette musique ne ressemble à aucune autre.
Une conclusion plus calme s’impose et c’est Ivan Gélugne, cette fois, qui fourbit un « François » laissant entendre le saxophone ténor d’Emile Parisien (ce qui n’est pas si courant, après tout). Mais dans ce Spezial Snack, l’idée du calme est toute relative : seul le rythme a ralenti, pas la frénésie picturale du quartet. Le piano exprime sa curiosité à coups de notes aiguës, la batterie ne peut réfréner ses ardeurs et martèle son impatience, une fois de plus, une dernière fois... tandis que le saxophone redevient soprano pour un ultime emballement.
Fin du voyage. On a beau chercher, regarder derrière soi ou même de côté, il faut bien se rendre à l’évidence : ce disque sans équivalent est une nouvelle pépite, une pierre précieuse, tout juste polie au sens où ses audaces la rendent heureusement irrévérencieuse. Le quartet d’Emile Parisien, un gamin de 32 ans, est âgé d’une petite dizaine d’années et sème sur son chemin de sacrés cailloux : Au revoir porc-épic (Laborie - 2006), Original Pimpant (Laborie - 2009), Chien Guêpe (Laborie - 2012) et aujourd’hui Spezial Snack. Sa musique, aussi singulière et intrigante que les titres de ses disques, n’a certainement pas fini de nous sidérer.
Tout comme l’invisible et partiellement manchot dénommé Mickey, j’en mettrais ma main à couper !
Emile Parisien Quartet : Spezial Snack
Emile Parisien (saxophones soprano et ténor), Julien Touéry (piano, piano préparé), Ivan Gélugne (contrebasse), Sylvain Darrifourcq (batterie, percussions, cithare).
Act Music – ACT 9575-2
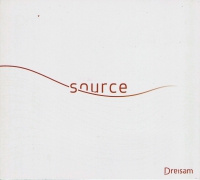 Je n’irai pas par quatre chemins. Voilà, tout simplement, un de mes coups de cœur de cette deuxième partie de l’année ! Un disque gracieux et raffiné, dont les inspirations sont à la fois celles du jazz, de la musique néo-impressionniste du début du XXe siècle mais aussi, on le comprendra vite, de la musique brésilienne ; une belle Source dont j’ignorais tout jusqu’au jour où une main bienveillante eut la bonne idée de le déposer dans ma boîte aux lettres, à la fin du mois d’août. Une surprise d’autant plus agréable que son conditionnement sous la forme d’un objet à la finition soignée, presque taquin, fait surgir comme par malice un CD lutin au moment où le digipack s’ouvre sous vos yeux. Je n’oublie pas – j’y tiens beaucoup – de saluer les efforts accomplis par les musiciens pour donner à leurs albums une identité véritable, celle qui donne envie de se procurer le disque en tant qu’objet pour le conserver ensuite comme on le ferait d’un beau livre. Je ne prétends pas qu’il sera possible d’endiguer le raz-de-marée de la dématérialisation numérique forcenée et d’atténuer les effets secondaires de ces étranges algorithmes de nature fleurpellerinesque qui engendrent un zapping musical forcené, sans âme et sans consistance chez tant de nos contemporains et se présentent comme un défi malsain, celui de la crétinerie massive badigeonnée aux excès de l'ultralibéralisme, lancé à l’imagination créative, mais il me plaît de croire que des actions résistantes comme celles-ci, aussi modestes soient-elles, constituent une réponse élégante qu’il faut encourager à tout prix. Dont acte...
Je n’irai pas par quatre chemins. Voilà, tout simplement, un de mes coups de cœur de cette deuxième partie de l’année ! Un disque gracieux et raffiné, dont les inspirations sont à la fois celles du jazz, de la musique néo-impressionniste du début du XXe siècle mais aussi, on le comprendra vite, de la musique brésilienne ; une belle Source dont j’ignorais tout jusqu’au jour où une main bienveillante eut la bonne idée de le déposer dans ma boîte aux lettres, à la fin du mois d’août. Une surprise d’autant plus agréable que son conditionnement sous la forme d’un objet à la finition soignée, presque taquin, fait surgir comme par malice un CD lutin au moment où le digipack s’ouvre sous vos yeux. Je n’oublie pas – j’y tiens beaucoup – de saluer les efforts accomplis par les musiciens pour donner à leurs albums une identité véritable, celle qui donne envie de se procurer le disque en tant qu’objet pour le conserver ensuite comme on le ferait d’un beau livre. Je ne prétends pas qu’il sera possible d’endiguer le raz-de-marée de la dématérialisation numérique forcenée et d’atténuer les effets secondaires de ces étranges algorithmes de nature fleurpellerinesque qui engendrent un zapping musical forcené, sans âme et sans consistance chez tant de nos contemporains et se présentent comme un défi malsain, celui de la crétinerie massive badigeonnée aux excès de l'ultralibéralisme, lancé à l’imagination créative, mais il me plaît de croire que des actions résistantes comme celles-ci, aussi modestes soient-elles, constituent une réponse élégante qu’il faut encourager à tout prix. Dont acte... Sur le pont d’Avignon... on n’y danse pas seulement ! On y joue, aussi, et on y savoure le plaisir des musiques vivantes et libres. Ce n’est pas l’
Sur le pont d’Avignon... on n’y danse pas seulement ! On y joue, aussi, et on y savoure le plaisir des musiques vivantes et libres. Ce n’est pas l’ Vu de loin, vous pourriez penser que je vais parler cuisine. Mais il est bien question de musique, et pas n’importe laquelle. Celle dont on peut se régaler, pour ne pas dire apprécier toutes les saveurs (j’en ai fini avec la métaphore culinaire), sur le nouveau disque du contrebassiste Gilles Naturel, musicien précieux qui n’a à son actif qu’une poignée d’albums qu’on peut compter sur les doigts d’une seule main (Naturel en1998, Belleville en 2007 et Contrapunctic Jazz Band en 2011) ; un sideman (attention : rien de péjoratif dans ce mot, bien au contraire, car Gilles Naturel est de ceux dont on recherche la présence pour son groove têtu et le sentiment de sécurité qu’il inspire à ses partenaires de scène. Comme disait je ne sais plus qui, le sideman est le musicien indispensable qui se tient à vos côtés, qui vous soutient) auquel le saxophoniste Benny Golson rend d’ailleurs un hommage appuyé sur le texte du livret de Contrapunctic Jazz Band Act 2, publié sur le label Space Time Records.
Vu de loin, vous pourriez penser que je vais parler cuisine. Mais il est bien question de musique, et pas n’importe laquelle. Celle dont on peut se régaler, pour ne pas dire apprécier toutes les saveurs (j’en ai fini avec la métaphore culinaire), sur le nouveau disque du contrebassiste Gilles Naturel, musicien précieux qui n’a à son actif qu’une poignée d’albums qu’on peut compter sur les doigts d’une seule main (Naturel en1998, Belleville en 2007 et Contrapunctic Jazz Band en 2011) ; un sideman (attention : rien de péjoratif dans ce mot, bien au contraire, car Gilles Naturel est de ceux dont on recherche la présence pour son groove têtu et le sentiment de sécurité qu’il inspire à ses partenaires de scène. Comme disait je ne sais plus qui, le sideman est le musicien indispensable qui se tient à vos côtés, qui vous soutient) auquel le saxophoniste Benny Golson rend d’ailleurs un hommage appuyé sur le texte du livret de Contrapunctic Jazz Band Act 2, publié sur le label Space Time Records.  Si je m’étais croisé il y a une vingt-cinquaine d’années, je ne me serais jamais cru si, dans une conversation avec moi-même, je m’étais expliqué tout le bonheur ressenti à l’écoute de musiques improvisées. Costumé dans mes certitudes étroites de trentenaire pas loin de devenir quadra, mon double jeunot m’aurait ri au nez, j’en suis certain. Bien sûr, je savais le pouvoir de quelques sorciers de l’exercice : à cette époque, j’avais englouti bon nombre d’heures épicoltraniennes, et tout particulièrement celles de l’été 1966 au Japon et j’avais abordé, parmi d’autres, les rivages du free jazz d’Ornette Coleman ; je n’ignorais pas non plus qu’au temps de mon adolescence, au début des années 70, certains de mes groupes fétiches – tel The Grateful Dead – m’avaient démontré qu’on peut sortir du cadre restreint d’une « chanson » de trois ou quatre minutes pour pratiquer les chemins de traverse sans douleur (pour moi en tous cas).
Si je m’étais croisé il y a une vingt-cinquaine d’années, je ne me serais jamais cru si, dans une conversation avec moi-même, je m’étais expliqué tout le bonheur ressenti à l’écoute de musiques improvisées. Costumé dans mes certitudes étroites de trentenaire pas loin de devenir quadra, mon double jeunot m’aurait ri au nez, j’en suis certain. Bien sûr, je savais le pouvoir de quelques sorciers de l’exercice : à cette époque, j’avais englouti bon nombre d’heures épicoltraniennes, et tout particulièrement celles de l’été 1966 au Japon et j’avais abordé, parmi d’autres, les rivages du free jazz d’Ornette Coleman ; je n’ignorais pas non plus qu’au temps de mon adolescence, au début des années 70, certains de mes groupes fétiches – tel The Grateful Dead – m’avaient démontré qu’on peut sortir du cadre restreint d’une « chanson » de trois ou quatre minutes pour pratiquer les chemins de traverse sans douleur (pour moi en tous cas).  Régis Huby nous gâte encore : son label
Régis Huby nous gâte encore : son label 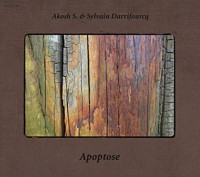 Avant de conclure, puisqu’il est question ici de duo saxophone batterie, je ne peux passer sous silence un nouvel épisode de cette association qui peut aussi s'avérer d’une âpreté abrasive : Sylvain Darrifourcq et Akosh S. avancent leurs pions sur le terrain beaucoup plus brûlant d’un corps à corps violent et livrent une musique fiévreuse, presque hantée, avec Apoptose. Difficile en l’occurrence de parler de conversation tant l’échange entre les deux vous emporte loin, là où l’angoisse peut aussi vous étreindre : portée par une énergie qui est celle de la vie elle-même (reportons-nous pour mieux comprendre à la définition du mot apoptose, qui signifie la mort cellulaire, phénomène bénéfique parce que nécessaire à la survie), cette musique souvent sombre, hurlée quand il le faut, est d’une puissance ravageuse qui vous prend aux tripes pour ne plus vous lâcher. Ce n’est certes pas l’album qu’on conseillera pour une fin de banquet, mais celui-ci est assurément un choc émotionnel qu’il faut vivre pour le croire. Et comprendre que l’être humain reste un mystère, même si le voyage n’est pas de tout repos.
Avant de conclure, puisqu’il est question ici de duo saxophone batterie, je ne peux passer sous silence un nouvel épisode de cette association qui peut aussi s'avérer d’une âpreté abrasive : Sylvain Darrifourcq et Akosh S. avancent leurs pions sur le terrain beaucoup plus brûlant d’un corps à corps violent et livrent une musique fiévreuse, presque hantée, avec Apoptose. Difficile en l’occurrence de parler de conversation tant l’échange entre les deux vous emporte loin, là où l’angoisse peut aussi vous étreindre : portée par une énergie qui est celle de la vie elle-même (reportons-nous pour mieux comprendre à la définition du mot apoptose, qui signifie la mort cellulaire, phénomène bénéfique parce que nécessaire à la survie), cette musique souvent sombre, hurlée quand il le faut, est d’une puissance ravageuse qui vous prend aux tripes pour ne plus vous lâcher. Ce n’est certes pas l’album qu’on conseillera pour une fin de banquet, mais celui-ci est assurément un choc émotionnel qu’il faut vivre pour le croire. Et comprendre que l’être humain reste un mystère, même si le voyage n’est pas de tout repos.  S'il n'avait eu la mauvaise idée de quitter prématurément notre monde le 17 juillet 1967, John Coltrane fêterait aujourd'hui son quatre-vingt-huitième anniversaire. Impossible de ne pas avoir une pensée émue pour le saxophoniste chaque 23 septembre, tant sa musique continue de vivre en nous, presque cinquante ans après sa mort.
S'il n'avait eu la mauvaise idée de quitter prématurément notre monde le 17 juillet 1967, John Coltrane fêterait aujourd'hui son quatre-vingt-huitième anniversaire. Impossible de ne pas avoir une pensée émue pour le saxophoniste chaque 23 septembre, tant sa musique continue de vivre en nous, presque cinquante ans après sa mort. 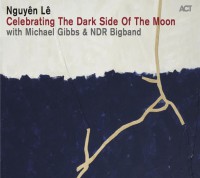 Au mois de juillet dernier, le guitariste
Au mois de juillet dernier, le guitariste 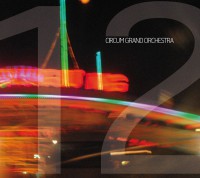 Avez-vous déjà reçu un disque en pleine figure ? C’est le genre d’incident dont je suis victime de temps en temps et qui – contrairement à ce qu’on pourrait imaginer – vous plonge dans un état de bien-être dont on n’aimerait ne plus sortir. Et ça fait de vous quelqu’un de partageur parce qu’aussitôt, on est gagné par le besoin de le faire savoir au plus grand nombre : « Faut que je leur dise ! Faut que je leur dise ! »
Avez-vous déjà reçu un disque en pleine figure ? C’est le genre d’incident dont je suis victime de temps en temps et qui – contrairement à ce qu’on pourrait imaginer – vous plonge dans un état de bien-être dont on n’aimerait ne plus sortir. Et ça fait de vous quelqu’un de partageur parce qu’aussitôt, on est gagné par le besoin de le faire savoir au plus grand nombre : « Faut que je leur dise ! Faut que je leur dise ! »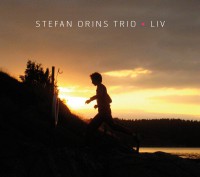 Ce disque est une fête, tour à tour rageuse ou joyeuse, polyrythmique et animée de forces qui semblent inépuisables. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, j’aimerais ici ajouter qu’un trio (inclus dans le Circum Grand Orchestra), celui du pianiste Stefan Orins, a publié au même moment un enchanteur Liv. Bien sûr, ne serait-ce que pour des raisons d’ordre quantitatif, l’esthétique de ce troisième album d’une formation née à la fin des années 90 est sensiblement différente celle de 12 ; mais l’exigence est la même, la quête de l’espace aussi intense. L’une de ses maximes est la suivante : « Plus les racines sont profondes, plus luxuriantes sont les branches ».
Ce disque est une fête, tour à tour rageuse ou joyeuse, polyrythmique et animée de forces qui semblent inépuisables. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, j’aimerais ici ajouter qu’un trio (inclus dans le Circum Grand Orchestra), celui du pianiste Stefan Orins, a publié au même moment un enchanteur Liv. Bien sûr, ne serait-ce que pour des raisons d’ordre quantitatif, l’esthétique de ce troisième album d’une formation née à la fin des années 90 est sensiblement différente celle de 12 ; mais l’exigence est la même, la quête de l’espace aussi intense. L’une de ses maximes est la suivante : « Plus les racines sont profondes, plus luxuriantes sont les branches ».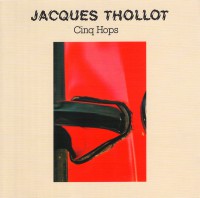 Ce texte aurait pu trouver sa place dans ma page
Ce texte aurait pu trouver sa place dans ma page  Je le disais récemment dans
Je le disais récemment dans  J'ai reçu depuis quelque temps plusieurs témoignages de confiance et des remerciements assez émouvants qui m'interpellent vraiment. Au début de la semaine, un vieux pote amoureux de musique, travailleur acharné du partage de ses passions, me demandait l'autorisation de reproduire l'une des chroniques de mon blog dans son magazine. Hier, je recevais un message d'un pianiste qui tenait à me faire part du plaisir pris à la lecture d'un de mes textes ; il voulait m'en remercier, un comble alors que de mon point de vue, c'est plutôt moi le débiteur. Au cours de l'hiver, un autre musicien m'a sollicité, un peu dans l'urgence, pour que j'écrive le rédactionnel devant figurer sur la pochette de son nouveau disque. Un exercice de style dont j'ai essayé de m'acquitter au mieux, avec les moyens du bord, ceux de l’écriveur que je suis et dont je dispose tant bien que mal. On m'a aussi demandé si j'acceptais qu'un extrait d'une de mes chroniques figure sur le catalogue de la prochaine saison d'une salle de concert. Je travaille actuellement sur la rédaction du dossier de presse associé à la parution du disque d'un jeune guitariste. Tout récemment enfin, mon complice Jacky Joannès a relevé le défi - c’est moi qui l’ai lancé, je le reconnais - d'une prochaine exposition unissant textes et photographies ; celle-ci, programmée au mois d'octobre 2016, sera principalement consacrée aux saxophonistes et aux clarinettistes et devrait s'appeler « La part des anches ». J'ai même prévu de réaliser le petit livre de l'exposition avant qu'elle ne commence, afin de le proposer lors du vernissage.
J'ai reçu depuis quelque temps plusieurs témoignages de confiance et des remerciements assez émouvants qui m'interpellent vraiment. Au début de la semaine, un vieux pote amoureux de musique, travailleur acharné du partage de ses passions, me demandait l'autorisation de reproduire l'une des chroniques de mon blog dans son magazine. Hier, je recevais un message d'un pianiste qui tenait à me faire part du plaisir pris à la lecture d'un de mes textes ; il voulait m'en remercier, un comble alors que de mon point de vue, c'est plutôt moi le débiteur. Au cours de l'hiver, un autre musicien m'a sollicité, un peu dans l'urgence, pour que j'écrive le rédactionnel devant figurer sur la pochette de son nouveau disque. Un exercice de style dont j'ai essayé de m'acquitter au mieux, avec les moyens du bord, ceux de l’écriveur que je suis et dont je dispose tant bien que mal. On m'a aussi demandé si j'acceptais qu'un extrait d'une de mes chroniques figure sur le catalogue de la prochaine saison d'une salle de concert. Je travaille actuellement sur la rédaction du dossier de presse associé à la parution du disque d'un jeune guitariste. Tout récemment enfin, mon complice Jacky Joannès a relevé le défi - c’est moi qui l’ai lancé, je le reconnais - d'une prochaine exposition unissant textes et photographies ; celle-ci, programmée au mois d'octobre 2016, sera principalement consacrée aux saxophonistes et aux clarinettistes et devrait s'appeler « La part des anches ». J'ai même prévu de réaliser le petit livre de l'exposition avant qu'elle ne commence, afin de le proposer lors du vernissage. Il est des jours tristes. Aujourd'hui en est un. Alors, sans se mettre la tête dans le sable, il n'est jamais inutile de se dire que l'homme est aussi capable du meilleur. Je vous propose la lecture d'un texte, que j'avais publié il y a quelques années et que vous trouverez dans une édition légèrement remaniée. Il ne résoudra aucun de nos problèmes, mais il pourra vous apporter un peu de lumière. Il parle d'un disque de John Coltrane enregistré au mois d'octobre 1960 : My Favorite Things.
Il est des jours tristes. Aujourd'hui en est un. Alors, sans se mettre la tête dans le sable, il n'est jamais inutile de se dire que l'homme est aussi capable du meilleur. Je vous propose la lecture d'un texte, que j'avais publié il y a quelques années et que vous trouverez dans une édition légèrement remaniée. Il ne résoudra aucun de nos problèmes, mais il pourra vous apporter un peu de lumière. Il parle d'un disque de John Coltrane enregistré au mois d'octobre 1960 : My Favorite Things. Je prends les devants et présente par avance mes excuses au saxophoniste
Je prends les devants et présente par avance mes excuses au saxophoniste  Difficile de traduire en mots l’émotion qui me gagne à l’écoute de Belle Époque, le disque en duo enregistré par
Difficile de traduire en mots l’émotion qui me gagne à l’écoute de Belle Époque, le disque en duo enregistré par  Dans la famille "Je voudrais un disque qui soit à la fois plein d'un jazz libre et créatif mais aussi un bel objet qu'on a envie de toucher, de garder près soi", je demande Les Passagers du Delta de
Dans la famille "Je voudrais un disque qui soit à la fois plein d'un jazz libre et créatif mais aussi un bel objet qu'on a envie de toucher, de garder près soi", je demande Les Passagers du Delta de  De deux choses l’une : ou vous connaissez depuis belle lurette l’étendue du talent de
De deux choses l’une : ou vous connaissez depuis belle lurette l’étendue du talent de 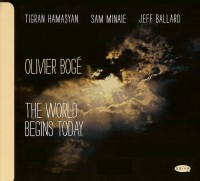 Comme bon nombre de ses confrères saxophonistes,
Comme bon nombre de ses confrères saxophonistes,  J’ai raconté voici plus de deux ans l’histoire d’
J’ai raconté voici plus de deux ans l’histoire d’

