Premières méditations
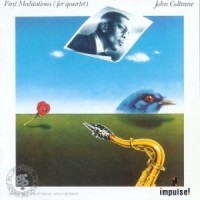 17 juillet 1967... Quarante-six ans déjà et pourtant, la puissance préservée d’un souffle qui semble ne jamais devoir s’éteindre. John Coltrane est parti, laissant derrière lui une somme de musique si monumentale, si habitée qu’il faudra probablement plusieurs vies pour commencer à penser qu’on a pu en délimiter les premiers contours. Comme si sa musique se régénérait à chaque écoute. Quarante-six ans d’absence et pourtant, une présence intacte, chargée d’une spiritualité à nulle autre pareille et, pour nous tous, une proximité des émotions comme si cette musique venait seulement d’éclore. Coltrane était un musicien total, en ce sens qu’on ne lui connaissait que la musique comme seule véritable compagne. Le saxophoniste parlait peu mais vivait son art comme il respirait, il ne savait rien faire d’autre. Mort à quarante ans, laissant derrière lui un sillage magnifié et météorique, tant la fulgurance de son ascension continue d’impressionner malgré le temps qui a passé.
17 juillet 1967... Quarante-six ans déjà et pourtant, la puissance préservée d’un souffle qui semble ne jamais devoir s’éteindre. John Coltrane est parti, laissant derrière lui une somme de musique si monumentale, si habitée qu’il faudra probablement plusieurs vies pour commencer à penser qu’on a pu en délimiter les premiers contours. Comme si sa musique se régénérait à chaque écoute. Quarante-six ans d’absence et pourtant, une présence intacte, chargée d’une spiritualité à nulle autre pareille et, pour nous tous, une proximité des émotions comme si cette musique venait seulement d’éclore. Coltrane était un musicien total, en ce sens qu’on ne lui connaissait que la musique comme seule véritable compagne. Le saxophoniste parlait peu mais vivait son art comme il respirait, il ne savait rien faire d’autre. Mort à quarante ans, laissant derrière lui un sillage magnifié et météorique, tant la fulgurance de son ascension continue d’impressionner malgré le temps qui a passé.
Je reviens sans cesse à John Coltrane, il y a tellement à faire avec lui ! Compagnon de route de Miles Davis ou Thelonius Monk, leader s’affirmant comme un astre dès la fin des années 50, pour tout chambouler jusqu’à sa mort, Coltrane occupe (pour toujours) une place unique dans le jazz, parce qu’il fait partie de ces très rares musiciens qui ont fait « bouger les lignes » et ont consacré toutes leurs forces à défricher de nouveaux espaces. Chaque note de Coltrane était une offrande (« Offering »).
Lorsque je m’assois devant ma discothèque et que je parcours d'un coup d'œil panoramique la discographie de John Coltrane, méticuleusement classée par ordre chronologique, je mesure encore mieux la dimension surnaturelle d’un travail accompli en une petite quinzaine d’années. Trouver le bon disque au bon moment, rien de plus facile tant la progression du musicien offre une diversité de chants qui, pour être nourris de la même passion (au sens presque christique du terme), revêtent des couleurs bien différentes. Comparez par exemple, juste pour apprécier le spectre de sa création : Giant Steps (1959), Olé (1961), Live at the Village Vanguard (1961), John Coltrane & Johnny Hartmann (1963), A Love Supreme (1964), Meditations (1965), Live in Japan (1966) et Insterstellar Regions (1967). Voyez comment, temporairement de retour dans le quintet de Miles Davis, il illumine d’un chorus extra-terrestre « Someday My Prince Will Come » ou comment, l’année précédente, il avait tourneboulé le public de l’Olympia par ses interventions surnaturelles (cf. « All Of Me »). Le même musicien, le même homme mais une élévation probablement amplifiée par la maladie qui l’emportera et qui, sans nul doute, a dû le pousser dans les derniers retranchements de son expression, parce que le temps lui était compté. Au point que son année 1965, dont j’avais retracé les grandes dates, fut d’une fécondité inégalée.
1965, justement... peuplée de pépites et d’instants d’une incroyable richesse, dont les First Meditations constituent à la fois un sommet et un chant du cygne. Ce disque qu’une fois de plus j’ai longuement écouté aujourd’hui pour me nourrir de ses beautés et rendre hommage au disparu. Probablement celui qui fréquente le plus souvent le haut de ma pile coltranienne. Inépuisable...
Sommet parce que ses cinq mouvements : Love – Compassion – Joy – Consequences - Serenity, enregistrés le 2 septembre 1965 (soit une semaine seulement après la session en studio qui avait donné naissance à un autre chef d’œuvre, Sun Ship) sont une sorte de somptueux précipité de la spiritualité exacerbée du saxophoniste. Quarante minutes hantées, brûlantes dont la radicalité laisse toute sa place au chant profond de John Coltrane, qui devient cri quand l’exaltation n’est plus suffisante. Il y a dans cette musique quelque chose qui ressemble à l’éternité.
Chant du cygne parce qu’il s’agit-là du dernier enregistrement réalisé par le quartet que le saxophoniste avait constitué en 1961 et qui demeure, aujourd’hui encore, un jalon dans l’histoire du jazz. McCoy Tyner (piano), Elvin Jones (batterie) et Jimmy Garrison (contrebasse) auront formé un quatuor unique d’explorateurs dont les interactions continuent de forcer l’admiration. Ces quatre-là se retrouveront encore en studio en octobre et novembre pour l’enregistrement de Om, Kulu Se Mama, Selflessness et Meditations (dont le répertoire recoupe en grande partie celui de First Meditations) mais dans le cadre de formations élargies. Puis viendra la séparation et la dernière phase de la trop courte vie de Coltrane, avec d’autres compagnons de route.
17 juillet 2013... First Meditations pour se souvenir, pour puiser des forces à la source d’un torrent musical comme on n’en compte qu’un seul dans une génération. John Coltrane est vivant !
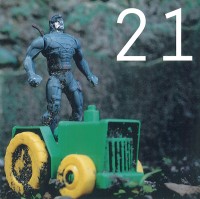 Tant pis, je ne résiste pas à publier ici un petit texte que j’ai écrit la semaine dernière en quatrième vitesse après avoir reçu 21, un album enregistré par un trio composé de
Tant pis, je ne résiste pas à publier ici un petit texte que j’ai écrit la semaine dernière en quatrième vitesse après avoir reçu 21, un album enregistré par un trio composé de 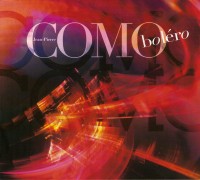 Finalement, maintenant que vous m’y faites penser, je crois bien que c’est ça : je dois être un grand sentimental. Il suffit de peu de choses pour m’embarquer et faire de moi un allié inconditionnel. Une musique qui emporte, une mélodie aérienne qui touche au cœur, une pulsion tout en souplesse et, hop, voilà le travail : je fonds comme neige au soleil, je rends les armes et je dis « Encore ! ». Peut-être bien aussi que le reliquat de sang italien qui coule dans mes veines n’est pas étranger à une sensibilité que d’aucuns pourront juger naïvement béate mais je n’en ai cure, après tout. Quoi de plus attachant en effet qu’un chant humble et sincère, porté par la grâce des émotions, nimbé de notes qui, prises une par une, sont exemptes de la moindre vulgarité ?
Finalement, maintenant que vous m’y faites penser, je crois bien que c’est ça : je dois être un grand sentimental. Il suffit de peu de choses pour m’embarquer et faire de moi un allié inconditionnel. Une musique qui emporte, une mélodie aérienne qui touche au cœur, une pulsion tout en souplesse et, hop, voilà le travail : je fonds comme neige au soleil, je rends les armes et je dis « Encore ! ». Peut-être bien aussi que le reliquat de sang italien qui coule dans mes veines n’est pas étranger à une sensibilité que d’aucuns pourront juger naïvement béate mais je n’en ai cure, après tout. Quoi de plus attachant en effet qu’un chant humble et sincère, porté par la grâce des émotions, nimbé de notes qui, prises une par une, sont exemptes de la moindre vulgarité ? J’ignore si mes plongées régulières dans A la recherche du temps perdu peuvent avoir une influence sur mes propres perceptions de la vie, de la mémoire (volontaire ou non) et plus généralement du monde qui m’entoure et, comme tout un chacun, au centre duquel j’imagine parfois me trouver alors que je n’en suis qu’une poussière. Mais au moment où je m’extrais de sa lecture pour quelques jours, au moment où les informations m’écrasent de leur violence et leur incroyable accumulation de désespoirs récités en litanie pseudo-journalistique, me reviennent en mémoire des instants à la fois douloureux et puissants. Stand By...
J’ignore si mes plongées régulières dans A la recherche du temps perdu peuvent avoir une influence sur mes propres perceptions de la vie, de la mémoire (volontaire ou non) et plus généralement du monde qui m’entoure et, comme tout un chacun, au centre duquel j’imagine parfois me trouver alors que je n’en suis qu’une poussière. Mais au moment où je m’extrais de sa lecture pour quelques jours, au moment où les informations m’écrasent de leur violence et leur incroyable accumulation de désespoirs récités en litanie pseudo-journalistique, me reviennent en mémoire des instants à la fois douloureux et puissants. Stand By...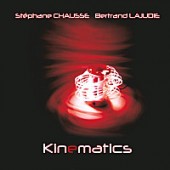 Il y a quelque chose d’assez malicieux dans ce disque signé Stéphane Chausse etBertrand Lajudie. Alors qu’un survol rapide de ses très nombreux invités pourrait laisser croire à la rencontre un peu vaine, à la coloration jazz rock d’un all starsassemblé pour faire genre, une écoute plus curieuse, plus attentive, amène à la conclusion opposée : si Kinematics bénéficie d’une production très soignée - en d’autres termes, si le contenant est plutôt luxueux et le son magistral - sa musique conserve une étonnante fraîcheur quand on sait avec quel soin maniaque elle a été élaborée et combien elle est ancrée dans des histoires d’amitiés. Le breuvage est donc savoureux.
Il y a quelque chose d’assez malicieux dans ce disque signé Stéphane Chausse etBertrand Lajudie. Alors qu’un survol rapide de ses très nombreux invités pourrait laisser croire à la rencontre un peu vaine, à la coloration jazz rock d’un all starsassemblé pour faire genre, une écoute plus curieuse, plus attentive, amène à la conclusion opposée : si Kinematics bénéficie d’une production très soignée - en d’autres termes, si le contenant est plutôt luxueux et le son magistral - sa musique conserve une étonnante fraîcheur quand on sait avec quel soin maniaque elle a été élaborée et combien elle est ancrée dans des histoires d’amitiés. Le breuvage est donc savoureux.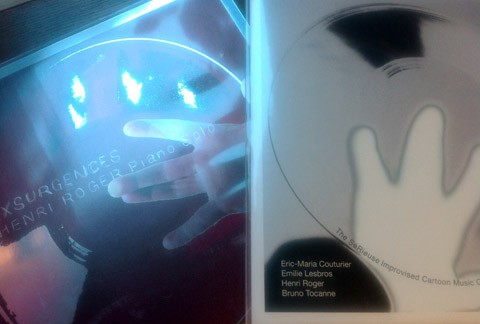
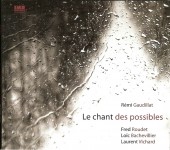 Le chant des possibles est un objet de séduction, sur la forme comme sur le fond : d’abord le titre, qui dit l’essentiel en quatre mots, l’amour de la mélodie et le pari d’une liberté comme une porte ouverte sur un imaginaire poétique ; puis les titres des compositions, évocateurs de leurs climats nomades : « Jeux d’ombres », « Envolées », « L’armée des poètes », « Le voyage » ou bien encore « Lune triste ». Et enfin un visuel dont l’élégance liquide et suggestive semble nous indiquer le chemin clair-obscur sur lequel nous emmènera la musique. Un soin discret est apporté à l’objet-disque, qui devient au fil du temps la patte du label
Le chant des possibles est un objet de séduction, sur la forme comme sur le fond : d’abord le titre, qui dit l’essentiel en quatre mots, l’amour de la mélodie et le pari d’une liberté comme une porte ouverte sur un imaginaire poétique ; puis les titres des compositions, évocateurs de leurs climats nomades : « Jeux d’ombres », « Envolées », « L’armée des poètes », « Le voyage » ou bien encore « Lune triste ». Et enfin un visuel dont l’élégance liquide et suggestive semble nous indiquer le chemin clair-obscur sur lequel nous emmènera la musique. Un soin discret est apporté à l’objet-disque, qui devient au fil du temps la patte du label 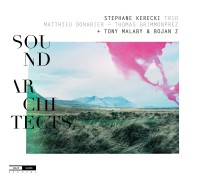 Time will tell, comme disent nos voisins d’outre-Manche. Il paraît en effet que le temps produit ses effets, évacuant par le soupirail des heures qui passent le superflu ou l’insignifiant. Seul resterait ce qui est habité de l’essentiel. Il en va en musique comme en toutes choses et je ne serai pas le dernier à admettre qu’un enthousiasme trop appuyé – celui de l’instant auquel je succombe non sans joie, parce que mon approche de la soixantaine n’est pas encore parvenue à éradiquer chez moi des élans quasi adolescents – peut faire suite à une prise de distance, voire un oubli partiel ou total. Comme si s’opérait en nous une distinction entre un plaisir non intrinsèquement durable (mais plaisir tout de même, ce qui, convenons-en, est loin d’être méprisable et peut même s’avérer indispensable au quotidien) et la nécessité, plus indicible, de se confronter à une énergie d’essence vitale qui soulève chez nous une force allant bien au-delà du poil qui se hérisse durant quelques secondes. Et qu'on ne compte pas sur moi pour établir une liste des disques dont j’ai apprécié la forte séduction qu’ils ont pu opérer le temps de quelques écoutes et qui, les semaines passant, sont venus se glisser quelque part, à l’écart, dans les recoins de ma mémoire où ils sont parfois enfouis pour toujours, avec peu d’espoir de remonter un jour à la surface. Heureusement d’ailleurs ! Mais j’avoue qu’il m'arrive régulièrement de consulter la liste des albums que j’ai écoutés au cours des douze ou dix-huit derniers mois et de me rendre compte que bon nombre d’entre eux ne résonnent plus beaucoup en moi et que, dans le pire des cas, je n’en garde pas le moindre souvenir. Sont-ils dispensables pour autant ? Pas forcément, sauf que la hiérarchie qui s'établit de fait est bien là, plutôt impitoyable. Peut-être aussi que nos capacités à maintenir vives en nous des œuvres puissantes sont limitées et que, par obligation physique, nous nous trouvons confrontés à la nécessité d'une sélection. En d’autres termes, notre mémoire vive n’étant pas extensible à l’infini, elle doit opérer son propre ménage interne pour préserver la qualité de son fonctionnement. Je laisse ce questionnement aux experts... dont je ne suis pas.
Time will tell, comme disent nos voisins d’outre-Manche. Il paraît en effet que le temps produit ses effets, évacuant par le soupirail des heures qui passent le superflu ou l’insignifiant. Seul resterait ce qui est habité de l’essentiel. Il en va en musique comme en toutes choses et je ne serai pas le dernier à admettre qu’un enthousiasme trop appuyé – celui de l’instant auquel je succombe non sans joie, parce que mon approche de la soixantaine n’est pas encore parvenue à éradiquer chez moi des élans quasi adolescents – peut faire suite à une prise de distance, voire un oubli partiel ou total. Comme si s’opérait en nous une distinction entre un plaisir non intrinsèquement durable (mais plaisir tout de même, ce qui, convenons-en, est loin d’être méprisable et peut même s’avérer indispensable au quotidien) et la nécessité, plus indicible, de se confronter à une énergie d’essence vitale qui soulève chez nous une force allant bien au-delà du poil qui se hérisse durant quelques secondes. Et qu'on ne compte pas sur moi pour établir une liste des disques dont j’ai apprécié la forte séduction qu’ils ont pu opérer le temps de quelques écoutes et qui, les semaines passant, sont venus se glisser quelque part, à l’écart, dans les recoins de ma mémoire où ils sont parfois enfouis pour toujours, avec peu d’espoir de remonter un jour à la surface. Heureusement d’ailleurs ! Mais j’avoue qu’il m'arrive régulièrement de consulter la liste des albums que j’ai écoutés au cours des douze ou dix-huit derniers mois et de me rendre compte que bon nombre d’entre eux ne résonnent plus beaucoup en moi et que, dans le pire des cas, je n’en garde pas le moindre souvenir. Sont-ils dispensables pour autant ? Pas forcément, sauf que la hiérarchie qui s'établit de fait est bien là, plutôt impitoyable. Peut-être aussi que nos capacités à maintenir vives en nous des œuvres puissantes sont limitées et que, par obligation physique, nous nous trouvons confrontés à la nécessité d'une sélection. En d’autres termes, notre mémoire vive n’étant pas extensible à l’infini, elle doit opérer son propre ménage interne pour préserver la qualité de son fonctionnement. Je laisse ce questionnement aux experts... dont je ne suis pas.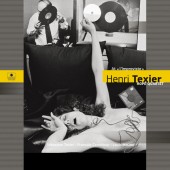 Mine de rien, voilà plus de vingt-cinq ans qu’Henri Texier n’avait pas proposé d’enregistrement en public. Pour être précis, on notera que At « L’Improviste »n’est d’ailleurs que le deuxième de sa longue et prolifique carrière : le précédent remonte à 1986, lorsque son quartet avait invité le saxophoniste Joe Lovano dans le cadre du festival de jazz d’Amiens. S’en était suivi l’album Paris-Batignolles, déjà chez
Mine de rien, voilà plus de vingt-cinq ans qu’Henri Texier n’avait pas proposé d’enregistrement en public. Pour être précis, on notera que At « L’Improviste »n’est d’ailleurs que le deuxième de sa longue et prolifique carrière : le précédent remonte à 1986, lorsque son quartet avait invité le saxophoniste Joe Lovano dans le cadre du festival de jazz d’Amiens. S’en était suivi l’album Paris-Batignolles, déjà chez 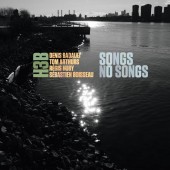 Ce disque subjugue dès la première écoute. Mais pourquoi s’en étonner ? Il y a un peu plus de deux ans, en mars 2011, Citizen Jazz saluait la parution de la première production, sobrement intitulée
Ce disque subjugue dès la première écoute. Mais pourquoi s’en étonner ? Il y a un peu plus de deux ans, en mars 2011, Citizen Jazz saluait la parution de la première production, sobrement intitulée 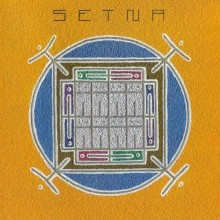 Les premiers accords de piano de Guérison, second disque en trois grands mouvements du groupe rouennais
Les premiers accords de piano de Guérison, second disque en trois grands mouvements du groupe rouennais 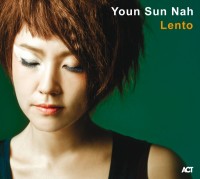 C'est au mois d'octobre 2010 que j'ai découvert sur scène la musique de
C'est au mois d'octobre 2010 que j'ai découvert sur scène la musique de 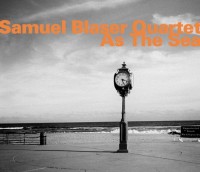 Samuel Blaser
Samuel Blaser As The Sea, prenons les paris, s'impose d'emblée, non seulement comme un des albums les plus ébouriffants de l'année, par sa fière liberté, son besoin existentiel d'exploration et la communion de ses acteurs, mais aussi comme une nouvelle preuve de la force fédératrice de Samuel Blaser. Autour de lui, trois musiciens accomplis trouvent une réponse à cette question que beaucoup de leurs pairs, par humilité, se posent souvent : peut-on ajouter quelque chose à ce qui a déjà été dit depuis des décennies en musique ? La réponse semble être oui à l'écoute de l'album parce qu'on se dit qu'il restera toujours une matière vivante à (re)modeler, un moment d'émerveillement à susciter, ceux-ci n'appartenant pas à un univers fini, mais au contraire en expansion. Un espace dont il ne tient qu'à chacun d'entre nous d'ouvrir les portes pour se laisser emporter...
As The Sea, prenons les paris, s'impose d'emblée, non seulement comme un des albums les plus ébouriffants de l'année, par sa fière liberté, son besoin existentiel d'exploration et la communion de ses acteurs, mais aussi comme une nouvelle preuve de la force fédératrice de Samuel Blaser. Autour de lui, trois musiciens accomplis trouvent une réponse à cette question que beaucoup de leurs pairs, par humilité, se posent souvent : peut-on ajouter quelque chose à ce qui a déjà été dit depuis des décennies en musique ? La réponse semble être oui à l'écoute de l'album parce qu'on se dit qu'il restera toujours une matière vivante à (re)modeler, un moment d'émerveillement à susciter, ceux-ci n'appartenant pas à un univers fini, mais au contraire en expansion. Un espace dont il ne tient qu'à chacun d'entre nous d'ouvrir les portes pour se laisser emporter...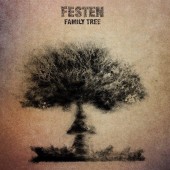 Blasphème ! Une fois encore,
Blasphème ! Une fois encore, 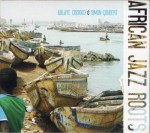 Je vais reprendre des forces en écoutant les African Jazz Roots de Simon Goubert et Ablaye Sissoko, au risque d’aggraver mon cas aux yeux de ces marcheurs sans amour au cœur qui vont certainement trouver beaucoup à redire à cet autre mariage qu’ils jugeront contre nature, celui de musiques occidentales et africaines. Tant pis pour eux s’ils sont aveugles au point de ne pas être saisis d’admiration devant la beauté de cette union et le métissage sublimé qui en résulte. Ils se consoleront avec la médiatocratie frelatée de la nightclubbeuse rancie qui leur sert temporairement d’égérie et les ridiculise aux yeux de tous. On a les génies qu’on mérite, après tout…
Je vais reprendre des forces en écoutant les African Jazz Roots de Simon Goubert et Ablaye Sissoko, au risque d’aggraver mon cas aux yeux de ces marcheurs sans amour au cœur qui vont certainement trouver beaucoup à redire à cet autre mariage qu’ils jugeront contre nature, celui de musiques occidentales et africaines. Tant pis pour eux s’ils sont aveugles au point de ne pas être saisis d’admiration devant la beauté de cette union et le métissage sublimé qui en résulte. Ils se consoleront avec la médiatocratie frelatée de la nightclubbeuse rancie qui leur sert temporairement d’égérie et les ridiculise aux yeux de tous. On a les génies qu’on mérite, après tout…
 Les huit années qui séparent Song To A Seagull (1968) et Hejira (1976) auront été celles d'une certaine forme de magie pour la chanteuse canadienne
Les huit années qui séparent Song To A Seagull (1968) et Hejira (1976) auront été celles d'une certaine forme de magie pour la chanteuse canadienne  Dans notre grande série "Je ne suis pas forcément là où m'on attend et ça n'est pas pour me déplaire", voici quelques lignes consacrées à un disque publié au mois d'octobre par
Dans notre grande série "Je ne suis pas forcément là où m'on attend et ça n'est pas pour me déplaire", voici quelques lignes consacrées à un disque publié au mois d'octobre par 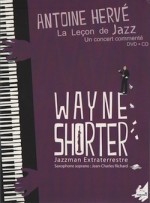 Je ne voudrais pas laisser filer ce dernier jour de l’année sans avoir adressé un petit clin d’œil à un pianiste dont la récente production discographique (mais pas seulement, on le comprendra assez vite) aura été la source d’un vrai ravissement. Et j'aimerais par avance présenter mes excuses à
Je ne voudrais pas laisser filer ce dernier jour de l’année sans avoir adressé un petit clin d’œil à un pianiste dont la récente production discographique (mais pas seulement, on le comprendra assez vite) aura été la source d’un vrai ravissement. Et j'aimerais par avance présenter mes excuses à  Dans sa leçon consacrée à Wayne Shorter, Antoine Hervé nous explique que le saxophoniste est un créateur d’univers, un artiste qui veut inventer sa propre musique. Eh bien, je me demande si ce désir d’innovation n’est pas le sang qui coule dans les veines du PMT QuarKtet qui vient de publier un disque absolument ébouriffant. Il figure d’ailleurs dans la (longue) liste de mes disques de l’année 2012 et je dois confesser que si j’avais eu le courage de compresser mon Top 22 en un Top 5, l’album ferait partie de cette quinte ultime. Sans la moindre hésitation, je lui décerne un « Coup de Maître », amplement mérité tant son écoute répétée depuis deux mois est une source inépuisable de plaisirs multipliés qui jamais ne se départissent de leur mystère originel. Aux côtés d’Antoine Hervé, on retrouve l’exaltant Jean-Charles Richard au saxophone (qui a lui-même reçu un « Maître d’Honneur »), Philippe Garcia à la batterie (tiens, voilà qui me ramène pas mal d’années en arrière et au Collectif Mu, trop vite disparu) et Véronique Wilmart à... l’acousmatique. Acousmatique, kesako ? Tiens, il faudrait que le professeur Hervé nous explique tout cela, il ferait ça beaucoup mieux que moi. Disons, pour faire très court, qu’il s’agit ici de recourir à des matières sonores qui vont être comme sculptées et transformées, dans une démarche qui est celle de
Dans sa leçon consacrée à Wayne Shorter, Antoine Hervé nous explique que le saxophoniste est un créateur d’univers, un artiste qui veut inventer sa propre musique. Eh bien, je me demande si ce désir d’innovation n’est pas le sang qui coule dans les veines du PMT QuarKtet qui vient de publier un disque absolument ébouriffant. Il figure d’ailleurs dans la (longue) liste de mes disques de l’année 2012 et je dois confesser que si j’avais eu le courage de compresser mon Top 22 en un Top 5, l’album ferait partie de cette quinte ultime. Sans la moindre hésitation, je lui décerne un « Coup de Maître », amplement mérité tant son écoute répétée depuis deux mois est une source inépuisable de plaisirs multipliés qui jamais ne se départissent de leur mystère originel. Aux côtés d’Antoine Hervé, on retrouve l’exaltant Jean-Charles Richard au saxophone (qui a lui-même reçu un « Maître d’Honneur »), Philippe Garcia à la batterie (tiens, voilà qui me ramène pas mal d’années en arrière et au Collectif Mu, trop vite disparu) et Véronique Wilmart à... l’acousmatique. Acousmatique, kesako ? Tiens, il faudrait que le professeur Hervé nous explique tout cela, il ferait ça beaucoup mieux que moi. Disons, pour faire très court, qu’il s’agit ici de recourir à des matières sonores qui vont être comme sculptées et transformées, dans une démarche qui est celle de 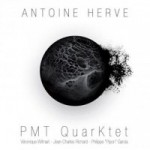 Véronique Wilmart co-signe avec Antoine Hervé toutes les compositions de ce disque magnifique et je suis certain que le pianiste ne m’en voudra pas de souligner à quel point sa comparse nourrit le disque de toute sa science de l’invention et de la perturbation atmosphérique (en ce sens que ses trouvailles sonores viennent tranquillement bousculer l’agencement d’un jazz déjà riche de toutes ses couleurs). Elle est la pourvoyeuse des climats, ceux sur lesquels les autres musiciens peuvent parvenir encore mieux à un épanouissement complet (Jean-Charles Richard est une fois de plus exemplaire, il n’est pas hasardeux de penser que bien souvent, Wayne Shorter le guette du coin de l’anche avec beaucoup de bienveillance). Impossible de « caser » cette musique dans une catégorie bien précise : il y a du jazz, forcément, mais ici on confinera à la musique sérielle, là à une séquence plus électro, avec une dose de minimalisme improvisé. Parfois on se croirait dans un film urbain et un peu frénétique (« Les triplettes de Barbès ») et pour tout dire, ces variations énigmatiques dessinent un monde très singulier, avec ce petit air de jamais entendu qui attire instantanément.
Véronique Wilmart co-signe avec Antoine Hervé toutes les compositions de ce disque magnifique et je suis certain que le pianiste ne m’en voudra pas de souligner à quel point sa comparse nourrit le disque de toute sa science de l’invention et de la perturbation atmosphérique (en ce sens que ses trouvailles sonores viennent tranquillement bousculer l’agencement d’un jazz déjà riche de toutes ses couleurs). Elle est la pourvoyeuse des climats, ceux sur lesquels les autres musiciens peuvent parvenir encore mieux à un épanouissement complet (Jean-Charles Richard est une fois de plus exemplaire, il n’est pas hasardeux de penser que bien souvent, Wayne Shorter le guette du coin de l’anche avec beaucoup de bienveillance). Impossible de « caser » cette musique dans une catégorie bien précise : il y a du jazz, forcément, mais ici on confinera à la musique sérielle, là à une séquence plus électro, avec une dose de minimalisme improvisé. Parfois on se croirait dans un film urbain et un peu frénétique (« Les triplettes de Barbès ») et pour tout dire, ces variations énigmatiques dessinent un monde très singulier, avec ce petit air de jamais entendu qui attire instantanément.