Étonnez-moi, Benoit !
 Et pan sur le bec ! À force d'entendre une poignée d'acrimonieux s'acharner sur une vidéo bruitiste dans laquelle un guitariste connu pour son refus des dogmes et son ouverture d'esprit – du petit au grand format, appliquée au jazz, au rock, à la musique contemporaine, à l’électronique et aux musiques improvisées – se mettait en scène lui-même ; à force de les voir faire semblant d'oublier son travail dans le collectif Muzzix, et certaines de ses expériences pluridisciplinaires telles que La Pieuvre ou le Circum Grand Orchestra*, deux grands ensembles qu’il avait réussi à réunir dans la minéralité du Feldspath, ou ses contributions décisives à certains disques (comme le Family Life Quartet de Jacques Mahieux ou Furrow de Maria Laura Baccarini, ce sont là deux illustrations à la volée) ; à force de les entendre ratiociner et relancer une fois encore le débat stérile et passéiste de la définition d’un « vrai » jazz alors qu’il s’agissait plutôt de regarder devant soi ; à force de ne pas comprendre cette manière de dénigrer par avance sa nomination à la tête de l'ONJ… quelques-uns d'entre nous, y compris les moins connaisseurs de son passé – mais très vite lassés par ces attaques injustifiées – en étaient venus à se laisser contaminer par un a priori symétrique et bienveillant à l'égard d'Olivier Benoit.
Et pan sur le bec ! À force d'entendre une poignée d'acrimonieux s'acharner sur une vidéo bruitiste dans laquelle un guitariste connu pour son refus des dogmes et son ouverture d'esprit – du petit au grand format, appliquée au jazz, au rock, à la musique contemporaine, à l’électronique et aux musiques improvisées – se mettait en scène lui-même ; à force de les voir faire semblant d'oublier son travail dans le collectif Muzzix, et certaines de ses expériences pluridisciplinaires telles que La Pieuvre ou le Circum Grand Orchestra*, deux grands ensembles qu’il avait réussi à réunir dans la minéralité du Feldspath, ou ses contributions décisives à certains disques (comme le Family Life Quartet de Jacques Mahieux ou Furrow de Maria Laura Baccarini, ce sont là deux illustrations à la volée) ; à force de les entendre ratiociner et relancer une fois encore le débat stérile et passéiste de la définition d’un « vrai » jazz alors qu’il s’agissait plutôt de regarder devant soi ; à force de ne pas comprendre cette manière de dénigrer par avance sa nomination à la tête de l'ONJ… quelques-uns d'entre nous, y compris les moins connaisseurs de son passé – mais très vite lassés par ces attaques injustifiées – en étaient venus à se laisser contaminer par un a priori symétrique et bienveillant à l'égard d'Olivier Benoit.
Désolé de le dire ici avec une pointe d'autosatisfaction, mais les faits sont là qui donnent raison à ceux qui n’avaient manifesté ni inquiétude ni agressivité vaine. Avec la publication de Paris Europa, double album choc captivant tout au long de ses quatre-vingt-douze minutes, la réponse de l'Orchestre National de Jazz 2014 est cinglante. Amis scrogneugneux, enfouissez vos aigreurs dans votre poche et posez votre mouchoir par-dessus : ce disque est un des temps forts de l'année (et probablement de la décennie) ; il s'avère au fil des écoutes une source de richesses, une caverne d’Ali Benoit, qu'on n’épuise pas en quelques écoutes, même les plus attentives. Europa Paris est à sa façon un monument : un constat assez logique puisque cette musique a quelque chose à voir avec l'architecture, Olivier Benoit aimant rappeler qu’il réfléchit « sur les concepts d’espace avant d’essayer de leur donner des formes musicales ». C’est un disque qui, de plus, ne souffre en rien d'avoir été composé dans un laps de temps assez court. Si le guitariste a imaginé chacun des mouvements en cherchant à définir une ligne personnelle, tout en prenant en compte la personnalité des solistes qui devaient s'y illustrer, l'impression d'ensemble et la cohésion ne s'en trouvent nullement affectées. Bien au contraire, la sélection des musiciens qui composent l'ONJ, fruit d'un travail associant son nouveau directeur à Bruno Chevillon, ne doit absolument rien au hasard ; elle est l’aboutissement d’une réflexion sur l’équilibre à trouver « en termes d’esthétique, mais aussi d’expérience et de génération » (32 ans séparent le membre le plus jeune du plus âgé). Onze musiciens sont ainsi unis pour le meilleur et pourraient bien marquer notre époque de leur empreinte. Savourons donc le plaisir qui nous est offert de vivre cet événement à leurs côtés !
Paris Europa se décline en six parties aux durées très variables (moins de quatre minutes pour « Paris VI » jusqu'à plus de quarante-quatre pour « Paris II », longue suite elle-même organisée en dix mouvements) et projette une myriade d'images qui accordent peu de place au repos. Scènes de nuit, scènes de jour, mouvements de foule, déplacements, trains de banlieue, dialogues ou monologues, courses poursuites, stridences urbaines, danses hypnotiques... une frénésie de ville, quoi ! Pas un seul instant la tension ne retombe tout au long de cette visite guidée ; on se dit qu'Olivier Benoit et son orchestre ont voulu abattre d'emblée le maximum de cartes sur la table afin de présenter dans ce premier panorama le champ de leurs possibles. Aux tutti où l'ONJ fait montre de sa force collective et impose de magnifiques textures sonores mêlant les instruments à vent aux cordes du piano et du violon, vont succéder des échanges où les instruments s'agrègent en combinaisons variables animées de mouvements cycliques, se répondent en motifs sériels dessinés par des déphasages rythmiques hérités du travail de Steve Reich ; guitare et claviers endossent le costume de designers sonores avides de perturbations atmosphériques et de fractures électriques ; la pulsion imprimée par le duo formé de la contrebasse (ou la basse) et de la batterie parle un jazz dont l'accent est aussi celui du rock, avant qu'un impromptu aux couleurs chambristes ou bruitistes ne lui reprenne la parole pour imposer son échappée improvisée. Cette profusion de sources d'inspiration et d'héritages assumés, qui pourrait n'être qu'un maelstrom indigeste en des mains moins expertes, devient luxuriance et suscite une adhésion sans réserve, par sa capacité d'assimilation et de (re)création. L'ONJ invente sa musique, il nous accorde le privilège d’assister à la naissance d’un processus artistique. Les solistes, quant à eux, sont habités par une frénésie de mouvement qui pourrait être celle des commuters, leurs chorus prennent tour à tour la forme de ballades rêveuses ou de noueuses improvisations, quand ils n’expriment pas un cri.
Disque d'interaction permanente à la mise en scène savante, Paris Europa est un manifeste libertaire, une déclaration d'imagination collective qui souligne avec acuité les talents de chacun des membres de l'ONJ. Aux côtés d'Olivier Benoit, il faut les citer tous (ici dans l'ordre alphabétique, le seul qui ne soit pas injuste) : Sophie Agnel (piano), Paul Brousseau (Fender Rhodes, synthétiseur basse, effets), Théo Ceccaldi (violon, alto), Bruno Chevillon (contrebasse, basse électrique), Jean Dousteyssier (clarinettes), Eric Echampard (batterie), Fidel Fourneyron (trombone, tuba), Alexandra Grimal (saxophones ténor et soprano), Fabrice Martinez (trompette, bugle), Hugues Mayot (saxophone alto).
Le choix des mots n'est jamais simple : sommes-nous là en présence d'un chef d'œuvre ? Le temps parlera, mais après tout, ne suffit-il pas de dire que la manière avec laquelle Olivier Benoit, entouré d’une équipe soudée, est parvenu à synthétiser toutes les musiques qui l'habitent depuis des années, est admirable ? Au point de donner vie à un idiome dont on attend dès à présent les prochaines pulsations, celles qui résonneront des échos d'une autre capitale européenne, Berlin.
Une seule réserve, mineure car elle porte sur un aspect formel de l’objet disque : si le digipack est élégant, on est un peu désemparé face à la sécheresse de son contenu. Liste des titres et des musiciens, quelques informations pratiques et c’est tout. On aurait aimé des détails supplémentaires, que cette histoire nous soit racontée dans son déroulement, juste pour le plaisir d’en apprendre encore un peu plus.
Mais c’est bien peu par rapport à tout le reste... Alors, Paris Europa, un disque électrisant ? Un temps fort de l’histoire du jazz contemporain ? Pour le coup, ça ne fait aucun doute.
* Dont le nouveau disque intitulé 12 - enregistré cette fois sous la férule du bassiste Christophe Hache – est de toute beauté et sera prochainement évoqué ici.
 La pochette de Country Roads fournit une indication assez précise de ce qui vous attend à l’écoute du nouveau disque du contrebassiste
La pochette de Country Roads fournit une indication assez précise de ce qui vous attend à l’écoute du nouveau disque du contrebassiste  Le fait d'être père d’un musicien justifie-t-il le silence autour d’un disque publié l'année dernière par un quartet dont il est le saxophoniste ? Dois-je taire un EP, comme on dit aujourd’hui, au prétexte que je serais partial et donc illégitime dans mes commentaires ? Ma réponse est non, et je m’autorise un rapide plaidoyer pro domo ! Une réponse d’autant plus négative que le groupe
Le fait d'être père d’un musicien justifie-t-il le silence autour d’un disque publié l'année dernière par un quartet dont il est le saxophoniste ? Dois-je taire un EP, comme on dit aujourd’hui, au prétexte que je serais partial et donc illégitime dans mes commentaires ? Ma réponse est non, et je m’autorise un rapide plaidoyer pro domo ! Une réponse d’autant plus négative que le groupe  Il est des jours tristes. Aujourd'hui en est un. Alors, sans se mettre la tête dans le sable, il n'est jamais inutile de se dire que l'homme est aussi capable du meilleur. Je vous propose la lecture d'un texte, que j'avais publié il y a quelques années et que vous trouverez dans une édition légèrement remaniée. Il ne résoudra aucun de nos problèmes, mais il pourra vous apporter un peu de lumière. Il parle d'un disque de John Coltrane enregistré au mois d'octobre 1960 : My Favorite Things.
Il est des jours tristes. Aujourd'hui en est un. Alors, sans se mettre la tête dans le sable, il n'est jamais inutile de se dire que l'homme est aussi capable du meilleur. Je vous propose la lecture d'un texte, que j'avais publié il y a quelques années et que vous trouverez dans une édition légèrement remaniée. Il ne résoudra aucun de nos problèmes, mais il pourra vous apporter un peu de lumière. Il parle d'un disque de John Coltrane enregistré au mois d'octobre 1960 : My Favorite Things. Une fois n’est pas coutume, il sera question ici de ce qu’on appelle pour simplifier un disque de « chanson française ». Voilà qui vous surprend, n’est-ce pas ? Vous conviendrez avec moi que je brocarde suffisamment le petit monde bariolé de nos chanteurs/chanteuses insipides et interchangeables et que je ne me prive jamais de l’occasion de dénoncer les relations incestueuses qu’entretient une minorité d’entre eux, dominante et inusable, avec la sphère radio-télévisée et ses passe-plats obéissants pour ne pas dire tout le bien que je pense d’un album récemment publié par le barisien
Une fois n’est pas coutume, il sera question ici de ce qu’on appelle pour simplifier un disque de « chanson française ». Voilà qui vous surprend, n’est-ce pas ? Vous conviendrez avec moi que je brocarde suffisamment le petit monde bariolé de nos chanteurs/chanteuses insipides et interchangeables et que je ne me prive jamais de l’occasion de dénoncer les relations incestueuses qu’entretient une minorité d’entre eux, dominante et inusable, avec la sphère radio-télévisée et ses passe-plats obéissants pour ne pas dire tout le bien que je pense d’un album récemment publié par le barisien 
 Après Waves et Around, Place To Be est le troisième album du guitariste australien
Après Waves et Around, Place To Be est le troisième album du guitariste australien  J’ai parfois un peu de mal avec la « chanson » dite française. Pas pour une question de principe, mais parce qu’il faut beaucoup de talent pour être l’alchimiste de la musique et des mots et que les artistes capables de les faire vraiment danser en les nourrissant de groove sont plutôt rares. Il faudrait pour commencer interdire les dictionnaires de rimes et l’utilisation des la la la, avant d’enseigner l’afterbeat à quelques uns de nos chanteurs (ainsi qu'à une bonne partie du public). Mais avec
J’ai parfois un peu de mal avec la « chanson » dite française. Pas pour une question de principe, mais parce qu’il faut beaucoup de talent pour être l’alchimiste de la musique et des mots et que les artistes capables de les faire vraiment danser en les nourrissant de groove sont plutôt rares. Il faudrait pour commencer interdire les dictionnaires de rimes et l’utilisation des la la la, avant d’enseigner l’afterbeat à quelques uns de nos chanteurs (ainsi qu'à une bonne partie du public). Mais avec 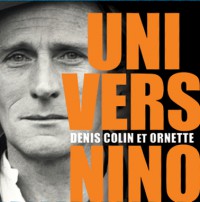 Pas évident de savoir pourquoi, un vilain jour de 1998, Nino Ferrer a choisi de se tirer une balle en plein cœur et d’aller crier son blues ailleurs. Peur de vieillir ? Ultime déchirement d’un artiste nourri de jazz et de rhythm’n’blues, un chanteur qui avait dû accepter l’idée selon laquelle Nino ne rencontrait que rarement l’assentiment du public, surtout lorsqu’il lui présentait son vrai visage ? Nino Ferrer était multiple bien qu’entier : sa « Désabusion », son « Arbre noir », sa « Maison près de la fontaine », son « South » qu’il préférait de loin au « Sud » qu’on lui avait suggéré d’enregistrer en Français ou encore sa « Métronomie » affichaient un contraste saisissant avec les « Cornichons », « Le téléfon » ou « Mirza »... des tubes un peu crétins qui résonnent encore très fort dans la plupart des oreilles (au moins celles des anciens).
Pas évident de savoir pourquoi, un vilain jour de 1998, Nino Ferrer a choisi de se tirer une balle en plein cœur et d’aller crier son blues ailleurs. Peur de vieillir ? Ultime déchirement d’un artiste nourri de jazz et de rhythm’n’blues, un chanteur qui avait dû accepter l’idée selon laquelle Nino ne rencontrait que rarement l’assentiment du public, surtout lorsqu’il lui présentait son vrai visage ? Nino Ferrer était multiple bien qu’entier : sa « Désabusion », son « Arbre noir », sa « Maison près de la fontaine », son « South » qu’il préférait de loin au « Sud » qu’on lui avait suggéré d’enregistrer en Français ou encore sa « Métronomie » affichaient un contraste saisissant avec les « Cornichons », « Le téléfon » ou « Mirza »... des tubes un peu crétins qui résonnent encore très fort dans la plupart des oreilles (au moins celles des anciens). Le trompettiste
Le trompettiste  Je vous aurai prévenu, vous ne pourrez pas dire : « Je ne savais pas ! » Parce que ce n’est pas la première fois que j’insiste sur le talent d’une chanteuse dont le parcours ne fait, selon moi, que commencer, malgré une histoire en musique qui remonte aujourd’hui à plus d’une quinzaine d’années, au cours desquelles elle s’est illustrée avec discrétion, affichant un talent qui ne peut aller désormais que vers l’épanouissement.
Je vous aurai prévenu, vous ne pourrez pas dire : « Je ne savais pas ! » Parce que ce n’est pas la première fois que j’insiste sur le talent d’une chanteuse dont le parcours ne fait, selon moi, que commencer, malgré une histoire en musique qui remonte aujourd’hui à plus d’une quinzaine d’années, au cours desquelles elle s’est illustrée avec discrétion, affichant un talent qui ne peut aller désormais que vers l’épanouissement.
 Vous ne trouverez pas ce disque par hasard... Inutile de vous bercer d’illusions, nous ne sommes pas arrivés au jour où l’album d’un trio tel que celui composé par
Vous ne trouverez pas ce disque par hasard... Inutile de vous bercer d’illusions, nous ne sommes pas arrivés au jour où l’album d’un trio tel que celui composé par  Je connais Franck Agulhon depuis près de vingt ans… Je crois l'avoir vu pour la première fois en juillet 1995 : à cette époque, mon fils, alors saxophoniste en herbe et âgé de dix ans, terminait sa première année à l'École des Musiques Actuelles de Nancy et participait à un ultime stage de trois jours avant les vacances d'été. Parmi les musiciens chargés de l'animation, il y avait un jeune batteur qui attirait d'emblée la sympathie par sa simplicité désarmante et sa grande gentillesse.
Je connais Franck Agulhon depuis près de vingt ans… Je crois l'avoir vu pour la première fois en juillet 1995 : à cette époque, mon fils, alors saxophoniste en herbe et âgé de dix ans, terminait sa première année à l'École des Musiques Actuelles de Nancy et participait à un ultime stage de trois jours avant les vacances d'été. Parmi les musiciens chargés de l'animation, il y avait un jeune batteur qui attirait d'emblée la sympathie par sa simplicité désarmante et sa grande gentillesse. 
 Je prends les devants et présente par avance mes excuses au saxophoniste
Je prends les devants et présente par avance mes excuses au saxophoniste  Difficile de traduire en mots l’émotion qui me gagne à l’écoute de Belle Époque, le disque en duo enregistré par
Difficile de traduire en mots l’émotion qui me gagne à l’écoute de Belle Époque, le disque en duo enregistré par 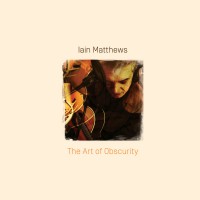 Iain Matthews
Iain Matthews Allez, une fois n'est pas coutume : malgré les vrais morceaux promis par le sous-titre de mon blog, je ne vais pas vous parler de musique aujourd'hui… Encore que l'évocation d'un appareil électro-ménager - en l'occurrence un lave-vaisselle - puisse toujours donner lieu à une analyse qui le rapprochera d'un instrument : c'est vrai, un tel objet émet des sons, il semble parfois animé d'un tempo et ses cycles – comme autant de rythmes - de variations, ses sonorités liquides ne sont pas sans faire penser à certains arrangements orchestraux contemporains, et j'irais même jusqu'à penser que son bruit constitutif est en lui-même une forme élaborée de musique. Certainement pas plus ennuyeuse que celle qu’émettent nos éminences casquées dont les sons font frissonner les fessiers soi-disant festifs de tous les continents. Une musique du quotidien de nos cuisines tout aussi captivante que je ne sais quelle playlist fourguée chaque jour sur telle radio de service dit public, laconiquement vendue par une voix dont la capacité à lire avec conviction les dossiers de presse écrits par d’autres m’émeut à un point que vous ne sauriez imaginer... « On aime, on vous en parle ». Tu parles, Charles, tu ferais mieux de la garder pour toi, ta liste chloroformée.
Allez, une fois n'est pas coutume : malgré les vrais morceaux promis par le sous-titre de mon blog, je ne vais pas vous parler de musique aujourd'hui… Encore que l'évocation d'un appareil électro-ménager - en l'occurrence un lave-vaisselle - puisse toujours donner lieu à une analyse qui le rapprochera d'un instrument : c'est vrai, un tel objet émet des sons, il semble parfois animé d'un tempo et ses cycles – comme autant de rythmes - de variations, ses sonorités liquides ne sont pas sans faire penser à certains arrangements orchestraux contemporains, et j'irais même jusqu'à penser que son bruit constitutif est en lui-même une forme élaborée de musique. Certainement pas plus ennuyeuse que celle qu’émettent nos éminences casquées dont les sons font frissonner les fessiers soi-disant festifs de tous les continents. Une musique du quotidien de nos cuisines tout aussi captivante que je ne sais quelle playlist fourguée chaque jour sur telle radio de service dit public, laconiquement vendue par une voix dont la capacité à lire avec conviction les dossiers de presse écrits par d’autres m’émeut à un point que vous ne sauriez imaginer... « On aime, on vous en parle ». Tu parles, Charles, tu ferais mieux de la garder pour toi, ta liste chloroformée. Je raille suffisamment la grisaille lorraine pour ne pas me réjouir d’une succession de journées ensoleillées dont les allures printanières ont ici quelque chose d’un peu surnaturel en cette fin d’hiver. Oui, car n’oublions pas que le calendrier nous rappelle à l’ordre : nous sommes encore en hiver. Mais quel plaisir, nom d’une ampoule de vitamine D, quel plaisir !
Je raille suffisamment la grisaille lorraine pour ne pas me réjouir d’une succession de journées ensoleillées dont les allures printanières ont ici quelque chose d’un peu surnaturel en cette fin d’hiver. Oui, car n’oublions pas que le calendrier nous rappelle à l’ordre : nous sommes encore en hiver. Mais quel plaisir, nom d’une ampoule de vitamine D, quel plaisir !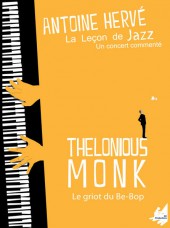 Vous allez me dire que je radote… A la fin de l’année 2012, j’avais déjà évoqué les Leçons de Jazz d’
Vous allez me dire que je radote… A la fin de l’année 2012, j’avais déjà évoqué les Leçons de Jazz d’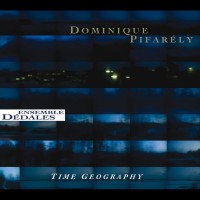 J’ai reçu voici plus de deux mois déjà un disque dont les beautés se dévoilent au fil des écoutes et n’en finissent pas de m’enchanter. Une magnifique invitation au voyage, aussi bien dans le temps que dans l’espace : Time Geography, tel est son titre, est le deuxième album de l’Ensemble Dédales (après Nommer chaque chose à part en 2009), un nonette emmené par le violoniste
J’ai reçu voici plus de deux mois déjà un disque dont les beautés se dévoilent au fil des écoutes et n’en finissent pas de m’enchanter. Une magnifique invitation au voyage, aussi bien dans le temps que dans l’espace : Time Geography, tel est son titre, est le deuxième album de l’Ensemble Dédales (après Nommer chaque chose à part en 2009), un nonette emmené par le violoniste  Qu’on se le dise : ce disque et les mondes parallèles qu’il traverse n’appartiennent qu’à eux-mêmes ! Sui generis, comme dirait l’autre…
Qu’on se le dise : ce disque et les mondes parallèles qu’il traverse n’appartiennent qu’à eux-mêmes ! Sui generis, comme dirait l’autre…