#NJP2014, échos des pulsations / 4
Elle avance pieds nus, presque sur la pointe des pieds. Elina Duni est une chanteuse albanaise ayant émigré en Suisse à l’âge de dix ans, mais qui garde de son pays natal, tout près du cœur, bon nombre de chansons qu’elle va interpréter en compagnie de son trio, lui-même originaire de Suisse.
« Au-delà de la montagne », telle est la traduction de Matanë Malit, disque dont Elina Duni va chanter une grande partie des compositions. La chanteuse, qui s’exprime dans un français que beaucoup de nos compatriotes pourraient lui envier, prend le temps d’expliquer au public ce que racontent les chansons. Il est question d’exil, d’hommes qui partent en traversant les montagnes, de femmes qui restent seules. Il est beaucoup question d’amour aussi, mais un amour sublimé, comme dans un conte. On voyage en Albanie bien sûr (au nord comme au sud) ainsi qu’au Kosovo.

Les trois musiciens aux côtés d’Elina Duni sont bien plus que des accompagnateurs : cette formation est un véritable quatuor, très équilibré, qui sait pratiquer la suspension des temps ou la répétition hypnotiques des notes. On se surprend parfois à réaliser que le piano de Collin Vallon est souvent un instrument rythmique tandis que Norbert Pfamatter dessine de nombreux motifs mélodiques avec sa batterie. A l’arrière de la scène, casquette vissée sur la tête, Patrice Moret intériorise beaucoup son jeu, comme s’il était lui-même un des protagonistes des histoires racontées. Ce trio, par instants, n’est pas sans faire penser, par sa façon de scander et de créer la tension, par l'utilisation fréquente des rods, à celui du regretté Esbjörn Svensson, mais dans une coloration plus feutrée.
Elina Duni, très recueillie, vit ses chansons avec intensité, sa voix envoûte et conquiert très vite la salle qui est tombée sous le charme. Comme si chacun d’entre nous touchait du doigt une beauté éternelle, hors de temps et témoin de l’histoire tourmentée d’un peuple qui souffre aujourd'hui encore, au-delà du spectacle de paysages somptueux, au-delà de la montagne.
Un concert moment de grâce, qu’il faut sans attendre prolonger en écoutant Matanë Malit, disque confident et tout aussi magnétique que cette heure enchantée.
Elina Duni 4tet
Elina Duni (chant), Collin Vallon (piano), Patrice Moret (contrebasse), Norbert Pfamatter (batterie).
Disque associé : Matanë Malit (ECM, 2012)
Il ne s’en est pas caché : ce concert était pour le saxophoniste Pierrick Pédron le premier du répertoire Kubic’s Cure, du nom de son récent disque consacré à une relecture à sa façon du groupe The Cure, chantre de la Cold Wave emmené depuis la fin des années 70 par le lettré Robert Smith, l’homme au « noir à lèvres ». Pour corser l’affaire, son trio a dû faire appel à un remplaçant à la contrebasse, en l’absence de Thomas Bramerie, titulaire du poste. C’est donc le Suédois Viktor Nyberg qui était chargé de prendre sa place hier soir, un exercice dont il s’est sorti semble-t-il avec le plus grand naturel.
Quand on s’y songe, il faut être culotté pour s’attaquer à une adaptation de ce rock aux mélodies minimalistes et à l’esthétique glacée ! « Pourquoi pas Motorhead, pendant que tu y es ? » lui a d’ailleurs fait remarquer Franck Agulhon, compagnon de route du saxophoniste depuis de nombreuses années. Pierrick Pédron prend des risques : d’abord de heurter une partie du public pas forcément disposée à admettre ce qui, pour certains, serait de l’ordre du blasphème. Comment, faire subir une telle Cure au jazz, non mais vous n’y pensez pas ? Si si, justement Pierrick Pédron y pense et plutôt deux fois qu’une. Ensuite dans la réalisation du concert : tout près de lui, un petit boîtier dont il se sert pour ajouter des effets à son saxophone alto. Il faut savoir se dédoubler, pratiquer le strabisme divergent, un exercice qui peut s'avérer délicat. Et puis le Breton chante et c’est nouveau (sur l’album, c’est Thomas de Pourquery qui était chargé de la mission à trois reprises). On me souffle d’ailleurs dans l’oreillette que Pierrick Pédron pourrait récidiver sur son prochain disque mais chut, je n’ai rien dit.

Les perplexes ont eu tort car le trio est d’une efficacité redoutable : Franck Agulhon est omniprésent et met beaucoup de couleurs dans son jeu, ce musicien-là est un partenaire précieux, doublé d’un homme aux qualités humaines peu courantes ; Viktor Nyberg, faussement impassible, construit à l’arrière une belle charpente, il est plus qu’un substitut. Quant à Pierrick Pédron, il ne demande qu’à s’envoler et souffler un vent à la fois puissant et d’une très grande clarté (le timbre de son alto est d’une précision démoniaque). Ses interventions énergiques ne perdent jamais de vue la trame mélodique des thèmes sur lesquels il improvise et c’est un plaisir de l’entendre glisser un peu de Thelonious Monk au milieu d’une composition de The Cure. Comme ça, mine de rien, histoire de nous rappeler s’il en était besoin que la précédente expérience du trio avait consisté à transfigurer le pianiste sur un album urgent et bluffant (Kubic’s Monk) enregistré en deux ou trois jours. Il faut aussi souligner son extraordinaire chorus sur « A Reflection » : parce qu’il s’agissait pour l’occasion de se substituer à la zorna (une sorte de hautbois oriental à anche double) de Ghamri Boubaker sur le disque. Un sacré défi, relevé haut les anches, tout en modulations et vibrations qui fleuraient bon le Maghreb. Encore un pari réussi. Le trio est revenu pour un rappel au milieu duquel Franck Agulhon aura la part belle : « Just Like Heaven », certains d’entre vous s’en souviennent-ils peut-être ? C’était l’indicatif de l’émission de télévision « Les enfants du rock » au siècle dernier. Un enfant du rock, ce qu’est aussi Pierrick Pédron et qu’il n’a pas manqué de rappeler. Et comme le saxophoniste, sans me prévenir, a tenu à me remercier publiquement d’avoir écrit le texte de présentation destiné à la pochette de Kubic’s Cure, je ne peux que lui rendre la pareille. Merci Pierrick, je ne sais pas si, comme tu l’as dit, je suis un « grand monsieur », mais je suis certain que travailler pour toi est un immense plaisir. Dont acte !
Pierrick Pédron Trio
Pierrick Pédron (saxophone alto, chant, effets), Viktor Nyberg (contrebasse), Franck Agulhon (batterie).
Disque associé : Kubic’s Cure (Act Music, 2014)


 J'avais eu l'occasion de souligner en 2013 les qualités de
J'avais eu l'occasion de souligner en 2013 les qualités de 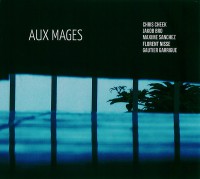 Pour
Pour 

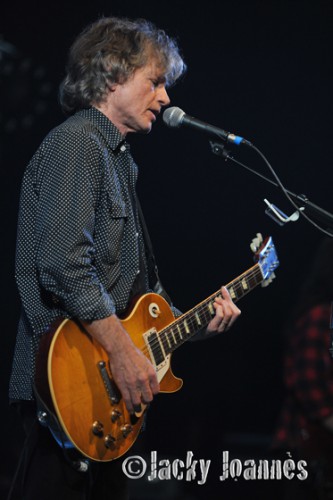




 Régis Huby nous gâte encore : son label
Régis Huby nous gâte encore : son label 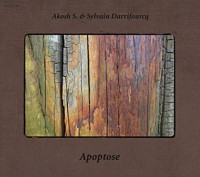 Avant de conclure, puisqu’il est question ici de duo saxophone batterie, je ne peux passer sous silence un nouvel épisode de cette association qui peut aussi s'avérer d’une âpreté abrasive : Sylvain Darrifourcq et Akosh S. avancent leurs pions sur le terrain beaucoup plus brûlant d’un corps à corps violent et livrent une musique fiévreuse, presque hantée, avec Apoptose. Difficile en l’occurrence de parler de conversation tant l’échange entre les deux vous emporte loin, là où l’angoisse peut aussi vous étreindre : portée par une énergie qui est celle de la vie elle-même (reportons-nous pour mieux comprendre à la définition du mot apoptose, qui signifie la mort cellulaire, phénomène bénéfique parce que nécessaire à la survie), cette musique souvent sombre, hurlée quand il le faut, est d’une puissance ravageuse qui vous prend aux tripes pour ne plus vous lâcher. Ce n’est certes pas l’album qu’on conseillera pour une fin de banquet, mais celui-ci est assurément un choc émotionnel qu’il faut vivre pour le croire. Et comprendre que l’être humain reste un mystère, même si le voyage n’est pas de tout repos.
Avant de conclure, puisqu’il est question ici de duo saxophone batterie, je ne peux passer sous silence un nouvel épisode de cette association qui peut aussi s'avérer d’une âpreté abrasive : Sylvain Darrifourcq et Akosh S. avancent leurs pions sur le terrain beaucoup plus brûlant d’un corps à corps violent et livrent une musique fiévreuse, presque hantée, avec Apoptose. Difficile en l’occurrence de parler de conversation tant l’échange entre les deux vous emporte loin, là où l’angoisse peut aussi vous étreindre : portée par une énergie qui est celle de la vie elle-même (reportons-nous pour mieux comprendre à la définition du mot apoptose, qui signifie la mort cellulaire, phénomène bénéfique parce que nécessaire à la survie), cette musique souvent sombre, hurlée quand il le faut, est d’une puissance ravageuse qui vous prend aux tripes pour ne plus vous lâcher. Ce n’est certes pas l’album qu’on conseillera pour une fin de banquet, mais celui-ci est assurément un choc émotionnel qu’il faut vivre pour le croire. Et comprendre que l’être humain reste un mystère, même si le voyage n’est pas de tout repos.  Magma met les petits plats dans l’écrin
Magma met les petits plats dans l’écrin
 S'il n'avait eu la mauvaise idée de quitter prématurément notre monde le 17 juillet 1967, John Coltrane fêterait aujourd'hui son quatre-vingt-huitième anniversaire. Impossible de ne pas avoir une pensée émue pour le saxophoniste chaque 23 septembre, tant sa musique continue de vivre en nous, presque cinquante ans après sa mort.
S'il n'avait eu la mauvaise idée de quitter prématurément notre monde le 17 juillet 1967, John Coltrane fêterait aujourd'hui son quatre-vingt-huitième anniversaire. Impossible de ne pas avoir une pensée émue pour le saxophoniste chaque 23 septembre, tant sa musique continue de vivre en nous, presque cinquante ans après sa mort. 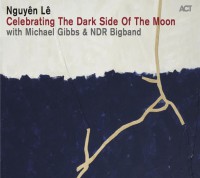 Au mois de juillet dernier, le guitariste
Au mois de juillet dernier, le guitariste 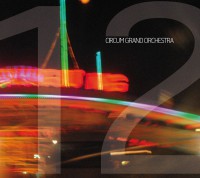 Avez-vous déjà reçu un disque en pleine figure ? C’est le genre d’incident dont je suis victime de temps en temps et qui – contrairement à ce qu’on pourrait imaginer – vous plonge dans un état de bien-être dont on n’aimerait ne plus sortir. Et ça fait de vous quelqu’un de partageur parce qu’aussitôt, on est gagné par le besoin de le faire savoir au plus grand nombre : « Faut que je leur dise ! Faut que je leur dise ! »
Avez-vous déjà reçu un disque en pleine figure ? C’est le genre d’incident dont je suis victime de temps en temps et qui – contrairement à ce qu’on pourrait imaginer – vous plonge dans un état de bien-être dont on n’aimerait ne plus sortir. Et ça fait de vous quelqu’un de partageur parce qu’aussitôt, on est gagné par le besoin de le faire savoir au plus grand nombre : « Faut que je leur dise ! Faut que je leur dise ! »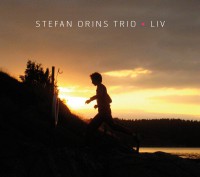 Ce disque est une fête, tour à tour rageuse ou joyeuse, polyrythmique et animée de forces qui semblent inépuisables. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, j’aimerais ici ajouter qu’un trio (inclus dans le Circum Grand Orchestra), celui du pianiste Stefan Orins, a publié au même moment un enchanteur Liv. Bien sûr, ne serait-ce que pour des raisons d’ordre quantitatif, l’esthétique de ce troisième album d’une formation née à la fin des années 90 est sensiblement différente celle de 12 ; mais l’exigence est la même, la quête de l’espace aussi intense. L’une de ses maximes est la suivante : « Plus les racines sont profondes, plus luxuriantes sont les branches ».
Ce disque est une fête, tour à tour rageuse ou joyeuse, polyrythmique et animée de forces qui semblent inépuisables. Et comme un bonheur ne vient jamais seul, j’aimerais ici ajouter qu’un trio (inclus dans le Circum Grand Orchestra), celui du pianiste Stefan Orins, a publié au même moment un enchanteur Liv. Bien sûr, ne serait-ce que pour des raisons d’ordre quantitatif, l’esthétique de ce troisième album d’une formation née à la fin des années 90 est sensiblement différente celle de 12 ; mais l’exigence est la même, la quête de l’espace aussi intense. L’une de ses maximes est la suivante : « Plus les racines sont profondes, plus luxuriantes sont les branches ». Deux mois de silence ou presque. Normal, en été, j’ai tendance à hiberner et le réveil est plutôt dur, vous pouvez m’en croire. Pourtant ce ne sont pas les idées de chroniques qui me manquent, mais juste le stimulus qui me fera reprendre le clavier. Oui, il y a de bien beaux disques dont j’ai envie de parler ici et dont je parlerai, c’est sûr. Je peux vous donner quelques exemples : Together Together, le très beau duo enregistré par le batteur Christophe Marguet et le saxophoniste Daniel Erdmann ; Sunbathing Underwater, une nouvelle proposition tout aussi improvisée qu’enluminée de mon camarade Henri Roger, en piano solo cette fois ; Silk And Salt Melodies, nouveau chapitre du grand roman musical de Louis Sclavis, plus en forme que jamais et qui étend son Atlas Trio à un quartet avec l’adjonction d’un percussionniste ; Source, très belle réalisation du trio franco-germano-brésilien Dreisam installé à Lyon ; ou encore le disque de Bounce Trio, une formation réjouissante emmenée par le pianiste organiste Mathieu Marthouret. Il faudrait aussi que j’évoque le double CD Offering, exhumation enfin complète du concert donné par John Coltrane et sa fine équipe le 11 novembre 1966. Sans oublier Celebrating The Dark Side Of The Moon, disque à venir que le guitariste Nguyên Lê a enregistré avec le NDR Big Band, en hommage à l'album culte de Pink Floyd (le guitariste m'ayant fait l'honneur de me demander d'écrire les notes de pochette de l'album, ce dont je le remercie infiniment). J’arrête là cette première liste qui vous donnera une idée approximative de la tonalité des textes à venir.
Deux mois de silence ou presque. Normal, en été, j’ai tendance à hiberner et le réveil est plutôt dur, vous pouvez m’en croire. Pourtant ce ne sont pas les idées de chroniques qui me manquent, mais juste le stimulus qui me fera reprendre le clavier. Oui, il y a de bien beaux disques dont j’ai envie de parler ici et dont je parlerai, c’est sûr. Je peux vous donner quelques exemples : Together Together, le très beau duo enregistré par le batteur Christophe Marguet et le saxophoniste Daniel Erdmann ; Sunbathing Underwater, une nouvelle proposition tout aussi improvisée qu’enluminée de mon camarade Henri Roger, en piano solo cette fois ; Silk And Salt Melodies, nouveau chapitre du grand roman musical de Louis Sclavis, plus en forme que jamais et qui étend son Atlas Trio à un quartet avec l’adjonction d’un percussionniste ; Source, très belle réalisation du trio franco-germano-brésilien Dreisam installé à Lyon ; ou encore le disque de Bounce Trio, une formation réjouissante emmenée par le pianiste organiste Mathieu Marthouret. Il faudrait aussi que j’évoque le double CD Offering, exhumation enfin complète du concert donné par John Coltrane et sa fine équipe le 11 novembre 1966. Sans oublier Celebrating The Dark Side Of The Moon, disque à venir que le guitariste Nguyên Lê a enregistré avec le NDR Big Band, en hommage à l'album culte de Pink Floyd (le guitariste m'ayant fait l'honneur de me demander d'écrire les notes de pochette de l'album, ce dont je le remercie infiniment). J’arrête là cette première liste qui vous donnera une idée approximative de la tonalité des textes à venir.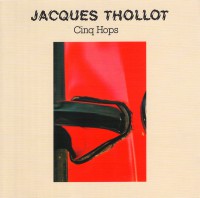 Ce texte aurait pu trouver sa place dans ma page
Ce texte aurait pu trouver sa place dans ma page  Quelle drôle d’idée ! Près de quarante ans après la sortie de l’album Émile Jacotey, quatrième disque du groupe
Quelle drôle d’idée ! Près de quarante ans après la sortie de l’album Émile Jacotey, quatrième disque du groupe  Je le disais récemment dans
Je le disais récemment dans  J'ai reçu depuis quelque temps plusieurs témoignages de confiance et des remerciements assez émouvants qui m'interpellent vraiment. Au début de la semaine, un vieux pote amoureux de musique, travailleur acharné du partage de ses passions, me demandait l'autorisation de reproduire l'une des chroniques de mon blog dans son magazine. Hier, je recevais un message d'un pianiste qui tenait à me faire part du plaisir pris à la lecture d'un de mes textes ; il voulait m'en remercier, un comble alors que de mon point de vue, c'est plutôt moi le débiteur. Au cours de l'hiver, un autre musicien m'a sollicité, un peu dans l'urgence, pour que j'écrive le rédactionnel devant figurer sur la pochette de son nouveau disque. Un exercice de style dont j'ai essayé de m'acquitter au mieux, avec les moyens du bord, ceux de l’écriveur que je suis et dont je dispose tant bien que mal. On m'a aussi demandé si j'acceptais qu'un extrait d'une de mes chroniques figure sur le catalogue de la prochaine saison d'une salle de concert. Je travaille actuellement sur la rédaction du dossier de presse associé à la parution du disque d'un jeune guitariste. Tout récemment enfin, mon complice Jacky Joannès a relevé le défi - c’est moi qui l’ai lancé, je le reconnais - d'une prochaine exposition unissant textes et photographies ; celle-ci, programmée au mois d'octobre 2016, sera principalement consacrée aux saxophonistes et aux clarinettistes et devrait s'appeler « La part des anches ». J'ai même prévu de réaliser le petit livre de l'exposition avant qu'elle ne commence, afin de le proposer lors du vernissage.
J'ai reçu depuis quelque temps plusieurs témoignages de confiance et des remerciements assez émouvants qui m'interpellent vraiment. Au début de la semaine, un vieux pote amoureux de musique, travailleur acharné du partage de ses passions, me demandait l'autorisation de reproduire l'une des chroniques de mon blog dans son magazine. Hier, je recevais un message d'un pianiste qui tenait à me faire part du plaisir pris à la lecture d'un de mes textes ; il voulait m'en remercier, un comble alors que de mon point de vue, c'est plutôt moi le débiteur. Au cours de l'hiver, un autre musicien m'a sollicité, un peu dans l'urgence, pour que j'écrive le rédactionnel devant figurer sur la pochette de son nouveau disque. Un exercice de style dont j'ai essayé de m'acquitter au mieux, avec les moyens du bord, ceux de l’écriveur que je suis et dont je dispose tant bien que mal. On m'a aussi demandé si j'acceptais qu'un extrait d'une de mes chroniques figure sur le catalogue de la prochaine saison d'une salle de concert. Je travaille actuellement sur la rédaction du dossier de presse associé à la parution du disque d'un jeune guitariste. Tout récemment enfin, mon complice Jacky Joannès a relevé le défi - c’est moi qui l’ai lancé, je le reconnais - d'une prochaine exposition unissant textes et photographies ; celle-ci, programmée au mois d'octobre 2016, sera principalement consacrée aux saxophonistes et aux clarinettistes et devrait s'appeler « La part des anches ». J'ai même prévu de réaliser le petit livre de l'exposition avant qu'elle ne commence, afin de le proposer lors du vernissage. On peu appréhender ce double album de deux façons : soit en le considérant d'un œil sévère au prétexte que Gérard Manset, un peu trop sûr de la fidélité de ses aficionados jamais démentie depuis plus de quarante-cinq ans, se la joue facile en leur lâchant, comme un os à ranger, après un long silence discographique, une compilation améliorée sous la forme d'une sélection de dix-sept de ses vieilles chansons réenregistrées en 2012 auxquelles il ajoute un inédit qui donnera son titre à l’album, afin de marquer un changement de label et son arrivée chez Warner ; soit en acceptant cette proposition finalement pas plus malhonnête qu'une autre pour faire le constat, une fois encore, de sa singularité et de son talent fou ici concentrés en près de 100 minutes d'une élégance formelle indiscutable, presque intemporelle.
On peu appréhender ce double album de deux façons : soit en le considérant d'un œil sévère au prétexte que Gérard Manset, un peu trop sûr de la fidélité de ses aficionados jamais démentie depuis plus de quarante-cinq ans, se la joue facile en leur lâchant, comme un os à ranger, après un long silence discographique, une compilation améliorée sous la forme d'une sélection de dix-sept de ses vieilles chansons réenregistrées en 2012 auxquelles il ajoute un inédit qui donnera son titre à l’album, afin de marquer un changement de label et son arrivée chez Warner ; soit en acceptant cette proposition finalement pas plus malhonnête qu'une autre pour faire le constat, une fois encore, de sa singularité et de son talent fou ici concentrés en près de 100 minutes d'une élégance formelle indiscutable, presque intemporelle. 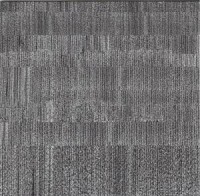 Jamais deux sans trois. Fin avril, il était question ici d’un trio en immersion qui nous avait invité à partager sa
Jamais deux sans trois. Fin avril, il était question ici d’un trio en immersion qui nous avait invité à partager sa  Et pan sur le bec ! À force d'entendre une poignée d'acrimonieux s'acharner sur une vidéo bruitiste dans laquelle un guitariste connu pour son refus des dogmes et son ouverture d'esprit – du petit au grand format, appliquée au jazz, au rock, à la musique contemporaine, à l’électronique et aux musiques improvisées – se mettait en scène lui-même ; à force de les voir faire semblant d'oublier son travail dans le collectif
Et pan sur le bec ! À force d'entendre une poignée d'acrimonieux s'acharner sur une vidéo bruitiste dans laquelle un guitariste connu pour son refus des dogmes et son ouverture d'esprit – du petit au grand format, appliquée au jazz, au rock, à la musique contemporaine, à l’électronique et aux musiques improvisées – se mettait en scène lui-même ; à force de les voir faire semblant d'oublier son travail dans le collectif  La pochette de Country Roads fournit une indication assez précise de ce qui vous attend à l’écoute du nouveau disque du contrebassiste
La pochette de Country Roads fournit une indication assez précise de ce qui vous attend à l’écoute du nouveau disque du contrebassiste