J'ai publié ce texte il y a dix ans, au mois de mars 2007. En le relisant, je me suis dit qu'il n'avait pas trop vieilli. Enfin, si, quand même un peu. Il faudrait changer quelques titres, quelques noms. Il est certain aussi qu'on pourrait ajouter assez facilement d'autres cas d'espèces. A vous de jouer !
Je me demande si je ne vais pas faire mienne la théorie du complot. Non, non, ne riez pas, c’est vrai. Je n’évoque pas ici les luttes invisibles entre d’obscures forces contre d’autres non moins ténébreuses à des fins de domination du monde ; non ça, je le laisse à tous ceux qui ont bien plus d’imagination que moi et qui y croient vraiment. Je parle du vrai complot : celui qui ME vise, personnellement, et dont j’ai depuis longtemps pu établir la preuve. Laissez-moi vous expliquer...
Je suis ce que l’on appelle, non pas un cinéphile, mais un gourmand de cinéma. Attention toutefois, pas celui qu’on nous propose de visionner à travers la fenêtre d’un poste de télévision, même à écran plat HD et bidule machin chouette (bizarre comme on a tendance, de nos jours, à nous vendre de petits bijoux technologiques fort coûteux d’ailleurs… De somptueux contenants alors que le contenu est souvent affligeant). Point du tout ! Pour moi, le cinéma ne se comprend qu’en salle et en version originale. Je fuis autant que je peux les complexes (marrante cette dénomination car lorsque je m’approche des supermarchés du cinéma, je suis plutôt frappé par l’extrême simplisme de leur fonctionnement : tu paies, tu bouffes, tu te vautres, tu ne réfléchis pas, accroche-toi aux sièges de ton quarante-neuvième Taxi). J’ai une sainte horreur de tout ce qui s’apparente aux blocks busters américains, ces films pour adolescents attardés qui nous expliquent le monde en deux catégories : les bons et les méchants, et qui se complaisent dans la surexposition d’une violence qu’ils prétendent dénoncer ; je leur préfère de très loin tous les films qui racontent des histoires d’êtres humains, avec des vies qui s’entrecroisent, des observations fines de notre société, des œuvres marquées par un minimum de subtilité et de justesse. Bref, je suis en quête de ces petites vibrations qui me laissent espérer qu’il reste encore ici-bas suffisamment de forces créatrices pour que ce monde continue de travailler un peu, rien qu’un peu, à l’épanouissement de l’espèce humaine (oui, je sais, c’est idiot). Et croyez-moi, malgré le tapage médiatique qui entoure certaines productions (bruit de fond marchand auquel notre beau pays n’échappe pas… voyez donc en ce moment la promotion faite pour cette chose appelée Hell Phone), on trouve vraiment de quoi se nourrir, pour peu qu’on ait la chance d’habiter une ville suffisamment grande. Pour combien de temps ? Ceci est une autre histoire…
Tiens, je pense également à une manie très franchouillarde de traduire les titres des films… quand les producteurs veulent bien les franciser d’ailleurs, ce que personnellement je ne leur demande pas puisque seule la version originale m’intéresse ! Le plus marrant, c’est un film qui conserve son titre original malgré un doublage la plupart du temps calamiteux. Et le pire, très certainement, c’est le film français qui se pare des atours du film américain pour faire croire que… Tiens, prenez Hell Phone, une fois de plus… moi j’aurais bien aimé un truc idiot du genre Le téléphone infernal… Mais bon, je suis vieux, je ne suis pas le cœur de cible comme disent les pros du marketing. Ridicule… Revenons donc à notre histoire de traduction. En général, c’est pitoyable et je suis plié de rire à l’idée de tout le jus de crâne consommé uniquement pour aboutir à un résultat dont on imagine qu’il va faire accourir le public dans les salles. Vous voulez un exemple, sommet du stupide ? Un film australo-américain vient de sortir en France. Son titre original est Music and Lyrics, ce qui, je ne vous l’apprends pas, signifie Paroles et Musique (ou l'inverse pour être précis mais ici on ne dit pas Musique et Paroles), un titre déjà pris en France par un film d’Élie Chouraqui je crois. Donc, pas possible, déjà pris, il faut trouver autre chose. Ce film met en scène Hugh Grant dans le rôle d’un musicien, ancienne gloire des années 80 qui se voit offrir une chance de revenir sur le devant de la scène parce qu’une diva l’invite à chanter avec elle sur son prochain album. D’où le titre français Le come back… On pourra s’interroger sur le bien fondé d’un tel choix, mais après tout, cette expression est depuis longtemps passée dans notre langage courant. Pourquoi pas ? Certes, j’aurais préféré Le retour mais ceci ne me regarde pas… Le problème, il est ailleurs, il est juste au-dessous. Le truc qui est nul, c’est le sous-titre : A la recherche de la nouvelle gloire. Oh la la la la ! Tu parles d’une connotation à la con… Ah ben oui, ça donne vachement envie d’aller le voir le film maintenant… Ou plutôt, je crains fort que grâce à ce bonus d’un haut intérêt culturel ne se rendent en masse pour voir ce film des hordes de pies jacasseuses pré-pubères et d’insupportables goinfreurs de tonneaux de pop corn et de bidons de soda à haute teneur en sucre…
Ce qui m’amène à mon sujet du jour car, en attendant la venue du désert culturel qui nous guette inexorablement, je continue à fréquenter les salles obscures avec régularité et toujours le même bonheur. Pourtant… pourtant, il faut souvent être armé d’une patience d’ange pour supporter les travers de nos congénères… Voici en quelques lignes une douzaine de portraits de drôles de cinéphages régulièrement côtoyés depuis plusieurs années… Je tiens à préciser ici même que cette liste est non exhaustive et qu’il vous est offert la possibilité de la compléter grâce à vos propres expériences
Scène 1
Celui ou celle qui pue ou dont le parfum vous fait littéralement exploser les narines. Et croyez-moi, c’est plus fréquent que vous ne le pensez, surtout en fin de semaine. Je ne sais pas pourquoi les cinéphiles odorants ont une tendance insupportable à venir s’installer à proximité du petit recoin bien tranquille dans lequel je me suis installé quelques instants plus tôt. C’est comme la fumée de cigarette. Vous êtes quelque part, dehors, et toc ! Y a un mec qui fume et qui expectore comme un fou furieux. Ben... vous pouvez être sûr que la fumée, c’est direct pour mes naseaux. Ils sont là, trois cents autour de vous et comme par hasard, le nuage les contourne en douceur, totalement indifférent à leur présence parce que c’est vous qu’il a repéré et dont il va faire sa victime. Alors le gars qui pue, c’est pareil : juste à côté de vous ! Et d’une séance à l’autre, vous aurez le choix entre une bonne vieille fragrance de sueur bien acide ou un pull que son propriétaire a méthodiquement roulé dans un gros cendrier plein juste avant de vous rejoindre. Remarquez, c’est comme le parfum… Je pense être très souvent victime de maniaques du vaporisateur qui, sachant qu’ils vont me trouver dans la salle de cinéma, s’aspergent sauvagement avant de venir se poser au plus près de moi. D'où l'idée que mon charme naturel a des limites...
Scène 2
La tête qui dépasse… Comme je l’ai écrit un peu plus haut, je ne fréquente guère les usines à popcorn – même s’il m’arrive parfois de m’y rendre – ce qui, en d’autres termes, signifie que j’ai plutôt tendance à me vautrer dans des salles obscures appartenant à une autre époque que la nôtre, dite moderne, d’où vous ne devrez pas conclure qu’elles sont sales et poussiéreuses, loin de là, mais que leur agencement est propice à bien des gênes (à ce sujet, durant toute l’histoire de la construction des cinémas, il semblerait que personne n’ait un jour imaginé une disposition des sièges en quinconce…). Et la première d’entre elles, c’est la grosse tête ! Oh qu’elle m’énerve celle-là ! Vous avez repéré un film qui n’intéressera pas grand monde, vous décidez d’aller le voir un dimanche soir, vers 19 heures, au plus creux de la fréquentation hebdomadaire et lorsque vous arrivez au cinéma, vous constatez avec bonheur que moins d’une douzaine de pékins ont eu la même idée que vous. Génial ! Vous choisissez votre place, pas trop loin, pas trop près, plutôt au milieu de la rangée et vous savourez d’avance le plaisir de regarder votre film bien tranquille. Et toc ! Le géant vert a décidé d’arriver à la dernière minute et de se caler confortablement dans le seul siège qu’il n’aurait même pas dû voir : celui qui, pile poil, est devant le vôtre… Saloperie, plus moyen de se décaler car les places à côté sont encombrées des manteaux des autres occupants. Ah, zut ! Et que je dois me tordre le cou, me pencher sur le côté pendant que l’autre là, devant, parfaitement inconscient du mal qu’il répand, se fiche éperdument de son entourage qu’il domine de toutes façons de la tête et des épaules. Ah c’est chiant ces types-là ! Et je ne parle pas de celle qui va se pointer avec une coiffure hirsute, trente centimètres de haut voire plus, les poils bien dressés sur le sommet du crâne, comme s’il était nécessaire de se déguiser ainsi pour venir s’installer dans le noir alors que personne ne vous voit, sauf le couillon qui est juste derrière.
Scène 3
Les filles qui viennent à plusieurs et qui jacassent : ah, oui, celles-là, je les adore ! Y a rien à faire, il faut absolument qu’elle viennent au minimum par grappes de trois, elles n’en finissent pas de s’installer, et que je vais m’asseoir là, ah ben non, plutôt toi, moi je me décale d’un siège, prends ma place. Euh, ça vous ennuie de vous décaler parce qu’on est douze et comme ça, on pourra rester ensemble ? Et quand tout ce petit monde est, enfin, assis, voilà que ça se relève pour ôter son manteau, son écharpe, son pull ou je ne sais quoi d’autre, comme si l’opération avait été rigoureusement impossible à envisager au moment de leur arrivée. Mais le pire est à venir ! Vous pensez en avoir fini avec cet aréopage bavard quand vous devez vous rendre à l’évidence : les demoiselles devant vous, vous pouvez en être certain, elles ne se sont pas vues depuis au moins cinq ans ! Incroyable le nombre de trucs qu’elles ont à se raconter. Notez bien que dans ces cas-là, moi j’écoute pas ! J’entends, bien malgré moi et je suis obligé de tout savoir sur la famille, l’ex-mari, le copain, le repas de midi mal digéré, les collègues de bureau qui, forcément, leur font des misères. Elles n’ont rien à dire mais qu’est-ce qu’elles le racontent longtemps…
Scène 4
Le crétin qui se rhabille pendant une heure pendant que vous faites des contorsions pour essayer d’entrevoir le générique. Oui c’est vrai, moi, j’aime bien regarder le générique jusqu’au bout, oui oui, jusqu’au moment où l’on découvre avec impatience les lieux du tournage, tous les sponsors à remercier, le titre de toutes les chansons avec le nom des interprètes et l’année de sortie du disque. Le sommet de cette quête, c’est la marque de la pellicule ! C’est tout de même essentiel, non ? Alors pourquoi faut-il qu’il y ait toujours un abruti qui choisisse ce moment privilégié pour se lever, procéder à quelques étirements musculaires interminables et prendre tout son temps pour se rhabiller sans imaginer une seule seconde qu’il n’est pas dans son salon ? Et quand il a fini, voyant que ses voisins ou voisines de rangée n’ont pas encore bougé, le mec, il attend. Debout. Tranquille. Et moi, je suis derrière, plié en deux, allongé ou presque sur ma voisine ou mon voisin qui tente un mouvement symétrique pour lire elle aussi toutes les vitales mentions. Et pan, on se cogne la tête à cause de ce type qui s’en moque éperdument. Tout ça parce qu’il n’a pas compris qu’un film, un vrai, c’est un tout. Le mec-là, il doit être du genre, lorsqu’il est invité à dîner, à se pointer après les entrées et à repartir avant le dessert, sous prétexte qu’il n’aime que la viande.
Scène 5
Le voisin (ou la voisine) qui s’étale et occupe tout l’accoudoir. Je n’ai rien contre les personnes à forte corpulence (on ne doit plus dire qu’ils sont gros), non, vraiment rien. Maîtriser son physique suppose suffisamment de chance pour qu’on ait le devoir de ressentir le maximum de compassion à l’égard de ceux qui sont victimes d’obésité. Mais tout de même, une fois de temps en temps, changez de voisin ! Pourquoi moi ? Pourquoi faut-il que vous me choisissiez, moi, comme partenaire et que, comme si j’étais invisible – je suis mince, certes, mais ne me dites pas que vous ne m’avez pas vu – vous vous octroyiez le droit d’accaparer tout l’accoudoir alors que la moitié me revient naturellement. Tu parles, c’est commode après, faut se pousser de l’autre côté et solliciter votre voisin pour une opération rapprochement contrainte. Qu’il acceptera bien volontiers d’ailleurs, d’autant qu’il est lui-même souvent la victime d’un encombrant voisin qui va le pousser à entreprendre la même manœuvre dans l'autre sens. Pas grave en fait, on se tient bien chaud et on profite mieux du film, sauf si notre tortionnaire – Ô malchance – a sombré dans les bras de Morphée et commence à ronfler… Mais c’est une autre histoire !
Scène 6
L’abruti qui téléphone. Quand j’arrive dans une salle de cinéma, tel le chien de Pavlov, je suis animé de manière automatique d’un mouvement consistant à plonger la main dans ma poche droite pour en extirper et éteindre mon téléphone. Normal. Mais pas normal pour tout le monde, si j’en crois les quelques énergumènes qu’il nous est arrivé de débusquer de temps à autre. D’un seul coup, vous entendez le type devant vous qui parle. Ce qui prouve que dans sa grande mansuétude, il vous aura tout de même épargné sa sonnerie. Et là, il se met à parler comme s’il était seul au monde en vous regardant d’un air stupide et ravi lorsque vous lui suggérez de couper court à cette conversation qui n’intéresse personne et qui, de toutes façons, est totalement dénuée d’intérêt. Encore que… elle vous aura au moins appris une chose essentielle, c’est ce que type, là, avec son machin collé à l’oreille, il est au cinéma. Donc, vous aussi, ça peut toujours être utile de le savoir. Oui, parce qu’il n’arrête pas de répéter à son correspondant : « Je suis au cinéma, je suis au cinéma ». Et l’on suppose qu’à l’autre bout du fil se trouve quelqu’un qui lui aura posé cette question vitale : « T’es où ? ». Je passerai ici sous silence les dépendants du SMS qui, toutes les trois minutes, se mettent à répondre aux messages qu’ils reçoivent et nous font profiter d’un contre éclairage qui vous donnerait envie de vous lever, d’attraper leur téléphone et de le fracasser en mille morceaux en le piétinant jusqu’à ce qu’il disparaisse complètement. Mais on me dit que ce ne serait pas cinématiquement correct.
Scène 7
Celui ou celle qui fouille pendant de longues minutes dans un sac en plastique qui fait du bruit. Oh que c’est pénible ça ! Oh que c’est pénible ! Je n’arrive pas à comprendre pourquoi autant de gens viennent au cinéma armés de redoutables emballages et autres sacs en plastique ou, pire, en papier, dans lesquels ils fouinent pendant d’interminables minutes dès lors que la salle est plongée dans l’obscurité. Vous me rétorquerez que tant qu’il fait jour, ils éprouvent moins de difficultés à trouver ce qu’ils cherchent. OK, mais répondez donc à cette question : que cherchent-ils ? Pourquoi éprouvent-ils ce besoin pressant de prendre en main ce je ne sais quoi qui, c’est mécanique, se trouve justement au fond du sac et reste introuvable ? Signalons à ce sujet que votre plaisir sera par ailleurs décuplé quand votre voisin aura enfin trouvé l’objet de sa quête - qui se trouve souvent être un bonbon bien emballé dans un papier à haut volume sonore - et l’aura enfourné avant de le sucer bruyamment, la bouche ouverte. Croyez-moi, il faut être chanceux pour avoir le privilège d’un tel spectacle. Je fais partie des heureux élus, vous l’aurez compris.
Scène 8
Ceux qui causent jusqu’à ce que le générique de début soit fini et qui recommencent dès le début du générique de fin. J’ai expliqué un peu plus haut quel était mon bonheur de me repaître des moindres détails des génériques, de début comme de fin. C’est mon droit et je crois ne nuire à personne en savourant le moindre des détails technico-pratiques qui font qu’un film est une petite entreprise pour laquelle travaillent un grand nombre de corps de métiers. Mais on dirait parfois que je suis le seul… Ah qu'ils sont énervants les bavards ultimes, et patati et patata et c'est reparti pour l'exposition gratuite de scènes familiales dont on n'a rien à faire. Oh ben on a vraiment bien mangé à midi et puis la Claudine elle est passée à la maison. Mais nom d'un chien, c'est vraiment obligatoire de parler aussi fort, vous avez vu que votre voisin de fauteuil, il a placé une oreille juste à côté de vous. C'est vraiment impossible de lui susurrer vos histoires ? Non, apparemment, il semble acquis que tout le monde va en profiter. On a beau, une fois de temps en temps, fusiller le logorrhéique d'un regard noir, rien n'y fait, le moulin à paroles est enclenché jusqu'à l'extrême limite. La limite, c'est quand la dernière lettre du générique s'est affichée et encore... si le film commence par une scène assez sonore, le bavard va en profiter pour terminer son récit... qu'il reprendra là où il l'avait arrêté au moment même où il apercevra le mot fin. Et avec un peu de chance, s'il est devant vous, peut-être vous fera-t-il profiter de l'exercice décrit à la scène 4...
Scène 9
Le retardataire qui fait déplacer toute une rangée parce qu’il a décidé de s’asseoir ici et pas ailleurs. Eh oui, c'est un spécimen assez courant celui-là... Allez savoir pourquoi, alors que les deux tiers des fauteuils sont inoccupés, notre ami va décider que SA place était celle-là et pas une autre. Manque de bol, le siège visé se trouve inéluctablement sur ma rangée et qui se trouve correspondre au choix de pas mal d'autres personnes. Donc, pendant que monsieur (et parfois monsieur et madame) nous met au garde à vous et passe ses troupes en revue, vous voilà, debout, plaqué contre l'assise relevée de votre siège, tenant d'une main le manteau que vous aviez méticuleusement plié sur vos genoux et de l'autre le reste de vos affaires. Évidemment, la corpulence du nouvel arrivant vous obligera parfois à vous contracter jusqu'aux limites du supportable, vous retenez votre souffle car vous n'êtes pas forcément en harmonie avec les choix olfactifs des nouveaux passagers et... ouf ! Vous vous effondrez à nouveau, scrutant les sièges voisins et comptant ceux qui restent vides pour estimer la probabilité de renouveler l'opération avant le début de la séance.
Scène 10
Les porcs entrent en action. Attention, ils disposent d'armes très redoutables : des bidons pleins de popcorn et des citernes de soda à la couleur marron très très foncée et aux bulles rotifères. Je précise toutefois que ces goinfres bruyants ne peuvent exercer leur talent que dans un seul des cinémas que je fréquente, les deux autres ayant toujours refusé de céder à la pression des marchands de kilos. C'est tout de même bizarre cette habitude d'engloutir toutes ces cochonneries dans le noir et d'afficher un air béat marquant l'évidente fierté d'appartenir au monde moderne. On va au cinéma pour voir un film, nom d'un chien, pas pour bâfrer comme un animal... Mais revenons à nos gloutons ! Attention, âmes sensibles s'abstenir. Car le supplice pourra être de longue durée, voire s'éterniser jusqu'à la fin du film. Dommage qu'on n'ait pas encore inventé les boules Quiès sélectives, celles qui vous isoleraient des bruits parasites et laisseraient passer la bande son du film. Vous, vous êtes assis, tranquillement, vous attendez votre instant chéri, celui du film. Et voilà qu'une main indélicate commence à fourrager tout au fond du bidon de maïs éclaté. Oui oui, au fond car je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le goinfre ne va jamais manger le popcorn qui se trouve en haut de sa gamelle, mais bien celui qui est au-dessous. Il plonge comme un fou furieux, tourne, retourne et mélange longuement avant d'ouvrir en grand son bec affamé et de mastiquer bruyamment, bouche ouverte bien sûr. Ah on sait qu'il mange le cochon et il ne vous laisse guère de répit. Ou plutôt, vous croyez souvent qu'il en a enfin fini avec son goûter mais non. Il se ménage des pauses, il savoure, il salive en prenant son temps ; vous espérez dix fois que son repas est terminé, qu'il va s'assoupir et somnoler tranquillement et pan ! au moment où vous aviez acquis la certitude de sa sieste, enfin tranquille, il réitère, le salopard. Un récidiviste du pourléchage de babines... Et ça fouille, et ça fouine, et ça touille et scrooountch scrouuuuntchscrouuuuntch scrouuuuntch. Bien sûr, toute cette pitance finit par dessécher son palais et vous allez maintenant profiter amplement de l'aspiration du soda. La paille étant bien calée entre les trois cents glaçons (qui lui auront été vendus au prix fort), c'est le gargouillis maximum, jusqu'à dernière goutte, vous avez à vos côtés les Chutes du Niagara inversées ! Chanceux que vous êtes, pour le prix d'un ticket de cinéma, vous aurez en plus voyagé en de lointaines et sauvages contrées, celles de nos plus charmants concitoyens.
Scène 11
Le petit pépé qui se fait raconter le film par sa femme, parce qu’il n’entend plus très bien. C'est bien, très bien même, sur la fin de sa vie, de conserver suffisamment d'énergie pour s'extraire de son chez soi, et renoncer aux automatismes télévisuels pour décider d'aller voir un bon film. Seulement voilà... j'ai remarqué que mes voisins âgés ont une fâcheuse tendance à être un peu durs de la feuille. Le hic, c'est quand ils viennent en couple... "Qu'est-ce qu'il a dit ?" Et mamy, forcément, doit répéter la dernière phrase à son papy qui, parfois, a besoin qu'elle lui répète une fois encore. Remarquez, c'est bien pour moi hein ? Je suis toujours certain de ne rien perdre d'essentiel mais j'éprouve souvent une drôle de vertige avec cette double bande son. Heureusement, les exploitants des salles de cinéma ont bien compris l'enjeu et savent vous massacrer les oreilles en vous assénant, souvent, un niveau sonore à la limite du supportable. Un grand merci à eux.
Scène 12
La petite mémé qui reconnaît un acteur (ou une actrice) mais qui ne retrouve plus son nom. D'ailleurs, il est fort possible qu'elle soit la femme du petit pépé de la scène 11... Elle regarde beaucoup la télé, elle doit lire tous les grands magazines avec tous les programmes et les mots fléchés, il n'est même pas impossible qu'elle se cultive en apprenant par cœur quelques revues spécialisées dans la vie des pipeuls... Elle connaît tous les acteurs, toutes les actrices. Seulement, le gros hic, c'est que sa mémoire visuelle n'est pas toujours raccord avec sa mémoire des noms et quand un tel ou un tel apparaît à l'écran... Raah, zut de zut : "Mais qui c'est çui là ?" "Ah, je sais comment il s'appelle mais ça me revient pas". Vous, évidemment, vous le savez son nom, mais comme vous êtes bien élevé, vous ne vous immiscez pas dans les conversations des autres et vous la laissez chercher. Attention, ça va venir... ah ben non, elle trouve pas, voilà un quart d'heure qu'elle cherche et entretemps, elle a perdu le fil et demande à papy de lui résumer les dernières minutes. Pour vous, ce n'est guère plus facile car vous devez maintenir votre niveau de concentration intact sans pouvoir résister au plaisir de ce "Questions pour un champion" improvisé, vous vous imaginez soudain transformé en un Julien Lepers des salles obscures, brandissant vos petites fiches jaunes cartonnées et donnant la bonne réponse à votre voisine qui, bien sûr, vous certifierait qu'elle l'avait bien donnée. "Ah je le savais..."
Bien sûr, cette rapide galerie est incomplète, je suis persuadé que, très vite, un nouveau personnage va venir l'enrichir. Il est vrai aussi que je ne passe pas tout mon temps à scruter les travers de mes contemporains et que je ne m'attache qu'à la seule description de mes voisins de fauteuil les plus proches. Mais avouez-le donc, vous en avez déjà croisé quelques uns qu'il vous sera possible de ranger dans l'une ou l'autre de ces douze petites boîtes.
Bon, c'est pas le tout de raconter des bêtises... Mais on va voir quoi, ce soir ?
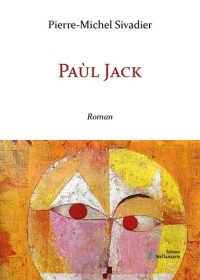 Je me pose souvent, sans doute plus que de raison, la question de la légitimité. N’étant pas musicien, mais un simple récepteur, ai-je le droit d’écrire dans le but d’évoquer un disque à des fins de « chronique » ? Qui suis-je pour oser ? Parce qu’il y aura forcément quelqu’un·e qui dira mieux et de façon plus juste. J’en suis certain. Alors quand il s’agit d’un livre, comment pourrais-je avoir l’outrecuidance de glisser quelques lignes qui ne demandent qu’à être délaissées au profit d’autres, plus belles, plus riches ? Tout cela m’a traversé l’esprit, insidieusement, au moment où j’ai reçu Paùl Jack, le roman de Pierre-Michel Sivadier paru aux belles éditions bretonnes Stella Maris. Loin d’être un inconnu, cet artiste – chanteur, pianiste, compositeur, poète – a entre autres expériences côtoyé Christian Vander et Offering. Si, son troisième disque en 25 ans, est à cet égard un moment singulier, tout comme ses deux précédents rendez-vous, empreint d’une beauté amoureuse, tourmentée et onirique. C’est d’ailleurs ce que je me suis efforcé d’expliquer dans le magazine Citizen Jazz.
Je me pose souvent, sans doute plus que de raison, la question de la légitimité. N’étant pas musicien, mais un simple récepteur, ai-je le droit d’écrire dans le but d’évoquer un disque à des fins de « chronique » ? Qui suis-je pour oser ? Parce qu’il y aura forcément quelqu’un·e qui dira mieux et de façon plus juste. J’en suis certain. Alors quand il s’agit d’un livre, comment pourrais-je avoir l’outrecuidance de glisser quelques lignes qui ne demandent qu’à être délaissées au profit d’autres, plus belles, plus riches ? Tout cela m’a traversé l’esprit, insidieusement, au moment où j’ai reçu Paùl Jack, le roman de Pierre-Michel Sivadier paru aux belles éditions bretonnes Stella Maris. Loin d’être un inconnu, cet artiste – chanteur, pianiste, compositeur, poète – a entre autres expériences côtoyé Christian Vander et Offering. Si, son troisième disque en 25 ans, est à cet égard un moment singulier, tout comme ses deux précédents rendez-vous, empreint d’une beauté amoureuse, tourmentée et onirique. C’est d’ailleurs ce que je me suis efforcé d’expliquer dans le magazine Citizen Jazz.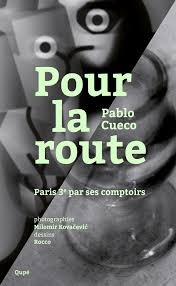 Pour une fois, je ne vous parlerai pas de musique. Même si l’auteur de Pour la route est aussi un magnifique percussionniste, joueur de zarb plus précisément. Le Corrézien Pablo Cueco, puisqu’il s’agit de lui, est aussi une très belle plume. Peut-être vous rappelez-vous qu’il n’y a pas si longtemps, le 16 mai, je l’avais évoqué ici-même dans mon Carnet de Notes à la faveur de la parution d’un album de toute beauté :
Pour une fois, je ne vous parlerai pas de musique. Même si l’auteur de Pour la route est aussi un magnifique percussionniste, joueur de zarb plus précisément. Le Corrézien Pablo Cueco, puisqu’il s’agit de lui, est aussi une très belle plume. Peut-être vous rappelez-vous qu’il n’y a pas si longtemps, le 16 mai, je l’avais évoqué ici-même dans mon Carnet de Notes à la faveur de la parution d’un album de toute beauté :  C'était il y a très longtemps. J'étais jeune, quelque part entre la sortie de l'enfance et l'entrée dans cette période trouble qu'on nomme adolescence... À cette époque, j'avais d'abord caressé l'espoir de devenir un guitar hero : les exemples vinyliques ne manquaient pas et le té en bois dont on m'avait imposé le recours pour d'erratiques cours de technologie au collège m'avaient permis de pousser hors de la scène un John Fogerty ou un Eric Clapton au meilleur de leur forme. Toutefois, ma gestuelle silencieuse avait vite trouvé ses limites lorsqu'après avoir emprunté à plusieurs reprises la (vraie) guitare de ma sœur qui, me semble-t-il, n'en a jamais fait un usage beaucoup plus intensif que le mien, malgré quelques tentatives risquées de l'ascension du sommet technique que constitue « Jeux Interdits » pour tous les gratteux, je m'étais rendu compte que la pratique régulière de cet instrument était fort douloureuse pour les doigts. Les miens en tous cas, car pour les autres, je ne sais pas... Un camarade de classe, plus obstiné que moi, avait de son côté fini par me convaincre que l'apprentissage d'une six cordes risquait fort de s'apparenter à un vrai de chemin de croix, repoussant ainsi dans les limbes de ma rêverie mes pauvres ambitions musicales.
C'était il y a très longtemps. J'étais jeune, quelque part entre la sortie de l'enfance et l'entrée dans cette période trouble qu'on nomme adolescence... À cette époque, j'avais d'abord caressé l'espoir de devenir un guitar hero : les exemples vinyliques ne manquaient pas et le té en bois dont on m'avait imposé le recours pour d'erratiques cours de technologie au collège m'avaient permis de pousser hors de la scène un John Fogerty ou un Eric Clapton au meilleur de leur forme. Toutefois, ma gestuelle silencieuse avait vite trouvé ses limites lorsqu'après avoir emprunté à plusieurs reprises la (vraie) guitare de ma sœur qui, me semble-t-il, n'en a jamais fait un usage beaucoup plus intensif que le mien, malgré quelques tentatives risquées de l'ascension du sommet technique que constitue « Jeux Interdits » pour tous les gratteux, je m'étais rendu compte que la pratique régulière de cet instrument était fort douloureuse pour les doigts. Les miens en tous cas, car pour les autres, je ne sais pas... Un camarade de classe, plus obstiné que moi, avait de son côté fini par me convaincre que l'apprentissage d'une six cordes risquait fort de s'apparenter à un vrai de chemin de croix, repoussant ainsi dans les limbes de ma rêverie mes pauvres ambitions musicales.
 Elle avait poussé la porte vitrée du studio d’un coup d’épaule franc dont l’efficacité témoignait chez elle d’une habitude prise depuis de longues années d’itinérance et de tournées, entrant comme toujours à reculons dans la longue pièce aux murs lambrissés pour tracter avec plus de facilité son instrument dont les dimensions n’avaient jamais été pour elle un obstacle, une aisance dans le déplacement qu’elle n’attribuait pas à sa haute stature grâce à laquelle elle pouvait regarder la plupart de ses homologues mâles droit dans les yeux, ce dont elle ne se privait pas, mais plutôt à sa volonté de se frayer un passage – avec une très nette préférence pour la ligne droite, car elle était d’une franchise et d’une sincérité désarmantes – en toutes circonstances, musicales ou humaines, et d’imprimer à sa vie la direction qu’elle souhaitait lui donner quel qu’en soit le prix à payer parfois et les inimitiés que son indépendance farouche et son esprit libertaire lui valaient de temps à autre, une singularité revendiquée que dénonçaient à intervalles réguliers une poignée de condisciples bousculés par la spontanéité et l’originalité de l’œuvre qu’elle élaborait avec une patience infinie depuis plus de deux décennies, presqu’un quart de siècle, accumulant dans le sourire de sa quarantaine assumée des collaborations entreprises avec une kyrielle de noms prestigieux, praticiens de toutes sortes d’instruments et pourvoyeurs des teintes multicolores qu’elle recherchait avec obstination depuis ses premiers émois musicaux, autant de célébrités de renommée européenne, voire mondiale, qu’elle brandissait à la façon de trophées, comme un signe de victoire adressé à ses contempteurs aigris, ceux-là même qu’elle savait renvoyer sans ménagement dans la grisaille de leur conformisme et de leur train-train lorsqu’ils pointaient non sans un mépris misogyne la disparition chez elle de toute forme de mélodie au profit d’une exploration sans fin des possibilités sonores de sa compagne géante, quand ils moquaient cette Isabelle Cruz, contrebassiste insoumise, grande gueule volontiers potache à la chevelure ébouriffée, admiratrice du mouvement punk et des Sex Pistols, dont la plupart des autres musiciens, ceux qu’elle nommait ses pairs, en prenant à chaque fois le soin d’en épeler les lettres : P-A-I-R-S, connaissaient la générosité et l’enthousiasme, et qui l’admiraient d’avoir su, dans ce cercle trop souvent masculin, inventer un univers musical si singulier que les spécialistes avaient fini par le qualifier d’idiome Cruz, un langage immédiatement identifiable en raison de sa construction par sédimentation de murmures, de crissements, de percussions, de grognements et d’appels lancinants, avec ou sans archet, parfois avec les poings, une sorte de cri d’abord contenu dont l’inévitable explosion était pour elle, femme politiquement engagée, sœur des démunis, le symbole d’un espoir et d’une libération dans ce monde finissant, soumis aux dictatures gestionnaires et à l’influence d’une minorité détentrice de la plus grande partie de ses richesses, où les humains étaient objets plus que sujets, un chant de l’âme dont chaque son était pensé comme la transcription d’une émotion, parmi toutes celles auxquelles femmes et hommes savaient vibrer, en véhiculant autant de joie que de peine, de douleur que de légèreté, tout cela avait fini par devenir son ADN musical au service duquel elle mettait la lascivité d’un corps-à-corps avec cette contrebasse, son amie la plus fidèle qu’il lui était impossible de quitter pendant plus d’une demi-journée, cette compagne qu’elle traînait partout avec elle, nichée dans sa gangue de cuir fauve, comme dans ce studio où l’attendaient les trois musiciens de Freedom Now !, sa formation du moment – un batteur, une guitariste et un vibraphoniste – une femme et deux hommes qui, après l’avoir saluée par une accolade mêlant respect, amitié et tendresse, l’observaient patiemment lorsqu’elle se préparait, s’assouplissait les doigts et s’imposait un long silence, parce qu’ils étaient eux déjà prêts à en découdre avec une sacrée musicienne, cette instrumentiste indomptable dont le masque pouvait changer en une fraction de seconde et, après le regard noir, afficher un sourire extatique, au moment précis où, comme elle aimait le dire, elle entrait en musique avec ce trio de combat, partenaires attentifs à son furtif signe de tête, le geste annonciateur d’une lutte sans merci et de sa quête de l’inouï, ce temps si particulier où tout disparaissait autour d’elle pour ne laisser place qu’à un cri d’amour autant que d’exultation, les yeux levés vers le ciel, dans un regard de défi lancé à ses ennemis invisibles qu’un jour, elle n’en doutait pas, elle dominerait par la seule force de son art.
Elle avait poussé la porte vitrée du studio d’un coup d’épaule franc dont l’efficacité témoignait chez elle d’une habitude prise depuis de longues années d’itinérance et de tournées, entrant comme toujours à reculons dans la longue pièce aux murs lambrissés pour tracter avec plus de facilité son instrument dont les dimensions n’avaient jamais été pour elle un obstacle, une aisance dans le déplacement qu’elle n’attribuait pas à sa haute stature grâce à laquelle elle pouvait regarder la plupart de ses homologues mâles droit dans les yeux, ce dont elle ne se privait pas, mais plutôt à sa volonté de se frayer un passage – avec une très nette préférence pour la ligne droite, car elle était d’une franchise et d’une sincérité désarmantes – en toutes circonstances, musicales ou humaines, et d’imprimer à sa vie la direction qu’elle souhaitait lui donner quel qu’en soit le prix à payer parfois et les inimitiés que son indépendance farouche et son esprit libertaire lui valaient de temps à autre, une singularité revendiquée que dénonçaient à intervalles réguliers une poignée de condisciples bousculés par la spontanéité et l’originalité de l’œuvre qu’elle élaborait avec une patience infinie depuis plus de deux décennies, presqu’un quart de siècle, accumulant dans le sourire de sa quarantaine assumée des collaborations entreprises avec une kyrielle de noms prestigieux, praticiens de toutes sortes d’instruments et pourvoyeurs des teintes multicolores qu’elle recherchait avec obstination depuis ses premiers émois musicaux, autant de célébrités de renommée européenne, voire mondiale, qu’elle brandissait à la façon de trophées, comme un signe de victoire adressé à ses contempteurs aigris, ceux-là même qu’elle savait renvoyer sans ménagement dans la grisaille de leur conformisme et de leur train-train lorsqu’ils pointaient non sans un mépris misogyne la disparition chez elle de toute forme de mélodie au profit d’une exploration sans fin des possibilités sonores de sa compagne géante, quand ils moquaient cette Isabelle Cruz, contrebassiste insoumise, grande gueule volontiers potache à la chevelure ébouriffée, admiratrice du mouvement punk et des Sex Pistols, dont la plupart des autres musiciens, ceux qu’elle nommait ses pairs, en prenant à chaque fois le soin d’en épeler les lettres : P-A-I-R-S, connaissaient la générosité et l’enthousiasme, et qui l’admiraient d’avoir su, dans ce cercle trop souvent masculin, inventer un univers musical si singulier que les spécialistes avaient fini par le qualifier d’idiome Cruz, un langage immédiatement identifiable en raison de sa construction par sédimentation de murmures, de crissements, de percussions, de grognements et d’appels lancinants, avec ou sans archet, parfois avec les poings, une sorte de cri d’abord contenu dont l’inévitable explosion était pour elle, femme politiquement engagée, sœur des démunis, le symbole d’un espoir et d’une libération dans ce monde finissant, soumis aux dictatures gestionnaires et à l’influence d’une minorité détentrice de la plus grande partie de ses richesses, où les humains étaient objets plus que sujets, un chant de l’âme dont chaque son était pensé comme la transcription d’une émotion, parmi toutes celles auxquelles femmes et hommes savaient vibrer, en véhiculant autant de joie que de peine, de douleur que de légèreté, tout cela avait fini par devenir son ADN musical au service duquel elle mettait la lascivité d’un corps-à-corps avec cette contrebasse, son amie la plus fidèle qu’il lui était impossible de quitter pendant plus d’une demi-journée, cette compagne qu’elle traînait partout avec elle, nichée dans sa gangue de cuir fauve, comme dans ce studio où l’attendaient les trois musiciens de Freedom Now !, sa formation du moment – un batteur, une guitariste et un vibraphoniste – une femme et deux hommes qui, après l’avoir saluée par une accolade mêlant respect, amitié et tendresse, l’observaient patiemment lorsqu’elle se préparait, s’assouplissait les doigts et s’imposait un long silence, parce qu’ils étaient eux déjà prêts à en découdre avec une sacrée musicienne, cette instrumentiste indomptable dont le masque pouvait changer en une fraction de seconde et, après le regard noir, afficher un sourire extatique, au moment précis où, comme elle aimait le dire, elle entrait en musique avec ce trio de combat, partenaires attentifs à son furtif signe de tête, le geste annonciateur d’une lutte sans merci et de sa quête de l’inouï, ce temps si particulier où tout disparaissait autour d’elle pour ne laisser place qu’à un cri d’amour autant que d’exultation, les yeux levés vers le ciel, dans un regard de défi lancé à ses ennemis invisibles qu’un jour, elle n’en doutait pas, elle dominerait par la seule force de son art.

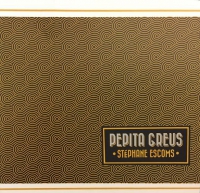 La réminiscence comme source de création... Proust l’a sublimée, par l’évocation d’une madeleine ou de pavés disjoints. Il en va de même en musique comme dans toute forme d’art et c’est la sollicitation de la mémoire qui a provoqué chez Stéphane Escoms le besoin d’un retour aux sources. Ainsi a vu le jour Pepita Greus.
La réminiscence comme source de création... Proust l’a sublimée, par l’évocation d’une madeleine ou de pavés disjoints. Il en va de même en musique comme dans toute forme d’art et c’est la sollicitation de la mémoire qui a provoqué chez Stéphane Escoms le besoin d’un retour aux sources. Ainsi a vu le jour Pepita Greus.


 Je vais reculer les aiguilles de la grande horloge et vous parler d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Nous sommes le mercredi 13 décembre 1972. Je suis en possession d'un précieux billet dont la valeur - cent francs ! - est considérable pour qui la rapportera au montant de mes émoluments mensuels de l’époque, en d'autres termes mon argent de poche, soit cinq francs. Me voici prêt à engager une dépense déraisonnable qui hante mes rêves depuis plusieurs semaines déjà. Mais je vais un peu trop vite... Revenons d'abord à un autre jour, un jeudi celui-là, le 27 janvier de cette même année 1972. J’en profite pour rappeler aux plus jeunes qu'en ces temps préhistoriques, on n'allait pas au collège le jeudi après-midi ; c’est l’année suivante seulement que fut instaurée la pause hebdomadaire du mercredi pour les scolaires.
Je vais reculer les aiguilles de la grande horloge et vous parler d'un temps que les moins de 50 ans ne peuvent pas connaître. Nous sommes le mercredi 13 décembre 1972. Je suis en possession d'un précieux billet dont la valeur - cent francs ! - est considérable pour qui la rapportera au montant de mes émoluments mensuels de l’époque, en d'autres termes mon argent de poche, soit cinq francs. Me voici prêt à engager une dépense déraisonnable qui hante mes rêves depuis plusieurs semaines déjà. Mais je vais un peu trop vite... Revenons d'abord à un autre jour, un jeudi celui-là, le 27 janvier de cette même année 1972. J’en profite pour rappeler aux plus jeunes qu'en ces temps préhistoriques, on n'allait pas au collège le jeudi après-midi ; c’est l’année suivante seulement que fut instaurée la pause hebdomadaire du mercredi pour les scolaires.

 Petros Klampanis, jeune contrebassiste établi à New York, publie Minor Dispute, son deuxième album après Contextual en 2011 qui avait vu le jour sur Inner Circle, le label du saxophoniste Greg Osby, avec lequel il entretient des relations étroites par ailleurs. Il revient cette fois entouré d’un trio d’enlumineurs, dans lequel évolue celui qui est peut-être le plus américain des musiciens français, le pianiste Jean-Michel Pilc, accompagné du guitariste Gilad Hekselman, musicien aux influences multiples, et du percussionniste explorateur sonore John Hadfield. Et pour enrichir une palette déjà largement pourvue en couleurs, Klampanis s’est adjoint les services d’une section de cordes (deux violons, deux altos, deux violoncelles).
Petros Klampanis, jeune contrebassiste établi à New York, publie Minor Dispute, son deuxième album après Contextual en 2011 qui avait vu le jour sur Inner Circle, le label du saxophoniste Greg Osby, avec lequel il entretient des relations étroites par ailleurs. Il revient cette fois entouré d’un trio d’enlumineurs, dans lequel évolue celui qui est peut-être le plus américain des musiciens français, le pianiste Jean-Michel Pilc, accompagné du guitariste Gilad Hekselman, musicien aux influences multiples, et du percussionniste explorateur sonore John Hadfield. Et pour enrichir une palette déjà largement pourvue en couleurs, Klampanis s’est adjoint les services d’une section de cordes (deux violons, deux altos, deux violoncelles). C’est malin, ça ! Je croule sous les disques à découvrir – toute une pile attend fiévreusement d’être accueillie par ma platine – et par la faute d’un Bourguignon que la simple vue d’une assiette de Munster flambée à l’alcool de cumin fait tourner de l'œil, me voici en train de replonger dans mes disques de Pink Floyd... Non mais vous le croyez ? Surtout que, pour ne rien vous cacher, le bougre a fait pire encore... Imaginez que jamais je n’avais acheté ni même réussi à écouter en entier un disque comme The Wall. Difficile de vous dire pourquoi, ça ne me parlait pas vraiment et puis, cette histoire un brin déprimante me donnait surtout envie de me replonger dans les albums qui avaient bercé mon adolescence, au premier rang desquels Meddle et sa deuxième face occupée par le seul « Echoes ». Pour moi, Pink Floyd, c’était une musique un peu planante, c’était aussi un concert au Parc des Expositions de Nancy au mois de décembre 1972, quand le groupe commençait la promotion de son disque à venir, un certain Dark Side Of The Moon, qui allait voir le jour quelques mois plus tard et après lequel plus rien ne serait comme avant. Un succès planétaire dont la cohésion de Pink Floyd n’allait pas se remettre.
C’est malin, ça ! Je croule sous les disques à découvrir – toute une pile attend fiévreusement d’être accueillie par ma platine – et par la faute d’un Bourguignon que la simple vue d’une assiette de Munster flambée à l’alcool de cumin fait tourner de l'œil, me voici en train de replonger dans mes disques de Pink Floyd... Non mais vous le croyez ? Surtout que, pour ne rien vous cacher, le bougre a fait pire encore... Imaginez que jamais je n’avais acheté ni même réussi à écouter en entier un disque comme The Wall. Difficile de vous dire pourquoi, ça ne me parlait pas vraiment et puis, cette histoire un brin déprimante me donnait surtout envie de me replonger dans les albums qui avaient bercé mon adolescence, au premier rang desquels Meddle et sa deuxième face occupée par le seul « Echoes ». Pour moi, Pink Floyd, c’était une musique un peu planante, c’était aussi un concert au Parc des Expositions de Nancy au mois de décembre 1972, quand le groupe commençait la promotion de son disque à venir, un certain Dark Side Of The Moon, qui allait voir le jour quelques mois plus tard et après lequel plus rien ne serait comme avant. Un succès planétaire dont la cohésion de Pink Floyd n’allait pas se remettre. Je vous ai déjà parlé de
Je vous ai déjà parlé de  J'ai reçu depuis quelque temps plusieurs témoignages de confiance et des remerciements assez émouvants qui m'interpellent vraiment. Au début de la semaine, un vieux pote amoureux de musique, travailleur acharné du partage de ses passions, me demandait l'autorisation de reproduire l'une des chroniques de mon blog dans son magazine. Hier, je recevais un message d'un pianiste qui tenait à me faire part du plaisir pris à la lecture d'un de mes textes ; il voulait m'en remercier, un comble alors que de mon point de vue, c'est plutôt moi le débiteur. Au cours de l'hiver, un autre musicien m'a sollicité, un peu dans l'urgence, pour que j'écrive le rédactionnel devant figurer sur la pochette de son nouveau disque. Un exercice de style dont j'ai essayé de m'acquitter au mieux, avec les moyens du bord, ceux de l’écriveur que je suis et dont je dispose tant bien que mal. On m'a aussi demandé si j'acceptais qu'un extrait d'une de mes chroniques figure sur le catalogue de la prochaine saison d'une salle de concert. Je travaille actuellement sur la rédaction du dossier de presse associé à la parution du disque d'un jeune guitariste. Tout récemment enfin, mon complice Jacky Joannès a relevé le défi - c’est moi qui l’ai lancé, je le reconnais - d'une prochaine exposition unissant textes et photographies ; celle-ci, programmée au mois d'octobre 2016, sera principalement consacrée aux saxophonistes et aux clarinettistes et devrait s'appeler « La part des anches ». J'ai même prévu de réaliser le petit livre de l'exposition avant qu'elle ne commence, afin de le proposer lors du vernissage.
J'ai reçu depuis quelque temps plusieurs témoignages de confiance et des remerciements assez émouvants qui m'interpellent vraiment. Au début de la semaine, un vieux pote amoureux de musique, travailleur acharné du partage de ses passions, me demandait l'autorisation de reproduire l'une des chroniques de mon blog dans son magazine. Hier, je recevais un message d'un pianiste qui tenait à me faire part du plaisir pris à la lecture d'un de mes textes ; il voulait m'en remercier, un comble alors que de mon point de vue, c'est plutôt moi le débiteur. Au cours de l'hiver, un autre musicien m'a sollicité, un peu dans l'urgence, pour que j'écrive le rédactionnel devant figurer sur la pochette de son nouveau disque. Un exercice de style dont j'ai essayé de m'acquitter au mieux, avec les moyens du bord, ceux de l’écriveur que je suis et dont je dispose tant bien que mal. On m'a aussi demandé si j'acceptais qu'un extrait d'une de mes chroniques figure sur le catalogue de la prochaine saison d'une salle de concert. Je travaille actuellement sur la rédaction du dossier de presse associé à la parution du disque d'un jeune guitariste. Tout récemment enfin, mon complice Jacky Joannès a relevé le défi - c’est moi qui l’ai lancé, je le reconnais - d'une prochaine exposition unissant textes et photographies ; celle-ci, programmée au mois d'octobre 2016, sera principalement consacrée aux saxophonistes et aux clarinettistes et devrait s'appeler « La part des anches ». J'ai même prévu de réaliser le petit livre de l'exposition avant qu'elle ne commence, afin de le proposer lors du vernissage.
 S'y asseoir, même muni d'un livre, c'est l'occasion privilégiée d'une observation tranquille de la congrégation bigarrée des passagers. Ce faisant, je me suis attelé à un petit travail consistant à scruter discrètement mes compagnons d’infortune itinérante et à noter rapidement, le soir, quelques unes des scénettes dans la contemplation – d’un œil, l’autre continuant sa lecture - desquelles j’ai pu me complaire. Si l’expérience s’avère concluante, j’envisage de rassembler ces textes après une relecture minutieuse sous la forme d’un livre qui paraîtra d’ici à deux ans.
S'y asseoir, même muni d'un livre, c'est l'occasion privilégiée d'une observation tranquille de la congrégation bigarrée des passagers. Ce faisant, je me suis attelé à un petit travail consistant à scruter discrètement mes compagnons d’infortune itinérante et à noter rapidement, le soir, quelques unes des scénettes dans la contemplation – d’un œil, l’autre continuant sa lecture - desquelles j’ai pu me complaire. Si l’expérience s’avère concluante, j’envisage de rassembler ces textes après une relecture minutieuse sous la forme d’un livre qui paraîtra d’ici à deux ans. 
 De deux choses l’une : ou vous connaissez depuis belle lurette l’étendue du talent de
De deux choses l’une : ou vous connaissez depuis belle lurette l’étendue du talent de 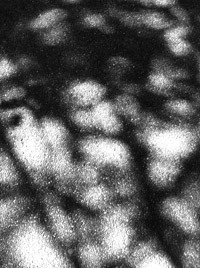 Je ne voudrais pas donner l’impression de radoter – de toutes façons, c’est probablement ce qui est train de m’arriver - mais je vais tout de même revenir une fois encore sur le récit Ladies First ! que j’ai finalement décidé de publier sous la forme d’un livre, un récit qu’on peut se procurer facilement sur Internet et plus particulièrement sur le site
Je ne voudrais pas donner l’impression de radoter – de toutes façons, c’est probablement ce qui est train de m’arriver - mais je vais tout de même revenir une fois encore sur le récit Ladies First ! que j’ai finalement décidé de publier sous la forme d’un livre, un récit qu’on peut se procurer facilement sur Internet et plus particulièrement sur le site