Lu - Page 2
-
-
Portraits de femmes en musique...
Cette fois, c’est la dernière ligne droite pour ce qui concerne ma contribution à l’exposition Ladies First, cette réalisation qui va m’associer à mon complice Jacky Joannès, selon un principe identique à celui qui avait présidé à la création de notre précédente collaboration en 2010, Portraits Croisés : à lui la photographie, à moi les textes. Une histoire de signe et d’image, en quelque sorte. L’œil et la main...
Les portraits sont choisis, leur liste est définitive (à ce niveau, je suis très peu intervenu, c’est bien normal, Jacky étant le maître à bord de son navire aux archives argentiques ou numériques) : au total, 53 musiciennes et 70 photographies, en couleur ou en noir et blanc, dont les plus anciennes remontent à 1973, date de la première édition de Nancy Jazz Pulsations, et les plus récentes à 2012. Ce sera notre manière de saluer les 40 ans du Festival (qui se déroulera du 9 au 19 octobre prochains) et de rendre hommage à son fondateur, Xavier Brocker, disparu au mois de septembre dernier et à qui Ladies First est dédié.

Lorsque j’ai lancé l’idée de cette exposition, je ne savais rien de la forme que prendrait mon travail d’écriture, c’était un nouveau défi, une autre page blanche à noircir mais de quelle manière ? Comme en 2010, écrire un court texte associé à chaque photographie ? Imaginer un accompagnement des portraits sous la forme d’une suggestion musicale ? J’ai cherché un bon bout de temps avant de penser à la rédaction d’une fiction, après avoir pratiqué un remue-méninges constant durant plusieurs semaines. Une nouvelle ! Et pourquoi pas ? Raconter quelque chose... Le plus difficile restait alors à faire : trouver une histoire en relation avec la musique, dont le sujet puisse entrer en résonnance avec le sujet choisi (des portraits de femmes en musique), la glisser si possible, même de façon indirecte, dans le contexte de Nancy Jazz Pulsations 2013... De fil en aiguille, les principaux personnages sont apparus, ils ont commencé à prendre vie, à se parler, à bâtir des projets en commun, comme si je n’étais pas là (je vous jure que c’est vrai, ces bestioles finissent par vous échapper...). C’est là que Xavier Brocker est venu s’imposer dans un rôle clé, le sien, détourné par quelques facéties de mon cru. Phénomène étrange par lequel ce qu’on croit inventer n’est en fait qu’une image floue dont on essaie de deviner les contours avant qu’ils ne se précisent, jour après jour. Et je ne peux m’empêcher de faire un parallèle entre ce travail de mise au point avec celui de Jacky lorsqu’il prend une photographie. Chacun de nous deux voit une expression ou imagine une histoire, cherche à lui donner vie par l’instantané ou au détour d’une phrase.
Je dois écrire des choses qui sont certainement des banalités pour tous ceux qui ont l’habitude d’écrire... On y reviendra plus tard, peut-être !
Le plan de cette nouvelle est défini, voici maintenant venu le temps de laisser la plume (toute virtuelle puisqu’elle prend la forme d’un clavier ou d’un écran tactile selon mon humeur) filer sous mes doigts et par là de raconter une histoire dont je ne révélerai pas le déroulement ici même si je peux en dire quelques mots : Ladies First (ce texte portera le même nom que l’exposition, pour une raison que je ne dévoilerai pas) évoquera une chanteuse dont le retour à la musique, après de longues années d’errance, sera rendu possible par le soutien d’un ancien fan persuadé que cette artiste doit surmonter les difficultés qui l’ont éloignée de la musique pour s’épanouir à nouveau. Tous les personnages de cette histoire sont fictifs, sauf Xavier Brocker, bien sûr, qui évoluera tel qu’il était dans la réalité, même si – et c’est là mon privilège – je lui confierai une mission qui est une sorte de petit nuage taquin dans le ciel de mon imagination.
Cette idée de le faire « revivre » ainsi m’est venue dans les conditions que j’ai expliquées un peu plus haut, mais j’ai tout de même éprouvé le besoin de recueillir le sentiment de sa veuve et surtout, si possible, son approbation. Je n’aurais pas voulu qu’elle découvre cette utilisation de son mari défunt au dernier moment. En lui présentant ce projet et la démarche de l’exposition (regarder les photos, lire une histoire, séparément ou au contraire dans un jeu d’alternance en déambulant d’un portrait à l’autre, chacun de ceux-ci étant illustré par une portion du texte qu’on suit de photographie en photographie), elle a eu cette remarque que je vais utiliser comme un point d’appui stimulant : « Xavier mérite bien qu’on ne l’oublie pas et que des amis lui rendent hommage de façon créative ».
Par conséquent, ce sont deux étapes qui m’attendent désormais : d’abord mettre noir sur blanc une première version du texte, la plus naturelle possible (travail des trois semaines à venir) ; ensuite la retravailler pour essayer de la sculpter au plus près d’un rythme imaginaire, celui qui accompagne mon quotidien depuis des décennies, à la façon d’un petit moteur intérieur (une seconde phase qui sera terminée à la mi-septembre).
Essayer d’éliminer le gras, muscler les phrases sans les boursoufler, impulser une part de nervosité qui sera rendue nécessaire par la lecture fractionnée dans la salle d’exposition.
Et maintenant... le trac ! La peur de ne pas être à la hauteur, d’aligner des banalités, d’exposer une histoire qui n’intéressera personne.
Alea jacta est !
-
Un souvenir sans conséquence spéciale
 J’ignore si mes plongées régulières dans A la recherche du temps perdu peuvent avoir une influence sur mes propres perceptions de la vie, de la mémoire (volontaire ou non) et plus généralement du monde qui m’entoure et, comme tout un chacun, au centre duquel j’imagine parfois me trouver alors que je n’en suis qu’une poussière. Mais au moment où je m’extrais de sa lecture pour quelques jours, au moment où les informations m’écrasent de leur violence et leur incroyable accumulation de désespoirs récités en litanie pseudo-journalistique, me reviennent en mémoire des instants à la fois douloureux et puissants. Stand By...
J’ignore si mes plongées régulières dans A la recherche du temps perdu peuvent avoir une influence sur mes propres perceptions de la vie, de la mémoire (volontaire ou non) et plus généralement du monde qui m’entoure et, comme tout un chacun, au centre duquel j’imagine parfois me trouver alors que je n’en suis qu’une poussière. Mais au moment où je m’extrais de sa lecture pour quelques jours, au moment où les informations m’écrasent de leur violence et leur incroyable accumulation de désespoirs récités en litanie pseudo-journalistique, me reviennent en mémoire des instants à la fois douloureux et puissants. Stand By...Les heures que nous vivons sont délétères : le régime politico-financier sous la dictature duquel nous vivons est, comme le dit justement mon camarade Franpi, en train de ployer. Jusqu’où ? Jusqu’à quand ? Impossible de le dire mais comment ne pas être certain que rupture il y aura, forcément. Et qu’elle sera très douloureuse : pas pour ceux qui l’auront provoquée, mais pour tous les autres, nous tous qui avons certainement manqué de lucidité pour que les choses en arrivent à ce stade et qui avons assisté, impuissants, au spectacle désolant de la rapacité cynique d’une minorité sans conscience. En France, les malversations de tous bords sont mises au jour, on essaye d’attenter d’une incroyable manière à la liberté de la presse, comme si les puissants ne connaissaient qu’une seule arme, leur drogue fatale, l’argent, pour mieux écraser toute tentative de résistance. Je ne vais pas plus loin dans un inventaire qui finirait par nous achever.
Bref, tout va mal et – c’est mon gros défaut – je trouve en la musique une alliée précieuse, une source d’énergie dont je ne saurais me passer, au-delà de l’amour de ceux qui m’entourent et qui sont à leur manière les muscles cardiaques qui me font défaut. Sans eux...
Soir d’été, bad news malgré le retour du soleil, ce grand absent, l’horizon est bouché. En quête d’un refuge, je file au deuxième étage de ma maison, sous les toits, au milieu des boiseries et, comme au temps de l’adolescence, je m’agenouille devant les rayons de ma discothèque. Quand j’étais plus jeune, je pouvais passer de longues minutes avant de choisir un disque. C’était mon plaisir, celui d’une fausse fébrilité, une sorte de prière muette faite aux musiciens qui se cachaient malicieusement sous les pochettes cartonnées et dans les sillons magiques de ces galettes noires. Mais ce soir, il en va autrement. Comme par enchantement, ma main se pose sans la moindre hésitation sur un disque auquel je me sens lié pour toujours et qui, jamais, ne me quittera. Heldon, Stand By.
Je ne vais pas me lancer ici dans la biographie de Richard Pinhas, musicien pétri de science fiction (ainsi, Norman Spinrad dans l’œuvre duquel Pinhas a trouvé le nom de son groupe), disciple de Gilles Deleuze (dont il a, si ma mémoire ne me trahit pas, retranscrit bon nombre des cours à l’université de Vincennes), amoureux de la musique de Robert Fripp et Brian Eno (mais pas seulement, on croise dans son Panthéon aussi bien Kraftwerk que Jimi Hendrix).
Si, quand même un souvenir : à l’automne 1974, j’avais entendu dans une émission de France Inter animée par Pierre Lattès une drôle de musique, curieux alliage d’électronique et d’électricité. Un truc comme je n’en avais jamais entendu, pas forcément accessible à la première écoute, mais captivant tout de suite. Un disque de Heldon, le premier, cette Electronique Guérilla où Gilles Deleuze disait « Le Voyageur » de Nietzsche. Un jour clé, ou plutôt un soir, et le début d’une passion qui ne s’est pas éteinte depuis. J’avais missionné mon frère aîné, celui qui fut mon premier guide en musique, afin qu’il me rapporte au plus vite la précieuse galette... On devine ma fébrilité. Les années ont défilé à la vitesse de la lumière mais toute cette musique est présente en moi comme au premier jour. Il y a quelques semaines encore, je recevais Desolation Row, le nouveau disque de Richard Pinhas dont bien des vibrations évoquent celles de ces premières heures foisonnantes. Ecoutez « Moog » et vous comprendrez ce que je veux dire.
Je m’adresse peut-être à des spécialistes, mais tant pis... Les autres comprendront qu’il s’agit là d’une passion.
Stand By, donc.
En 1979, ce disque m'a aidé à tenir le coup, à rester debout, à me maintenir en vie. Oui, au moins autant que toutes les médecines censées me guérir. On me donnait quelques semaines à vivre et quand je m'endormais le soir, pour me donner des forces, je l'écoutais dans ma tête parce qu'il n'y avait pas d'électrophone dans ma chambre d'hôpital, forcément. Six semaines, c’est long, malgré les amis, malgré les amours. C’est une vie glauque, froide et souvent sans espoir, faite de râles et de mauvaises odeurs, de bruits déprimés et de silences mortifères. J’ai sous le coude quelques textes qui racontent cette époque, mais je me dis qu’ils vont rester en l’état, qu’ils n’ont que peu d’intérêt. Quelques semaines plus tard, après qu’on m’ait diagnostiqué un mal non mortel, expliqué qu’il faudrait fluidifier mon sang ad vitam æternam et fait comprendre que je pouvais oublier l’annonce fatidique qu’on m’avait faite, j'ai pu rentrer chez moi et je me suis jeté, assoiffé, sur le disque pour l'écouter "en vrai". Encore et encore... J’en ai profité pour ressortir d’autres albums, comme Interface, l’autre monument de Heldon paru un an plus tôt, ou Un rêve sans conséquence spéciale, dont la noirceur, curieusement, me faisait le plus grand bien. J’avais le sentiment d’extirper le mal qui avait essayé en vain de me ronger. Richard Pinhas, Patrick Gauthier, Didier Batard, François Auger...
Le temps a passé, 34 ans déjà... et je suis toujours là (est-ce une bonne chose ?) ; tout comme ce chef d'œuvre qui continue de briller de mille feux et de me fasciner ! Sa musique est intacte, puissante, elle vous attrape à la gorge et ne vous lâche pas. Il faut la vivre, la laisser vous envahir, vous saisir. Après, rien n’est pareil...
En 2013, la grisaille règne, la médiocrité ressemble à une pandémie, il faut avoir des yeux d'enfant pour garder le sourire. Stand By est un sacré compagnon des moments difficiles, il me le prouve encore. Je ne sais pas si c'était le but recherché par Pinhas et ses complices, mais à titre personnel, j'en certifie les effets ! Je ne sais pas comment remercier ces funambules qui, sans le savoir, sont des compagnons fidèles de mon intimité et à la source desquels je puise jour après jour. Ces quelques lignes, une fois encore, leur disent merci.
-
Muziq again !
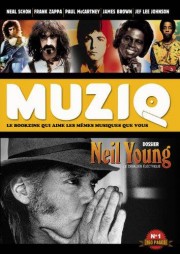 Voilà bien longtemps que je n’avais pas ressenti un tel plaisir – j’allais employer le mot confort - à la lecture d’une revue musicale. Je ne parle pas ici de mon cher Citizen Jazz, qui occupe une place particulière dans mon cœur et avec lequel ma relation de lecteur / rédacteur est fort différente de celle que je peux connaître lorsque j’empoigne n’importe quel autre magazine dont je tourne les pages.
Voilà bien longtemps que je n’avais pas ressenti un tel plaisir – j’allais employer le mot confort - à la lecture d’une revue musicale. Je ne parle pas ici de mon cher Citizen Jazz, qui occupe une place particulière dans mon cœur et avec lequel ma relation de lecteur / rédacteur est fort différente de celle que je peux connaître lorsque j’empoigne n’importe quel autre magazine dont je tourne les pages.Ce n’est pas un exercice de comparaison auquel je veux me livrer ici, j’ai simplement envie d’adresser un clin d’œil à l’équipe de rédaction de Muziq, qui renaît de ses cendres après avoir paru durant près de 5 ans entre 2004 et 2009. Le voici en effet qui revient, dans un autre format, celui d’un bookzine (entendez par là qu’il s’agit d’une publication à la croisée des chemins du livre et du magazine. Et le premier d’entre vous qui utilise le vilain terme de mook, contraction de magazine et de book, sera impitoyablement pendu par les pieds, nu, en plein soleil et badigeonné d’une épaisse couche de confiture) dont la pagination avantageuse (160 pages au total) laisse deviner la somme d’articles qu’on peut y découvrir et le temps qu’on lui consacrera. Une mine d’informations et de témoignages passionnés, relevés par une mise en page élégante et agréable à l’œil. Pas mal, non, en ces temps de crise et de téléchargement sauvage ? Voilà une entreprise plutôt courageuse qu’il faut encourager et à laquelle on a vraiment envie de souhaiter une très longue vie.
Muziq est sous-titré « Le Bookzine qui aime les mêmes musiques que vous »... Eh bien, il faut reconnaître qu’en ce qui me concerne, c’est exact : j’y retrouve mes racines (celles qui commencent à la fin des années 60) ainsi que toutes les branches qui ont pu croître au fil des décennies sur le grand arbre de mes découvertes. Rock, pop, soul music, jazz rock et bien d’autres sont au rendez-vous à travers des dossiers très volumineux (ainsi les 32 pages consacrées à Neil Young), des articles instructifs (les influences de Frank Zappa) ou cocasses (le récit d’un enregistrement impossible entre James Brown et le duo Sly Dunbar / Robbie Shakespeare), l’exégèse d’un album (Spectrum de Billy Cobham) ou des chroniques de concerts cultes des années 70 (les Rolling Stones, Gong, Who, Weather Report), un entretien (Bobby Womack). Il est aussi question du guitariste Neil Schon, de Paul Mc Cartney, de Gene Clark ou de Jeff Lee Johnson. Les rendez-vous avec certaines personnalités médiatiques sont eux-mêmes instructifs : je réalise par exemple la convergence des mes goûts musicaux avec ceux d’Alain De Greef dans huit cas sur dix (ce à quoi je ne m’attendais pas du tout) ; je m’amuse aussi à l’idée qu’un autre pilier embourgeoisé du PAF s’auto-proclame punk, ce qui ne manque pas de piquant surtout quand on apprend qu’il idéalise un chanteur sans grand intérêt autre que folklorique (ce à quoi je m’attendais)...
En d’autres termes, Muziq est une petite gourmandise hautement recommandable, dont les rédacteurs en chef Frédéric Goaty et Christophe Geudin peuvent être fiers (de même que tous les membres de l’équipe de rédaction). Je me permets de vous en conseiller la lecture, vous ne prendrez qu’un seul risque : celui de passer un bon moment. Comme je l’ai lu quelque part : « Muziq n'a pas de frontières... Rock, jazz, soul, hip-hop, folk, funk, pop, hard-rock, musiques du monde, chanson française, reggae, musique classique... » Si avec ça vous n’y trouvez pas au moins de quoi piocher et découvrir, alors là, je m’inquiéterai pour votre santé mentale.
Cerise sur le gâteau, Muziq nouvelle formule n’est pas de ces publications qu’on pose négligemment dans un porte-revue après l’avoir feuilleté. Non, c’est plutôt un compagnon de chevet, qu’on déguste – prenons le temps de lire et de faire durer le plaisir – et qu’on ira ensuite ranger parmi d’autres livres auxquels on tient. Tiens, je vois d’ici la place qu’il pourrait occuper prochainement, pas loin de la biographie de Neil Young ou de la sélection d’articles de la mythique revue Atem compilés chez Camion Blanc par l’ami Gérard N’Guyen.
J’y retourne...
PS : et j'en profite pour souhaiter un bon anniversaire à ma soeur Sylvie, qui n'a pas été autrefois sans souffir de mon voisinage d'adolescent un tantinet sur-sonorisé !
-
Une raison de plus d'aimer Coltrane…
Un billet d'humeur autour de la publication du livre que Michel Arcens vient de consacrer à un questionnement sur la vie et le jazz, en prenant pour point d'appui la musique de John Coltrane.
Je n'avais pas prévu d'écrire une note consacrée au livre de Michel Arcens appelé Coltrane, la musique sans raison (publié chez Alter Ego Éditions)… D'abord parce que l'auteur est un de mes collègues rédacteurs à Citizen Jazz et que je n'aimerais pas qu'on pense que je souhaite évoquer un livre par un simple réflexe de type corporatiste ; ensuite parce que son approche philosophique n'est pas de celles avec lesquelles je me sens très à l'aise quand il s'agit de proposer mon propre ressenti. À ce niveau, je suis totalement inculte et ce n'est jamais sans le sentiment d'accomplir un effort surhumain que j'arpente des pages habitées de concepts souvent complexes qu'il me faut lire avec la plus extrême attention.
 Mais le livre de Michel a récemment fait l'objet d'une chronique cinglante dans le dernier numéro de Jazz Magazine. Aimer, ne pas aimer, critiquer, souligner les qualités et les défauts… Jamais je ne contesterai à qui que ce soit le droit d'émettre une opinion, c'est bien entendu. Un livre, comme un disque ou toute autre objet artistique peut faire l'objet d'un débat, c'est même dans l'ordre naturel des choses. Non, ce qui me gêne dans ce texte, c'est sa tonalité blessante, voire condescendante et par là même la dose de mépris qui l'habite. Tout cela me met mal à l'aise, d'autant que pour avoir lu le livre moi-même, je flaire dans cette chronique brutale quelque chose qui s'apparente à un hors sujet, comme si le journaliste s'était attendu à une nouvelle "explication" de Coltrane. Et quand l'auteur dudit article conclut en évoquant la nouvelle que Michel Arcens propose en coda de son livre : "une petite nouvelle de son cru, unique mérite de cet ouvrage", alors franchement je trouve qu'il y a là un vilain coté "fessée" administrée par un père rigoriste à son fils trop paresseux qui m'exaspère au plus haut point. Cette manière de faire la leçon est bigrement énervante…
Mais le livre de Michel a récemment fait l'objet d'une chronique cinglante dans le dernier numéro de Jazz Magazine. Aimer, ne pas aimer, critiquer, souligner les qualités et les défauts… Jamais je ne contesterai à qui que ce soit le droit d'émettre une opinion, c'est bien entendu. Un livre, comme un disque ou toute autre objet artistique peut faire l'objet d'un débat, c'est même dans l'ordre naturel des choses. Non, ce qui me gêne dans ce texte, c'est sa tonalité blessante, voire condescendante et par là même la dose de mépris qui l'habite. Tout cela me met mal à l'aise, d'autant que pour avoir lu le livre moi-même, je flaire dans cette chronique brutale quelque chose qui s'apparente à un hors sujet, comme si le journaliste s'était attendu à une nouvelle "explication" de Coltrane. Et quand l'auteur dudit article conclut en évoquant la nouvelle que Michel Arcens propose en coda de son livre : "une petite nouvelle de son cru, unique mérite de cet ouvrage", alors franchement je trouve qu'il y a là un vilain coté "fessée" administrée par un père rigoriste à son fils trop paresseux qui m'exaspère au plus haut point. Cette manière de faire la leçon est bigrement énervante…Soyons clairs : on a pu lire par le passé bien des livres magnifiques consacrés au saxophoniste. La biographie de Lewis Porter, par exemple, qui comblera aussi bien les musiciens que les mélomanes ; Le cas Coltrane d'Alain Gerber également, autre livre référence ; et puis l'excellent ouvrage de Franck Médioni qui rassemble les témoignages, comme autant de déclarations d'amour, de 80 musiciens, sur lequel Michel Arcens s'appuie régulièrement d'ailleurs. Autant dire que le sujet Coltrane n'est pas un terrain vierge restant à défricher, que bien des exégètes se sont déjà attaqués à ce monument du jazz et qu'il en viendra certainement d'autres encore. Faut-il cependant attendre ainsi au tournant, méchamment, celui qui, à sa façon, très personnelle, presque intime, essaie de partager sa propre vision de l'existence et d'un artiste par une tentative d'analyse (ici appelée esquisse) de ce qui est pour lui le symbole de la vie et dont le jazz serait le pendant musical : l'émotion spontanée, l'évolution perpétuelle, une constante recherche et un affranchissement des genres ? Dont Coltrane, que Michel Arcens admire peut-être plus que tout autre musicien, serait l'incarnation (fugitive parce disparu bien trop tôt mais, à l'évidence, d'une admirable persistance) absolue.
Soyons clairs encore : il y a certainement des défauts dans le livre, des imperfections, des répétitions et donc parfois le sentiment de longueurs qu'on pourrait contourner. Mais celles-ci sont à comprendre comme le fruit d'une véritable quête de définitions, celle de la vie et son esthétique d'une joie philosophique, celle du jazz, et celle de la manière dont elles peuvent se croiser, voire s'enrichir mutuellement. Si un tel terrain était parfaitement balisé, alors il suffirait d'aligner deux ou trois vérités péremptoires et on n'en parlerait plus. Mais Michel Arcens choisit de questionner, se questionne, ne trouve pas toujours les réponses et c'est tant mieux. Alors il revient sur le sujet, encore et encore. C'est sa propre expérience humaine qu'il nous livre, sans jamais prétendre à autre chose qu'une exploration philosophique dont Coltrane est chez lui le catalyseur (chez un autre auteur, le même sujet aurait pu être abordé avec un autre artiste, c'est évident). Et je connais suffisamment la difficulté de l'écriture, surtout celle d'un livre, pour ne pas y aller de mes conseils dont la légitimité resterait à démontrer. Je prends ce livre pour qu'il nous dit être : des esquisses d'une philosophie imaginaire.
Du côté de chez Jazz Magazine, on nous dit que jamais Michel Arcens ne nous fait écouter Coltrane et que la nouvelle finale donne envie de relire Giono. Vraiment ? Relire Giono, oui, pourquoi pas ? Excellente idée, mais je ne vois pas bien le rapport, en dehors de quelques apparentements géographiques et d'une certaine idée de la contemplation. Mais le texte conclusif appelé « L'été, un conte d'enfance », ne serait-il pas à prendre plutôt pour ce qu'il est en réalité : un présent déposé au pied du grand arbre Coltrane ? Voilà une explication qui me paraît bien plus proche de la démarche interrogative de l'auteur. Et bizarrement, allez savoir pourquoi, une fois terminée la lecture de Coltrane, la musique sans raison, je me suis dit qu'un être humain avait tenté d'expliquer sa propre vie à travers Coltrane, sa perception ontologique, humblement, prenant ainsi le risque de s'exposer alors qu'il aurait pu se contenter de vivre et de vibrer à l'art du saxophoniste de manière solitaire et égoïste. Et que ce que d'autres prennent non sans condescendance pour des litanies évoque avant tout une succession de chorus imaginaires issus d'un même thème mille fois remis sur l'ouvrage. Un questionnement perpétuel nourri d'un émerveillement né de l'enfance. Question de disponibilité d'esprit, probablement, de fraîcheur d'âme aussi. Il y avait chez Coltrane une vraie bonté, profonde et vitale, dont on ne trouve plus la moindre trace dans ces quelques lignes acerbes et gratuites.
Si le livre de Michel Arcens ne devait avoir qu'un seul mérite - ce qui serait déjà beaucoup et j'ai pu vérifier cet effet chez moi - c'est de vous contaminer du besoin irrépressible d'écouter le somptueux Live In Japan enregistré au mois de juillet 1966. La démarche répétitive d'Arcens fonctionne alors comme une des clés possibles d'une grosse serrure qui nous ouvre en grand la porte d'un monde dont le mystère nous échappera encore longtemps. On peut alors gloser indéfiniment sur les prétendus défauts du bouquin, qui ne sont plus selon nous que grains de poussière sans conséquence nuisible. Cette exécution un peu trop sommaire à mon goût semble finalement relever d'une démarche bien vaine face aux mille versions, itératives et mystiques, de « My Favorite Things » qui nous disent tellement sur le sens de la vie.
Michel Arcens cherche de son côté, et je ne sais toujours pas s'il a trouvé le début d'une réponse. Là n'est pas la question, vraiment, l'essentiel étant pour chacun d'entre nous de chercher à comprendre et à trouver des traits d'union.
-
King Crimson (Aymeric Leroy)
 Après Pink Floyd, plongée dans l’œuvre d’un groupe paradoxal et Rock progressif, King Crimson est le troisième livre écrit par Aymeric Leroy pour le compte de l’éditeur marseillais Le Mot et le Reste. On peut faire confiance à l’auteur pour nous proposer une approche captivante de ce groupe anglais dont l’identité progressive a été incarnée durant plus de quarante ans (de 1969 à 2003, pour la discographie) par la personnalité plutôt austère de son leader Robert Fripp ; mais une identité également forgée par une volonté de renouvellement fonctionnant par cycles, avec notamment pour conséquence de fréquents changements de personnel.
Après Pink Floyd, plongée dans l’œuvre d’un groupe paradoxal et Rock progressif, King Crimson est le troisième livre écrit par Aymeric Leroy pour le compte de l’éditeur marseillais Le Mot et le Reste. On peut faire confiance à l’auteur pour nous proposer une approche captivante de ce groupe anglais dont l’identité progressive a été incarnée durant plus de quarante ans (de 1969 à 2003, pour la discographie) par la personnalité plutôt austère de son leader Robert Fripp ; mais une identité également forgée par une volonté de renouvellement fonctionnant par cycles, avec notamment pour conséquence de fréquents changements de personnel.Lire la suite de cette chronique sur Citizen Jazz...
-
Quarantaines
J’ai bien conscience de radoter. En fouinant dans mes archives, je retrouverai certainement un texte qui dit à peu près la même chose que ce qui est à lire plus bas. Qu’importe, après tout, on connaît bien des peintres ou des musiciens qui, cent fois, ont remis leur ouvrage sur le métier, déclinant à l’infini un motif dont ils n’envisageaient jamais la fin. Je m’accorde ce droit…
Qu’elle soit ou non ce qu’elle était, la nostalgie n’est jamais bonne conseillère… On ne peut pas, chaque jour, mâchouiller comme un vieux chewing-gum insipide son passé, avec une pointe de mélancolie, en essayant de se persuader que c’était mieux avant ; pas plus qu’il n’est bon de figer sa propre histoire au temps de l’enfance ou de l’adolescence, en s’octroyant une éternelle jeunesse dont on sait qu’elle s’enfuit et vous échappe d’autant plus que vous vous échinez à lui courir après. La roue tourne pour chacun de nous et, finalement, c’est déjà une sacrée chance, quand tant d’autres auraient aimé la voir s’activer un peu plus longtemps ou même simplement disposer du privilège exorbitant du retour sur soi. Se retourner, oui, pour savoir d’où l’on vient, pour comprendre, c’est bien. Mais attention à la chute ! Mieux vaut garder un œil sur le prochain virage, c’est plus prudent.
 C’est en contemplant le spectacle figé des centaines de disques méthodiquement rangés à l’ombre d’un deuxième étage sous les toits que je me suis laissé gagner par ces pensées presque nocturnes. Chers disques, sources de tant de rêves en musique, objets de convoitise parfois, générateurs d’impatiences et d’obsessions égotistes… Ils sont là, aujourd’hui silencieux, inactifs pour la plupart, les plus anciens ayant depuis longtemps franchi le cap de la quarantaine. Je passe devant les rayonnages et les piles qui s’entassent, faute d’une rigueur dans le travail de classement parce qu’on verra plus tard… Je scrute les amoncellements et les déséquilibres verticaux. Puis, plutôt que de m’apitoyer sur cette savante mise en désordre, j’essaie d’exercer ma mémoire en tentant d’identifier les tranches des 33 tours ou des CD, je cherche à me rappeler où et quand je les ai achetés. Alors c’est la grande plongée dans l’océan trouble des images qui défilent, le télescopage des souvenirs aux contours flous parfois.
C’est en contemplant le spectacle figé des centaines de disques méthodiquement rangés à l’ombre d’un deuxième étage sous les toits que je me suis laissé gagner par ces pensées presque nocturnes. Chers disques, sources de tant de rêves en musique, objets de convoitise parfois, générateurs d’impatiences et d’obsessions égotistes… Ils sont là, aujourd’hui silencieux, inactifs pour la plupart, les plus anciens ayant depuis longtemps franchi le cap de la quarantaine. Je passe devant les rayonnages et les piles qui s’entassent, faute d’une rigueur dans le travail de classement parce qu’on verra plus tard… Je scrute les amoncellements et les déséquilibres verticaux. Puis, plutôt que de m’apitoyer sur cette savante mise en désordre, j’essaie d’exercer ma mémoire en tentant d’identifier les tranches des 33 tours ou des CD, je cherche à me rappeler où et quand je les ai achetés. Alors c’est la grande plongée dans l’océan trouble des images qui défilent, le télescopage des souvenirs aux contours flous parfois.Un magasin de disques, tout en longueur dans une rue déjà piétonne. Le temps des achats compulsifs après des semaines de patience, passées à entasser les précieux francs et la ruée vers l’or noir et ses deux sillons enchantés. Un disque, parfois deux. Jamais assumé, entré par effraction au domicile après une courte pause derrière un arbre cachette. À chaque fois c'est la même chose, l'achat devient une faute à avouer. Une émission de télévision où des musiciens tout habillés de blanc sont habités d'une urgence mystique, avec un guitariste qui tient son drôle d'instrument à double manche, vite il faut acheter le disque, pochette jaune et oiseaux de feu. François Cevert vient de mourir, le coureur automobile aux yeux verts allait trop vite, lui aussi. Et ce bon vieux magnétophone à cassette dont on colle le micro au plus près du téléviseur pour garder au chaud, son propre chaud, vingt-six minutes inédites qui périront dans le grand bûcher de l'obsolescence programmée. Cette fois, le guitariste est assis, il a l'air sérieux, caché derrière ses lunettes et sa petite barbe. Le roi n'est plus cramoisi mais il va vite, lui aussi, il termine par un feu d'artifice sans étoiles. Plus tard, il y aura un chanteur avec de drôles de déguisements. Et très vite, les prix qui grimpent en flèche pour cause de crise du pétrole sculptée à grands coups de stratégie géopolitique par les grands irresponsables de ce monde. De nouveaux codes tarifaires ont fait leur apparition : on passe de C à A, entre temps il y a eu B. Dur pour les mélomanes sans le sou, en quelques mois, l’augmentation est forte, plus de trente pour cent. Les soirées de lecture le dos collé au mur, casque stéréophonique sur la tête, isolé dans un drôle de monde schizophrénique où les yeux voient une histoire pendant que les oreilles en écoutent une autre. Les Rougon Macquart en pleine lutte contre le Grateful Dead ou le rock progressif des anglais de Yes à la conquête de Proust, en quelque sorte. Le fracas percussif d'un batteur aux yeux exorbités qui veut nous embarquer sur sa planète, habitée de drôles d'esprits pas vraiment recommandables et qu’on n’extirpera de son Panthéon que bien des décennies plus tard. Coup de pied au cul tardif mais salutaire... Des concerts, presque toujours imaginaires, parfois réels aussi, pour une virée en bus scolaire à la découverte de Pink Floyd en pleine promotion de Dark Side Of The Moon. Un peu plus tard, les Who et leur frénésie gesticulatoire, la guitare fracassée ; un concert de Neil Young, à Paris, Porte de Pantin, like a hurricane. Sandwiches au camembert made in Lorraine face aux drôles de cigarettes des autochtones et leurs yeux un peu trop rouges. Des magazines dont on lit tout, avidement, ne voulant laisser à personne le soin d’en tourner les pages tant que la dernière n’aura pas été dévorée. Les posters en page centrale, qui viennent orner les murs défraîchis de la chambre refuge. Les alignements de vinyles qui finissent par occuper une bonne moitié de l’armoire aux vêtements, avec classement alphabétique et numérotation à la main de chaque disque et mention manuscrite du jour et lieu de son achat. Les débuts d’une accumulation un peu vaine qui repousse au loin toute velléité de dénombrement. Premiers déstockages, un peu plus tard, on revend des disques qu'on rejette de façon péremptoire, persuadé de détenir enfin une vérité qui n’a jamais existé. À peines partis, les voici qui hurlent leur absence, l'armoire les cherche, c'est justement ceux-là qu'il faut écouter aujourd'hui. Un jour, bientôt, leur mise à la retraite sera programmée, poussés dehors par un sale gamin à la tête de miroir sans charme, qui se prétend le meilleur, indestructible et tout le tralala. Il y a de l’eugénisme hi-fi dans l’air, une idolâtrie de la pureté dont les plus ignares aiment tant se vanter, exhibant leur matériel pour le tester devant nous à grands coups de rock FM décaféiné. Il est beau mon son, il est beau ! Tant pis, à force de crier sa musique, John Coltrane a pu entrer dans ma danse, tout de même, il va mener le bal pour très longtemps, son sourire ne s'éteindra plus. My Favorite Things. Fin du flash.
Mais à quoi bon faire revivre toutes ces vieilleries ? Quelque chose d’un peu vertigineux me submerge à l’idée qu’une grande majorité de ces trésors enfouis ne feront probablement plus l’objet de la moindre exhumation. Manque de temps, vie trop courte, besoin de nouvelles aventures, de découvertes, nécessité de la connaissance dont on ne peut étancher la soif. Course en avant… Une autre forme de quarantaine pour elles, ces petites galettes bavardes, un exil forcé vers la nuit du temps qui passe très vite.
Cette mise au point personnelle, cet instant d’arrêt devant ces heures d’histoire enrayonnées tant bien que mal, cette recherche de la musique perdue, n'est pas sans avantages : elle permet de mesurer le tri radical qui s'est opéré dans les souvenirs. Un peu à la manière du son numérique qui écrête hautes et basses fréquences, au point parfois de rendre certains détails inaudibles, le temps scalpe notre mémoire pour préserver les repères, les points de rupture et les grandes embardées qui nous ont façonnés. On garde le noyau dur, le cœur nourricier. Tout est là pourtant, devant nous, il suffit de compter mais seuls quelques rescapés font encore la une de notre actualité, tous les autres ont été repoussés plus loin dans la pagination du journal, en plus petits caractères. Il sera toujours possible d’y revenir, ou peut-être pas…
Ne pas trop regarder derrière soi, donc. Penser à demain, à ces musiques qui s'inventent ou qui n'existent pas encore. Les plus belles probablement, celles dont on ne sait pas où elles nous emmènent. Aucune importance puisque la confiance est là. La toile est vierge, ils vont tous venir la peindre, un par un, pour nous ; et puis, ils recommenceront, inventeront de nouvelles couleurs, nous raconteront d'autres histoires inédites. Toujours la même quête…
Pour finir, un peu de place à la musique avec un exemple de repère personnel. C'est en pensant à la tournée européenne du Grateful Dead en 1972 que ces éclairs ont zébré mon musée invisible. Cette épopée printanière m'est revenue à l'esprit parce que je caressais tout récemment l'espoir de l'écouter dans son intégralité. Vingt-deux concerts, soixante-six CD, soixante-dix heures de musique exhumées depuis peu. Des dollars à n'en plus finir, beaucoup trop... Une sorte de Graal pour un type comme moi. Vous pouvez penser que ce désir un peu démesuré contredit toutes mes imprécations anostalgiques ! Pas si sûr… Jerry Garcia et ses acolytes, soit le groupe de l'émancipation. Quand, à quatorze ans, un peu à l'étroit dans l'univers du rock et son cadrage trop resserré, on veut ouvrir les fenêtres en grand, apercevoir de grands espaces et devenir l'acteur de ses propres découvertes. Le groupe qui a tout déclenché, la curiosité, la boulimie vinylique, la gourmandise du son, l'admiration sans bornes pour les musiciens-magiciens, le besoin de connaître chaque jour un peu plus. Aucune nostalgie dans ce retour en arrière de quarante ans donc, juste le témoignage d'une dette contractée, dont je ne suis pas certain de pouvoir régler un jour les dernières traites.
En attendant, je vois une autre pile, très bien rangée celle-là, juste devant moi. De nouveaux disques à écouter, encore des chroniques à écrire… Le vrai privilège. La course en avant…
26 mai 1972 - Londres, le Lyceum. Le Grateful Dead interprète "China Cat Sunflower / I Know You Rider". Onze minutes et quelques secondes. Probablement l'un des passages que j'aurai le plus écoutés depuis quarante ans... On le retrouve ici, joliment enrubanné...
-
Un ami s'en va...
C’était il y a deux ans, presque jour pour jour, le 10 septembre 2010. Pour parachever la rédaction d’un des textes de l’exposition Portraits Croisés que je devais réaliser avec mon ami Jacky Joannès, j’avais demandé à Xavier Brocker – qui avait fini par devenir lui aussi un ami à force de passions partagées – de m’accorder un entretien. Je voulais qu’il me raconte en détail l’édition 1975 de Nancy Jazz Pulsations, dont il était à l’époque le directeur artistique. 45 minutes passionnées, beaucoup d’anecdotes, une verve inimitable et un incroyable talent pour faire vivre des instants pas comme les autres, à l’époque où les responsables du festival avaient décidé de programmer le JATP (Jazz At The Philarmonic) et son cortège de stars, comme Dizzy Gillespie, sous l’égide du fantasque Norman Granz. Vous pourrez, un peu plus bas, écouter cette passionnante conversation, si vous le souhaitez.
Xavier vient de nous quitter, trahi par son cœur qu’il avait gros comme ça. C’est un personnage, un vrai, qui s’en va. Il laisse un vide énorme autour de lui tant ses amis étaient nombreux. Il avait 73 ans.

Xavier Brocker © Maître Chronique - Septembre 2010Xavier était tombé dans le jazz à l’adolescence, contractant un heureux virus dont, jamais, personne n’aurait pu le vacciner. C’était en 1954, après un concert de Sidney Bechet à la Salle Poirel de Nancy. S’il lui arrivait de jouer du piano ou de la clarinette, il était d’abord une encyclopédie vivante, un boulimique de la connaissance, toujours soucieux de transmettre sa passion au plus grand nombre. Il fut l’un des membres fondateurs de Nancy Jazz Pulsations et son premier directeur artistique. Journaliste à l’Est Républicain, il était aussi l’auteur du Roman vrai du jazz en Lorraine. Retraité hyperactif, on pouvait souvent le retrouver en animateur de conférences passionnées illustrées par des écoutes dont il raffolait, aussi bien pour les jeunes que pour les adultes et qu’il appelait des causeries ; il consacrait aussi une partie de son temps à l’animation d’émissions de radio, dédiées au jazz, forcément. Il avait également pris une part prépondérante à l’élaboration du CD 50 ans de jazz en Lorraine, publié sur le label Etonnants Messieurs Durand. Xavier était un être curieux, toujours prêt à se frotter à de nouvelles découvertes. Il était un grand monsieur, un gourmand de la vie, la musique et le jazz en étaient pour lui le sel vital.
Xavier était un grand seigneur. Alors que j’étais très honoré d’avoir été, à plusieurs reprises, l’invité de son émission, lui se sentait redevable. En témoignage de son amitié, il m’avait fait un somptueux cadeau, en m’offrant l’enregistrement original et intégral de la première création de Nancy Jazz Pulsations en 1973 : la « Stanislas Percussive Gavotte », interprétée par un big band réuni par le trompettiste Ivan Jullien et qui comptait parmi ses membres : Eddie Louis, Jon Surman, André Ceccarelli, Bernard Lubat ou encore Daniel Humair. Je garde précieusement cette bande magnétique, ce trésor, qu’un ami doit prochainement numériser. Il va de soi que chacun d’entre vous pourra bientôt l’écouter ici. C’est ce que voulait Xavier, il voulait partager. Ses désirs seront des ordres.
Il y a quelques jours encore, c’était vendredi dernier, j’avais appelé Xavier, à sa demande. Il voulait m’inviter une fois de plus au micro de « Jazz Galaxies », l’émission hebdomadaire qu’il animait sur une radio locale à Nancy. Lui, tout comme moi, aimait ces petits rendez-vous et leur rituel (je sais, parce qu’il me le disait à chaque fois, qu’il appréciait beaucoup notre complicité ; ayant moi-même pendant plusieurs années animé une émission consacrée au jazz, il savait que j’avais du répondant, il appréciait la tonalité de ce qui devenait une conversation souriante mais à chaque fois exploratrice de nouveautés) : il venait à la maison une heure avant le début de l’émission, je lui préparais un café et nous discutions du programme. Je lui soumettais ensuite une liste de disques qu’il acceptait en toute confiance ; de son côté, il extirpait de son sac un vieux 33 tours ou un CD qu’il avait pioché dans sa volumineuse discothèque (la dernière fois, c’était un disque que lui avait offert Didier Lockwood). Enfin venait l’élaboration du conducteur et son minutage faussement précis, qu’il était de toutes façons incapable de respecter, en bavard impénitent qu’il était, dès lors que le voyant rouge s’allumait. Il goûtait, vraiment, le plaisir de dire le jazz et son amour infini pour cette musique. Il faut l’avoir vu au moins une fois savourer ses propres réflexions pour comprendre la saveur si particulière de son propos. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle notre dernière émission – c’était le 16 juillet – consacrée à Nancy Jazz Pulsations 2012, n’avait pu nous permettre de diffuser toute la musique programmée quelque temps plus tôt ; il voulait un second épisode, absolument. Malgré sa voix très affaiblie, son enthousiasme au téléphone était intact : il se réjouissait de notre nouveau duo et, toujours curieux, il m’avait demandé de revenir avec, dans mon sac, le disque d’Electro Deluxe Big Band que nous avions écouté six semaines auparavant et qu’il avait beaucoup aimé. Je le vois encore, pestant à l’idée qu’un tel groupe, si chaleureux et fédérateur, ne pût être vite à l’affiche du festival.
Notre rendez-vous était fixé au 24 septembre à 10 heures. Un peu inquiet de la fatigue que j’avais détectée chez lui, je lui avais recommandé la prudence, lui demandant de prendre soin de lui, avant tout...
Cette émission n’aura pas lieu, je garde son programme pour moi, avec le cœur serré. Xavier, reviens ! Je n’arrive pas à croire que tu viens de faire le grand saut.
Je sais que tous ses amis, tous ceux qui le connaissaient le pleurent aujourd’hui. Peut-être que leur peine sera un peu adoucie à l’écoute de sa voix : je vous offre, en sa mémoire, cette causerie qu’il m’avait accordée en toute amitié et dont le souvenir ne s'effacera jamais.
Salut l’ami !
En écoute, l'entretien que Xavier m'avait accordé le 10 septembre 2010 (durée : 44'51). Un enregistrement sans coupures ni montage, avec tous les bruits de fond en provenance de la brasserie où nous nous étions installés.
-
Yochk’o Seffer, « Free comme Jazz »
 Pour une fois, on ne pourra pas dire qu’une biographie arrive trop tard, après la disparition d’un musicien dont on aurait aimé que le talent soit célébré de son vivant. Cette biographie de Yochk’o Seffer, signée Jean-Jacques Leca et publiée chez Edilivre est la bienvenue en ce qu’elle propose une longue promenade aux côtés d’un saxophoniste toujours en activité, même si, comme le déplore André Francis dans un court texte introductif, il « vit en deçà de la notoriété qu’il mérite ».
Pour une fois, on ne pourra pas dire qu’une biographie arrive trop tard, après la disparition d’un musicien dont on aurait aimé que le talent soit célébré de son vivant. Cette biographie de Yochk’o Seffer, signée Jean-Jacques Leca et publiée chez Edilivre est la bienvenue en ce qu’elle propose une longue promenade aux côtés d’un saxophoniste toujours en activité, même si, comme le déplore André Francis dans un court texte introductif, il « vit en deçà de la notoriété qu’il mérite ».Lire la suite de cette chronique sur Citizen Jazz...
-
Franck Médioni - Jimi Hendrix
 Un livre de plus consacré au plus grand guitariste du XXe siècle ? Depuis quarante ans, les nombreuses œuvres consacrées au Voodoo Chile nous ont déjà beaucoup appris sur celui qui se présentait volontiers comme un extraterrestre et, de son propre aveu, n’était lui-même que sur scène. Jimi Hendrix, et sa carrière fulgurante ont fracassé le monde de la musique en une poignée d’années... Quel parcours météorique, en effet !
Un livre de plus consacré au plus grand guitariste du XXe siècle ? Depuis quarante ans, les nombreuses œuvres consacrées au Voodoo Chile nous ont déjà beaucoup appris sur celui qui se présentait volontiers comme un extraterrestre et, de son propre aveu, n’était lui-même que sur scène. Jimi Hendrix, et sa carrière fulgurante ont fracassé le monde de la musique en une poignée d’années... Quel parcours météorique, en effet !Lire la suite de cette chronique sur Citizen Jazz...
-
C’est graphe, docteur ?
 Pour une fois, il ne sera pas ici question de musique... Encore que l’atelier d’écriture auquel j’ai eu la chance de participer du mois de janvier jusqu’à samedi dernier (six séances de quatre heures) résonne dans ma tête d’une vraie musique des mots : pas seulement les miens, mais aussi ceux de mes camarades qui, tous, ont accepté de plancher sur les exercices proposés par l’attentif et bienveillant Frédéric Vossier. Alors, en guise de clin d’œil à Colette, Laurent, Didier, Léo, Marie-Laure et quelques autres, je vous livre ici un texte qui n’a d’autre prétention que d’être ce qu’il est : un exercice.
Pour une fois, il ne sera pas ici question de musique... Encore que l’atelier d’écriture auquel j’ai eu la chance de participer du mois de janvier jusqu’à samedi dernier (six séances de quatre heures) résonne dans ma tête d’une vraie musique des mots : pas seulement les miens, mais aussi ceux de mes camarades qui, tous, ont accepté de plancher sur les exercices proposés par l’attentif et bienveillant Frédéric Vossier. Alors, en guise de clin d’œil à Colette, Laurent, Didier, Léo, Marie-Laure et quelques autres, je vous livre ici un texte qui n’a d’autre prétention que d’être ce qu’il est : un exercice.Écrit lors de l’ultime séance, il est la réponse à une consigne donnée par notre tortionnaire préféré qui avait introduit la séance par une explication relative à différents procédés d’écriture autour des idées de monologue ou de soliloque. Après nous êtres vu imposer l'un d'entre eux par tirage au sort (ainsi, je devais d’abord écrire un soliloque où un personnage : s'interroge ou se parle ou laisse la parole se dévider, en situation apparente de dialogue), nous avons pu écrire ensuite en utilisant celui de notre choix dans la liste établie en début d'atelier. Ici, c’est un monologue de type « récit de vie » (qui, aux dires de Frédéric après lecture à voix haute, a plutôt tourné en soliloque mais qu’importe, après tout, l’essentiel, c’est de le savoir).
Au sujet de ces lignes écrites en vingt minutes, je dois préciser qu’elles prennent appui sur un fait réel (une chute dans la rue). Toutes les sensations, tous les souvenirs et les évocations sont reproduits telles qu’ils m’ont traversé l’esprit durant un délai très court (deux ou trois minutes, pas plus). En relisant ce travail, je me suis rendu compte que d’autres pensées m’avaient gagné pendant cet épisode, mais celles-ci n’ont pas refait surface durant mon court temps d’écriture. Ce que pouvez lire ici (si vous le souhaitez, bien sûr) est reproduit à l’identique, sans ajout ni suppression. Et encore une fois, mille pardons pour les maladresses, j’ai joué la carte de la transparence.
Avec un grand salut amical non seulement à Frédéric mais aussi à mes camarades qui ont osé offrir leurs textes au groupe. Ce sont des moments d’échanges irremplaçables, des heures riches de partage, d’émotion, d’humour et d’imagination. Je leur en suis infiniment redevable. Merci à eux et au Théâtre de la Manufacture de Nancy qui organisait cet atelier.
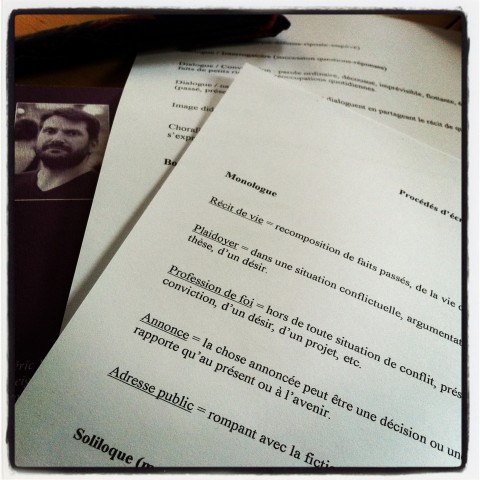
Le trottoir était humide hier soir. Les pavés me guettaient du coin de l’œil. Un œil torve et menaçant. Je marchais vite, comme d’habitude. Perdu dans mes pensées, les écouteurs de mon baladeur vissés aux oreilles.
La musique, c’est une compagne, depuis l’enfance. Pas une seule infidélité en plus de cinquante ans d’un concubinage qu’elle n’a pas choisi. Oui, c’est moi qui ai choisi la musique, pas l’inverse. On appelle ça une relation asymétrique, parce que j’en sais plus sur la musique qu’elle n’en sait sur moi. Et fort heureusement pour mon entourage, la musique n’a pas voulu de moi. Oh, j’ai bien entamé autrefois une brillante carrière d’harmoniciste... mais j’ai tout arrêté, épuisé par les tournées harassantes dans les deux salles de classe de mon école où l’on m’exhibait comme un singe savant. J’ai mis un terme à tout cela, j’avais cinq ans. Il faut savoir arrêter.
La musique, donc, dans les oreilles.
Les pavés glissants, sous mes pieds.
J’avance au rythme oppressant de « De Futura », un vieux truc bien sombre des années soixante-dix, quand Jannick Top faisait gronder sa basse dans Magma.
Et puis la chute...
Et merde !
Le beau vol plané, sous le regard torve des pavés et l’œil éteint de mes concitoyens qui hésitent entre l’éclat de rire – ça fait toujours rire un type qui se casse la gueule en glissant sur une peau de banane, sauf que là c’était un pavé – et la commisération bonne conscience.
Ah, bordel ! J’ai ruiné mon jean... Fait chier, je l’ai acheté hier et pas en solde. Même qu’au téléphone, j’avais taquiné mon fils en lui disant que son vieux père portait des pantalons taille trente-huit, comme lui, et qu’on verrait bien dans vingt-sept ans s’il en serait toujours capable.
Quatre-vingt-quinze euros le pantalon... Un gros trou au genou. Et le genou en sang. Saloperie d’anticoagulants, je vais encore en mettre partout pendant trois heures.
Et tous ces cons qui me regardent comme si j’étais un ivrogne...
J’ai glissé, comme un con, sur ces cons de pavés luisants, devant des cons. Oui, vous aussi vous êtes des cons, pas besoin de vous pour me relever. Vous voyez bien que je me relève, non ?
J’ai mal au genou.
Je boîte un peu.
Pas grave, ça va passer.
Je pense à ma mère. Il lui est arrivé la même chose, ou presque. Sauf qu’elle ne s’en est pas tirée. D’abord un clou pour lui rafistoler la hanche et puis une prothèse. Et puis rien. Un mouroir en guise de centre de rééducation. Plus d’argent, plus de soins, plus d’hôpital. Ouste, dehors... Ad patres.
Mais moi, je me suis relevé. Y a toujours « De Futura » qui fait hurler ses sirènes. Faut que je change de disque, là c’est trop, je vais choisir autre chose, un truc plus doux. Tiens, la contrebasse de Renaud Garcia-Fons. Ça glisse tout seul, en plus c’est une musique pleine de soleil. Je suis sûr qu’il ne risque pas de glisser sur ces saloperies de pavés mouillés.
N’empêche. J’ai l’air con avec mon pantalon troué. J’essaie de colmater la brèche comme je peux. Et ça continue à pisser rouge en dessous.
Plus personne pour me regarder. J’ai réparé comme j’ai pu. C’est bon, j’avance, maintenant.
J’avance en boitillant.
-
Neil Young, Rock’n’Roll Rebel ?
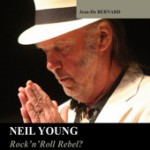 Pas si simple de s’attaquer à un monstre sacré tel que Neil Young ! Le personnage est fascinant, complexe, généreux quoique plutôt taciturne ; le musicien est charismatique, habité par une inépuisable énergie qui le pousse depuis plus de quarante ans à remettre constamment sur le métier un ouvrage très personnel où les accords électriques et acoustiques de sa guitare tissent un univers teinté de folk, de blues et de rock.
Pas si simple de s’attaquer à un monstre sacré tel que Neil Young ! Le personnage est fascinant, complexe, généreux quoique plutôt taciturne ; le musicien est charismatique, habité par une inépuisable énergie qui le pousse depuis plus de quarante ans à remettre constamment sur le métier un ouvrage très personnel où les accords électriques et acoustiques de sa guitare tissent un univers teinté de folk, de blues et de rock.Neil Young, une voie (voix) singulière à laquelle le journaliste JeanDo Bernard a déjà consacré une biographie et qui l’a incité à publier chez Camion Blanc un deuxième livre dont la raison d’être est à chercher dans la publication d’un disque du Loner, Living With War (2006).
Lire la suite de cette chronique sur Citizen Jazz...
-
Collectionnite aigüe ?
Je finis par me demander si la discographie du Grateful Dead ne ressemble pas à une grosse vis dont le filetage serait usé, au point qu’une fin n’est jamais envisageable. Elle tourne, elle tourne, elle tourne… Je ne reviendrai pas ici une nouvelle fois sur l’histoire personnelle qui me lie à ce groupe (cherchez si vous le souhaitez, vous finirez bien par trouver…) parce que j’aurais l’impression d’être un vieux schnock radoteur (ce que je suis probablement). Je résumerai cette forme de dépendance inoffensive en disant qu’une petite musique Grateful Dead résonne constamment dans ma tête, de près ou de loin. C’est ainsi… une sorte d’oxygène neuronal.
Mais tout de même ! Les archivistes de la bande à Jerry Garcia – hommes d’affaires bien avisés ? – nous annoncent la publication en 2012 d’une nouvelle collection d’enregistrements baptisée Dave’s Picks, sous la houlette de David Lemieux. Mais c’est quoi ce truc ? On n’en finira donc jamais ?

Je passe sur l’épaisseur de la discographie officielle du groupe : treize albums studios (ce qui est peu finalement, pour une existence couvrant la période allant de 1966 à 1995), une ribambelle d’albums live (dont on peut établir le compte, mais j’y renonce… il y a des doubles, des triples, des quadruples, et même beaucoup plus, je crois avoir un coffret de neuf disques rassemblant trois concerts du début de l'année 1969) qui sont autant de témoignages de la créativité d’une formation dont le four core (Jerry Garcia, Bob Weir, Phil Lesh et Bill Kreutzmann) aura soufflé un air d’une grande fraîcheur, nonobstant un parcours très troublé par de nombreux excès, liés à l’usage des drogues en particulier, sans oublier plusieurs disparitions tragiques. Une douce brise un peu folle aux confins du rock, du folk, du rhythm’n’blues, de la country music, toujours prête à s’échapper de ces cadres trop étroits par de longues séquences d’improvisations (celles-ci ont même fait l’objet d’un disque sous la forme d’une énigmatique compilation appelée Infrared Roses) qui ont constitué la marque de fabrique du groupe.
Si c’était aussi simple… On pourrait délimiter le périmètre et en rester là. On prend son petit stock de disques et on a largement de quoi s’occuper. Mais c’est sans compter sur cette espèce de folie jusqu’au boutiste qui prévaut au sein de l’équipe de Dead Heads régnant sur un stock d’archives très impressionnant. Au point que les collections qu’ils élaborent, mises bout à bout, nous permettent de vivre en différé ce qui s’apparente à une épopée un peu déjantée, qui fait vivre pendant 30 ans un répertoire dont la liste des compositions n’est pas si étoffée. Il y a chez le Grateful Dead un terreau sans cesse labouré, une remise constante de l’ouvrage sur le métier.
Ah, ces collections live ! 36 volumes de la série Dick’s Picks (chacun d’entre eux étant lui-même composé de plusieurs CD) ; une grosse douzaine de Download Series tout aussi copieuses ; et pour finir les Road Trips, soit une petite vingtaine de volumes supplémentaires. N’en jetez plus, la cour est pleine. Curieusement, cette accumulation, ces répétitions n’ont jamais suscité chez moi la moindre lassitude : ces concerts passés m’accompagnent, je les vis à distance géographique et chronologique, peut-être pour combler la cruelle déception d’un concert (dont j’ai encore les billets en ma possession) à Nancy qui ne s’est jamais tenu… Peut-être aussi pour rester en parfaite connexion avec mon passé et vivre le présent de manière plus sereine.
Je croyais en avoir fini jusqu’à hier (enfin, quand je dis finir, il faut comprendre que je pensais mon univers enfin délimité), en découvrant l’annonce d’une nouvelle série de concerts dont les quatre premiers volumes sont annoncés pour 2012. Des soirées intégralement restituées, semble-t-il, avec un travail soigné apporté au son. Pfff… Voilà qui promet encore de longues heures de cohabitation avec les héros de mon adolescence. Sont fous ces Américains.
Je vais essayer de survivre à cette nouvelle attaque traîtresse…
PS : on aura compris par cette note quels moments difficiles je vis...
-
Improjazz
 Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la ville de Blois compte parmi ses habitants un fou furieux qui, depuis des lustres, se bat avec un acharnement qui force l’admiration pour défendre et partager une passion que je lui ai toujours connue. Quand je dis toujours, je n’exagère pas puisque je me rappelle l’époque de mon enfance à Verdun et la forte propension du personnage à ne parler que de musique avec mon frère, dont il était un camarade de classe. Je crois même me rappeler qu’en ces temps reculés – chut, ne le dites à personne - il vouait un vrai culte aux Rolling Stones… Philippe Renaud – c’est lui que j’évoque ici – s’est forgé une solide réputation en créant voici un bon paquet d’années Improjazz, un magazine mensuel disponible par abonnement uniquement et dont le dernier numéro en date est le cent-soixante-dix-neuvième. C’est dire que le temps passe…
Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais la ville de Blois compte parmi ses habitants un fou furieux qui, depuis des lustres, se bat avec un acharnement qui force l’admiration pour défendre et partager une passion que je lui ai toujours connue. Quand je dis toujours, je n’exagère pas puisque je me rappelle l’époque de mon enfance à Verdun et la forte propension du personnage à ne parler que de musique avec mon frère, dont il était un camarade de classe. Je crois même me rappeler qu’en ces temps reculés – chut, ne le dites à personne - il vouait un vrai culte aux Rolling Stones… Philippe Renaud – c’est lui que j’évoque ici – s’est forgé une solide réputation en créant voici un bon paquet d’années Improjazz, un magazine mensuel disponible par abonnement uniquement et dont le dernier numéro en date est le cent-soixante-dix-neuvième. C’est dire que le temps passe…Attention ! Ce magazine d’information musicale est probablement un cas unique, pas seulement en raison de sa longévité, ni par la ténacité de son créateur et de ceux qui l’entourent mais par son concept et son esthétique. Dédié principalement au jazz et tout particulièrement à ses formes improvisées, Improjazz s’adresse exclusivement aux lecteurs. N’y voyez pas là un truisme, mais plutôt une nécessaire explication : par sa mise en page austère presque inchangée depuis son origine, par la densité des textes qui le composent, la publication ne cède en rien aux canons actuels de la communication écrite et n’ira pas vous tirer par le bout de la manche pour se vendre. Bref, vous m’aurez compris, on aura du mal à le feuilleter pour regarder les illustrations, rares et monochromes ; bien au contraire, on ouvre Improjazz comme on le ferait d’un livre : il faut un peu de temps devant soi et vouloir découvrir une foule d’artistes dont, probablement, vous n’aurez jamais entendu parler.
Objet de curiosité, publication pour curieux, Improjazz ne vit que par la foi de l’équipe de Philippe Renaud et par les abonnements de ses lecteurs. En ces temps chahutés où je ne sais quel comité Théodule est réuni par celui qu’on prétend être Ministre de la Culture pour se pencher au chevet du jazz, il est aussi de notre devoir de valoriser un soutien aussi fidèle au monde de la musique.
-
Festen again !
 J’apprends que les quatre musiciens de Festen vont prochainement entrer en studio pour enregistrer leur second disque. Voilà qui ressemble fort à une excellente nouvelle ! Le premier chapitre de leurs aventures musicales était très séduisant, par son mélange d’influences multiples – pour ne pas dire sa fusion, mais ce mot est trop souvent connoté de façon négative après avoir été confisqué par certaines tendances du marshmallow sonore des années 80. Pour jeunes qu’ils soient, Damien Fleau (saxophone), Jean Kapsa (piano), Oliver Degabriele (contrebasse) et Maxime Fleau (batterie) n’en possèdent pas moins une très solide culture jazz qui jamais ne leur interdit d’aller, par l’effet conjugué d’une saine curiosité et de leur histoire personnelle, faire un tour du côté de leurs amours plus rock. Inutile de dire qu’on a déjà envie d’en savoir plus sur ce projet en gestation.
J’apprends que les quatre musiciens de Festen vont prochainement entrer en studio pour enregistrer leur second disque. Voilà qui ressemble fort à une excellente nouvelle ! Le premier chapitre de leurs aventures musicales était très séduisant, par son mélange d’influences multiples – pour ne pas dire sa fusion, mais ce mot est trop souvent connoté de façon négative après avoir été confisqué par certaines tendances du marshmallow sonore des années 80. Pour jeunes qu’ils soient, Damien Fleau (saxophone), Jean Kapsa (piano), Oliver Degabriele (contrebasse) et Maxime Fleau (batterie) n’en possèdent pas moins une très solide culture jazz qui jamais ne leur interdit d’aller, par l’effet conjugué d’une saine curiosité et de leur histoire personnelle, faire un tour du côté de leurs amours plus rock. Inutile de dire qu’on a déjà envie d’en savoir plus sur ce projet en gestation.Plus généralement, je défends bec et ongles cette nouvelle génération de musiciens qui croisent les univers et n’adoptent jamais une attitude condescendante envers des formes musicales que d’autres jugent inférieures voire vulgaires, au point de penser que leur incorporation dans le brouet du jazz constitue une marque de dégénérescence. Peut-être parce que de mon côté j’ai grandi dans un environnement très largement influencé par le rock, et qu’à l’époque j’étais étonné de l’agressivité exprimée par la sphère des puristes (dans le camp du jazz ou de la musique classique) à son encontre. Ils démontraient la plupart du temps un vrai sectarisme et, pire, une ignorance totale du mal qu’ils se croyaient obligés de pointer d’un doigt vengeur.
Il me semble que cette époque là est bien révolue et qu’aujourd’hui, l’assimilation, tranquillement, s’opère. Tant mieux. Festen en est une manifestation très claire !
En écoute, « Ed’s Night Out », extrait du premier disque de Festen.
-
Shmira
 John Coltrane, l’homme suprême, tel est le titre du disque que Christian Vander vient d’enregistrer et qui sera très prochainement disponible sur le label Seventh Records. On sait que le batteur voue un culte infini au saxophoniste au point que la mort de ce dernier peut être considérée comme le catalyseur de l’aventure Magma ; il suffit de lire les nombreuses interviews dans lesquelles il s’est exprimé à ce sujet pour s’en convaincre. On écoutera par conséquent avec beaucoup d’attention cet hommage, dont on ne peut douter de l’intensité fiévreuse, tant la corde coltranienne vibre fort chez Vander.
John Coltrane, l’homme suprême, tel est le titre du disque que Christian Vander vient d’enregistrer et qui sera très prochainement disponible sur le label Seventh Records. On sait que le batteur voue un culte infini au saxophoniste au point que la mort de ce dernier peut être considérée comme le catalyseur de l’aventure Magma ; il suffit de lire les nombreuses interviews dans lesquelles il s’est exprimé à ce sujet pour s’en convaincre. On écoutera par conséquent avec beaucoup d’attention cet hommage, dont on ne peut douter de l’intensité fiévreuse, tant la corde coltranienne vibre fort chez Vander.Sur la pochette de ce disque, on peut lire l’explication suivante : « Ce disque a été enregistré jour après jour, du 17 Juillet, date de son départ, au 21 Juillet, jour de ses funérailles. Chaque jour, une offrande, un don musical, poétique, pour lui, réalisé en temps réel. Le 21 à minuit, le disque était terminé».
Quarante-quatre ans après la disparition de John Coltrane, cette célébration de type mortuaire n’est en rien une lubie vanderienne. Bien au contraire, elle nous renvoie à un certain nombre de traditions : dans la religion Juive par exemple, la shmira en est l’exacte réplique. Elle consiste à accompagner les défunts par la lecture de psaumes ou de textes sacrés depuis le jour de leur mort jusqu’à leurs funérailles. Cette pratique a deux raisons d’être : la première est en quelque sorte hygiénique, car la présence des vivants est une protection du corps contre les animaux et les insectes ; la seconde est spirituelle car elle est une façon de tenir compagnie à l’âme du défunt (neshama) qui flotte au-dessus du corps jusqu’au jour de l’enterrement.
L’esprit de Coltrane continue de planer sur la musique de Christian Vander : qu’adviendra-t-il désormais, maintenant que le disciple a accompagné son maître jusqu’au bout selon un rite sacré ?
-
Rebelle... ze riteurne !
 Je reviendrai plus en détail, par le biais d’une chronique pour Citizen Jazz, sur le livre que JeanDo Bernard a consacré à Neil Young. Sans attendre cependant, j’aimerais souligner ici ses qualités. La première d’entre elles étant sa spontanéité associée au style incisif et sans détours inutiles qui vous font dévorer ce Neil Young, Rock’n’Roll Rebel ? comme dans un seul souffle (on pourra juste regretter une petite série de coquilles tout au long des pages).
Je reviendrai plus en détail, par le biais d’une chronique pour Citizen Jazz, sur le livre que JeanDo Bernard a consacré à Neil Young. Sans attendre cependant, j’aimerais souligner ici ses qualités. La première d’entre elles étant sa spontanéité associée au style incisif et sans détours inutiles qui vous font dévorer ce Neil Young, Rock’n’Roll Rebel ? comme dans un seul souffle (on pourra juste regretter une petite série de coquilles tout au long des pages).L’auteur connaît bien son affaire et, comme il le démontre dans un chapitre introductif, a vécu pleinement ces années 60 dont la période 1968-1975 fut d’une incroyable fécondité. Moyennant une poignée de souvenirs d’enfance mobilisés en quelques pages bien senties, il nous dresse le portrait de ces temps aujourd’hui lointains – la France du général De Gaulle, des yé-yés, de la Guerre du Viet-Nam, de toute un génération en quête d’un autre monde, cette recherche n’excluant pas le recours à tout un arsenal de produits pour le moins stupéfiants – au beau milieu desquels va éclore le Loner, mister Neil Young himself.
Si JeanDo Bernard connaît son Neil Young sur le bout des doigts (depuis The Squires jusqu'au récent Le Noise en collaboration avec le producteur Daniel Lanois, en passant par Buffalo Springfield et Crosby, Stills Nash & Young), il n’en a pas pour autant écrit un livre de fan hardcore ! Il n’y a dans sa démarche aucune tentation hagiographique : bien au contraire, il s’efforce de décortiquer à travers une partie des disques du Canadien (qui sont nombreux et dont la recension exhaustive aurait abouti à un catalogue fastidieux) les ressorts de ses engagements tant sur le plan politique que philosophique ou écologique, n’hésitant pas à pointer du doigt ses contradictions (une radicalité anti Bush qu’on ne peut que mettre en parallèle avec une plus grande tiédeur envers Ronald Reagan, par exemple). Le journaliste écrivain nous propose un exercice d’admiration cultivée mais raisonnée et c’est là une des grandes forces du livre. Sans jamais oublier de nous rappeler la singularité du musicien, tant le chanteur que le guitariste. Nourri de folk, de blues et de rock.
Mais l’essentiel me paraît résider ailleurs (ce n’est ici qu’un point de vue personnel) : en effet, la lecture du livre est la démonstration de ce qui fait tout le pouvoir de séduction de Neil Young : quelles que soient certaines de ses errances, quel que soit le niveau de sa production discographique (généralement très élevé, mais l’artiste a connu des coups de mou, notamment durant les sinistres années quatre-vingt), l’histoire du Loner est celle d’un éternel recommencement. Pour lui, comme pour nous. Neil Young n’est jamais là où on l’attend : le succès d’un Harvest aboutit à la sombre tournée Times Fades Away ; un climat country ou folk pourra être balayé d'un revers de gilet à franges par un disque hautement électrique ou une tentative technoïde, avant le retour aux sources, en solitaire ou flanqué de son fidèle Crazy Horse. Depuis plus de quarante ans, beaucoup d’entre nous sont prêts à embarquer avec lui, quitte à descendre temporairement du train si l’atmosphère ne nous convient pas, mais certains que le prochain voyage méritera le détour. Neil Young fait partie de ces artistes qui sont de vrais compagnons de vie, des êtres humains avec leurs forces et leurs failles, mais toujours fidèles à nos rendez-vous avec eux. Et d’une générosité indiscutable doublée d’une force de conviction inoxydable.
Neil Young, Rock’n’Roll Rebel ? nous l’explique avec la même sincérité : ce livre, édité par Camion Blanc, devrait séduire non seulement les fans de la première ou de la deuxième heure, mais aussi tous ceux qui voudraient faire la connaissance d’un personnage unique.
Bonus !
Tout récemment a vu le jour un Live In Chicago, un double album enregistré en 1992. Neil Young, plus solitaire que jamais, s’accompagne à la guitare, au piano, voire à l’harmonium. Il est possible que ce disque soit redondant avec d’autres déjà disponibles. Mais à lui seul, il est le témoignage de la démarche artistique de Neil Young, intense, mélange de fragilité et de force, presque intemporelle. En voici un court extrait, avec le poignant « The Needle And The Damage Done ».
-
Discovery, immersion... commerce
 Qu’on ne se méprenne pas sur le sens de cette note : adolescent, j’étais fasciné par la musique de Pink Floyd. Je me rappelle même avoir fait le siège du bureau de l’économe de mon lycée jusqu’à ce qu’il accepte l’idée d’affréter un bus pour emmener une cinquantaine de lycéens, dont ma sœur et moi, de Verdun à Nancy, histoire d'applaudir le groupe en pleine tournée promotionnelle de The Dark Side Of The Moon, au mois de décembre 1972. Je n’avais pas encore 15 ans, j’avais dans ma besace à musique de longues heures passées dans ma chambre à écouter « Echoes » et ses sirènes inquiétantes avec un camarade de classe. C’était le disque Meddle, emprunté à ma sœur - encore elle - qui avait eu la bonne idée de l'acheter… Aujourd’hui, le groupe occupe toujours une place non négligeable dans mon modeste Panthéon (qui est un peu décousu, je l’admets), ma préférence allant toutefois pour ses premières années : celle des deux premiers albums imprégnés de la folie de Syd Barrett mais aussi les suivantes et leur psychédélisme planant (jusqu'à Obscured By Clouds). The Dark Side Of The Moon aura marqué une rupture, celle d’un succès planétaire combiné à une disparition progressive des envolées cosmiques un peu folles pour céder la place à un univers plus contrôlé. Trop à mon goût, comme si le groupe perdait doucement son âme... Bien sûr, il y aura The Wall, en 1979, lui-même entré dans la légende mais… non, désolé, c’est un autre Pink Floyd dans lequel je ne me suis jamais vraiment retrouvé. Au point de m'ennuyer fermement avec la parution, quatre ans plus tard, de The Final Cut.
Qu’on ne se méprenne pas sur le sens de cette note : adolescent, j’étais fasciné par la musique de Pink Floyd. Je me rappelle même avoir fait le siège du bureau de l’économe de mon lycée jusqu’à ce qu’il accepte l’idée d’affréter un bus pour emmener une cinquantaine de lycéens, dont ma sœur et moi, de Verdun à Nancy, histoire d'applaudir le groupe en pleine tournée promotionnelle de The Dark Side Of The Moon, au mois de décembre 1972. Je n’avais pas encore 15 ans, j’avais dans ma besace à musique de longues heures passées dans ma chambre à écouter « Echoes » et ses sirènes inquiétantes avec un camarade de classe. C’était le disque Meddle, emprunté à ma sœur - encore elle - qui avait eu la bonne idée de l'acheter… Aujourd’hui, le groupe occupe toujours une place non négligeable dans mon modeste Panthéon (qui est un peu décousu, je l’admets), ma préférence allant toutefois pour ses premières années : celle des deux premiers albums imprégnés de la folie de Syd Barrett mais aussi les suivantes et leur psychédélisme planant (jusqu'à Obscured By Clouds). The Dark Side Of The Moon aura marqué une rupture, celle d’un succès planétaire combiné à une disparition progressive des envolées cosmiques un peu folles pour céder la place à un univers plus contrôlé. Trop à mon goût, comme si le groupe perdait doucement son âme... Bien sûr, il y aura The Wall, en 1979, lui-même entré dans la légende mais… non, désolé, c’est un autre Pink Floyd dans lequel je ne me suis jamais vraiment retrouvé. Au point de m'ennuyer fermement avec la parution, quatre ans plus tard, de The Final Cut.Mais quand je vois comment les majors envahissent actuellement le terrain médiatique pour tenter de nous refourguer une nouvelle intégrale (la Discovery Edition, soit toute la discographie de Pink Floyd remasterisée) tout en publiant dans le même temps une version Immersion Box Set de The Dark Side Of The Moon, précédant elle-même le lifting annoncé de The Wall, force est de constater, une fois de plus, que les actionnaires de ces grands groupes financiers ne misent plus un seul kopeck sur des talents en devenir – c’est-à-dire ceux-là même qui en auraient le plus besoin – et préfèrent assurer leurs arrières en multipliant les profits sur des produits rentabilisés depuis des décennies. Autant de boîtes à l'emballage savamment étudié mais qui sentent un peu trop le réchauffé. Marketing, quand tu nous tiens...
Et je me dis qu’en 2011, le joueur de pipeau aurait beau s’échiner à s’avaler une saucière de secrets aux portes de l’aube, il se fracasserait le nez sur un mur, celui de l’argent… un mur obscurci par les nuages mercantiles de notre société embarquée dans une cynique dérive. En 2011, le Pink Floyd de Syd Barrett ne verrait pas le jour, personne ne lui donnerait sa chance, il serait un groupe mort-né…
Alors plutôt que de dépenser des sommes folles dans d’inutiles rééditions bien trop coûteuses sous couvert de je ne sais quelle remasterisation ou de publication annexe de quelques fonds de tiroir d’un intérêt incertain sur des CD qualifiés de bonus, je me dis qu’il nous appartient d’être les acteurs de ce jeu en procédant aux bons choix. Tenez par exemple : cette histoire de Pink Floyd m’a fait penser à un Hommage à Syd Barrett rendu par l’i.overdrive trio (soit Philippe Gordiani à la guitare, Bruno Tocanne à la batterie et Rémi Gaudillat à la trompette) en 2008. Ou comment s’affranchir du modèle sans le faire oublier pour autant, dans une belle manifestation de respect et de talent. Let there be more light, disait Pink Floyd en 1968 : je suis bien d'accord, alors mettons plutôt en lumière des artistes qui restent trop dans l'ombre à mon goût...
Et si on écoutait l’i.overdrive trio dans sa reprise du légendaire « Astronomy Domine » ?
-
Pile
 J’ai reçu la semaine dernière une petite livraison de CD à chroniquer pour Citizen Jazz… Trois nouvelles galettes : un Live in Cologne 1983 de Weather Report (dont la première écoute m’a un peu ennuyé, parce que la musique me paraît avoir mal vieilli, mais sur laquelle je reviendrai car la paire Zawinul / Shorter le mérite bien) ; le surprenant et inclassable Des Clairières dans le Ciel de Lionel Belmondo dont l’Hymne au Soleil s’est frotté au Chœur National de Lettonie ; enfin le très réjouissant et inventif Des Trucs Pareils de Ping Machine, un grand ensemble dirigé par le guitariste compositeur Fred Maurin. C’est un privilège que d’avoir à écrire afin de rendre compte au plus de nos émotions du travail de ces artistes. Une responsabilité aussi, car mes chroniques sont lues, voire attendues, et je dois par conséquent prendre le temps d’écouter, une fois, deux fois… et même beaucoup plus, ne serait-ce que par respect des musiciens. Mais je garde ma ligne de conduite : privilégier l’émotion.
J’ai reçu la semaine dernière une petite livraison de CD à chroniquer pour Citizen Jazz… Trois nouvelles galettes : un Live in Cologne 1983 de Weather Report (dont la première écoute m’a un peu ennuyé, parce que la musique me paraît avoir mal vieilli, mais sur laquelle je reviendrai car la paire Zawinul / Shorter le mérite bien) ; le surprenant et inclassable Des Clairières dans le Ciel de Lionel Belmondo dont l’Hymne au Soleil s’est frotté au Chœur National de Lettonie ; enfin le très réjouissant et inventif Des Trucs Pareils de Ping Machine, un grand ensemble dirigé par le guitariste compositeur Fred Maurin. C’est un privilège que d’avoir à écrire afin de rendre compte au plus de nos émotions du travail de ces artistes. Une responsabilité aussi, car mes chroniques sont lues, voire attendues, et je dois par conséquent prendre le temps d’écouter, une fois, deux fois… et même beaucoup plus, ne serait-ce que par respect des musiciens. Mais je garde ma ligne de conduite : privilégier l’émotion. -
Rebelle
 Mon pote Gérard Nguyen vient de m’apporter un exemplaire de Neil Young, Rock’n’Roll Rebel?, le bouquin écrit par le journaliste JeanDo Bernard dont il a assuré la mise en page pour le compte des éditions Camion Blanc. Un double plaisir car passer une heure en compagnie de l’ami Gérard, c’est l’assurance d’une conversation passionnante qui va fourmiller des mille et une anecdotes qu’il raconte avec passion ; mais aussi parce que le bouquin, loin d’être une simple biographie, présente un angle d’attaque très intéressant : l’auteur analyse les prises de position du Canadien solitaire, tant au plan social que politique ou écologique, quitte à en souligner les contradictions. Voilà de belles heures de lecture en perspective !
Mon pote Gérard Nguyen vient de m’apporter un exemplaire de Neil Young, Rock’n’Roll Rebel?, le bouquin écrit par le journaliste JeanDo Bernard dont il a assuré la mise en page pour le compte des éditions Camion Blanc. Un double plaisir car passer une heure en compagnie de l’ami Gérard, c’est l’assurance d’une conversation passionnante qui va fourmiller des mille et une anecdotes qu’il raconte avec passion ; mais aussi parce que le bouquin, loin d’être une simple biographie, présente un angle d’attaque très intéressant : l’auteur analyse les prises de position du Canadien solitaire, tant au plan social que politique ou écologique, quitte à en souligner les contradictions. Voilà de belles heures de lecture en perspective !

