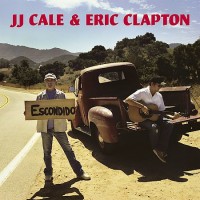Hypernuit

Voilà près de quatre ans maintenant – c’était au mois de mars 2007 – que j’ai découvert Bertrand Belin, alors qu’il venait de publier La Perdue, son second album. Vous pouvez vous reporter à la petite note que j’avais écrite à l’époque pour comprendre ce qui m’avait séduit chez ce chanteur atypique, l’un des rares sur la scène actuelle de la chanson dite française à posséder cette capacité d’installer d’emblée un univers immédiatement identifiable, résolument énigmatique et aux antipodes d’un insupportable carcan, celui du couplet / refrain rimailleur mou du genou tout le monde tape dans ses mains.
Bertrand Belin a récemment ajouté une nouvelle étape au périple musical qui est le sien en publiant un troisième disque étrangement intitulé Hypernuit. On y retrouve cette alternance de pénombre et de lumière, ces climats brumeux orchestrés en une musique volontairement réduite à son état minimal – guitare, basse légère, batterie plus suggérée que frappée, ici ou là quelques arrangements de cordes – où les paroles souvent elliptiques laissent deviner les émotions ou les paysages plus qu’elles n’affirment. Bertrand Belin invente des textes dans une langue qui ne sent pas l’effort de l’écriture et semble au contraire déposer spontanément les mots au plus près des impressions qu’ils veulent nous transmettre. Dans une récente interview, il confiait que « les textes n'ont pas été écrits, ne sont pas passés par le papier pour ne pas organiser la phrase selon des concepts graphiques. J'ai souvent mis le casque sur les oreilles et chanté directement, sans écrire. Les textes sont nés au sein même de la musique. » La voix grave de Bertrand Belin, qui danse sur le fil ténu d’un équilibre entre chant et talk over, est empreinte tout à la fois de gravité et de fragilité. Elle parle au creux de l’oreille, confie des secrets qu’on recueille avec la certitude qu’ils nous sont destinés.
Il est peu probable que cette Hypernuit permette à son auteur de sortir d’une certaine confidentialité qui est la marque de Bertrand Belin, malgré l’accueil en général très enthousiaste de son travail et la reconnaissance de ses pairs. Parce que celui-ci, excellent guitariste et arrangeur de surcroît, ne choisit pas avec ce nouveau disque la facilité d’une chanson tape à l’œil et s’éloigne définitivement d’une appartenance au clan si peu imaginatif de la variété. Bien au contraire, Hypernuit s’apparente à la poursuite d’une quête, plutôt austère et feutrée, qui nous conduit avec lui dans un monde qui s’accommode mal des fureurs du quotidien. On se plaît à respirer à pleins poumons cette musique comme une bulle d'air existentielle et poétique.
 Le pari était pourtant loin d’être gagné vu le contexte économique. Les Lorrains, plus encore que les Français dans leur ensemble, ont le moral en berne et sont rarement au mieux de leur forme lorsque l’automne, qui n’est autre ici qu’un hiver mal déguisé, commence à glacer les esprits... On pouvait donc se poser la question : sauraient-ils se distraire – au sens le plus strict du mot – de leurs inquiétudes, pointer le bout du nez hors les murs et participer à cette fête de la musique ?
Le pari était pourtant loin d’être gagné vu le contexte économique. Les Lorrains, plus encore que les Français dans leur ensemble, ont le moral en berne et sont rarement au mieux de leur forme lorsque l’automne, qui n’est autre ici qu’un hiver mal déguisé, commence à glacer les esprits... On pouvait donc se poser la question : sauraient-ils se distraire – au sens le plus strict du mot – de leurs inquiétudes, pointer le bout du nez hors les murs et participer à cette fête de la musique ? Allez savoir pourquoi le passé vient soudainement carillonner à la porte de mon présent. Alors forcément, n'étant jamais à court d'une œillade à mes années de jeunesse, j'ouvre la porte en grand et je laisse entrer mon hôte et son cortège de bonnes nouvelles. Car voilà qu'après avoir écrit voici quelques mois
Allez savoir pourquoi le passé vient soudainement carillonner à la porte de mon présent. Alors forcément, n'étant jamais à court d'une œillade à mes années de jeunesse, j'ouvre la porte en grand et je laisse entrer mon hôte et son cortège de bonnes nouvelles. Car voilà qu'après avoir écrit voici quelques mois 



 Inutile de perdre son temps à trop regarder dans le rétroviseur des années 60 et 70, au risque de s'égarer dans la nostalgie d’une période un peu folle. Celle où
Inutile de perdre son temps à trop regarder dans le rétroviseur des années 60 et 70, au risque de s'égarer dans la nostalgie d’une période un peu folle. Celle où  Lorsque j'ai reçu le disque et le visuel de la pochette (qui incluait les notes écrites par chacun des musiciens), j'ai – comme on s'en doute – pris le temps d'écouter dans un grand silence cette musique improvisée, sans vraiment réfléchir. Murat et Jean-Pascal avaient par ailleurs déjà fourni dans leurs propres textes des informations suffisamment documentées sur leur travail pour que je n'aie pas à me perdre en considérations trop descriptives ou factuelles. Alors j'ai voulu jouer le jeu des Improvisions, en ce sens que j'ai noté sur un bout de papier les premiers mots, les premières images qui me venaient à l'esprit en écoutant le disque. Eux-mêmes ayant improvisé, je leur devais une écriture qui repose sur une trame la plus spontanée possible. Mes visions improvisées, en quelque sorte... Je précise ici que j'ai procédé exactement de la même façon pour construire les 57 textes de l'exposition Portraits Croisés, en association avec mon ami Jacky Joannès (avis à la population : un livret numérique est en préparation, avec toutes les photos, tous les textes, des bonus... Tout cela sera prêt au mois de décembre).
Lorsque j'ai reçu le disque et le visuel de la pochette (qui incluait les notes écrites par chacun des musiciens), j'ai – comme on s'en doute – pris le temps d'écouter dans un grand silence cette musique improvisée, sans vraiment réfléchir. Murat et Jean-Pascal avaient par ailleurs déjà fourni dans leurs propres textes des informations suffisamment documentées sur leur travail pour que je n'aie pas à me perdre en considérations trop descriptives ou factuelles. Alors j'ai voulu jouer le jeu des Improvisions, en ce sens que j'ai noté sur un bout de papier les premiers mots, les premières images qui me venaient à l'esprit en écoutant le disque. Eux-mêmes ayant improvisé, je leur devais une écriture qui repose sur une trame la plus spontanée possible. Mes visions improvisées, en quelque sorte... Je précise ici que j'ai procédé exactement de la même façon pour construire les 57 textes de l'exposition Portraits Croisés, en association avec mon ami Jacky Joannès (avis à la population : un livret numérique est en préparation, avec toutes les photos, tous les textes, des bonus... Tout cela sera prêt au mois de décembre).


 En 2008, après dix années de silence de la part du groupe, mis à profit par ses musiciens pour s’accomplir dans d’autres expériences, Sixun était revenu sur le devant de la scène avec Palabre, un disque tonique et ensoleillé qui affirmait plus que jamais sa volonté de produire une musique désireuse d’ouvrir les fenêtres du jazz à tous les courants d’air du jazz. Publié au printemps 2010, Sixun 2009 Live In Marciac...
En 2008, après dix années de silence de la part du groupe, mis à profit par ses musiciens pour s’accomplir dans d’autres expériences, Sixun était revenu sur le devant de la scène avec Palabre, un disque tonique et ensoleillé qui affirmait plus que jamais sa volonté de produire une musique désireuse d’ouvrir les fenêtres du jazz à tous les courants d’air du jazz. Publié au printemps 2010, Sixun 2009 Live In Marciac...
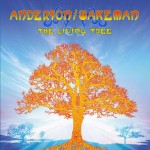 La surprise est bonne, finalement... Quand deux membres historiques du groupe Yes, groupe phare du rock progressif (si ce jargon ne vous parle pas, je vous suggère un petit détour par le bouquin éponyme d'Aymeric Leroy,
La surprise est bonne, finalement... Quand deux membres historiques du groupe Yes, groupe phare du rock progressif (si ce jargon ne vous parle pas, je vous suggère un petit détour par le bouquin éponyme d'Aymeric Leroy,  Nous sommes en 2010, le disque connaît une crise sans précédent au point que sa disparition est programmée dans l’esprit de beaucoup d’experts ou prétendus tels, dans un contexte économique où, malgré des difficultés avérées, le nombre de références publiées semble, lui, ne pas manifester de fléchissement. Pas simple, donc, de s’y retrouver dans le foisonnement des publications et de procéder aux bons choix lorsqu’il s’agit d’engager une dépense.
Nous sommes en 2010, le disque connaît une crise sans précédent au point que sa disparition est programmée dans l’esprit de beaucoup d’experts ou prétendus tels, dans un contexte économique où, malgré des difficultés avérées, le nombre de références publiées semble, lui, ne pas manifester de fléchissement. Pas simple, donc, de s’y retrouver dans le foisonnement des publications et de procéder aux bons choix lorsqu’il s’agit d’engager une dépense. Ma rédactrice en chef vient de me faire parvenir Empreintes, le deuxième disque d'
Ma rédactrice en chef vient de me faire parvenir Empreintes, le deuxième disque d' Bis non repetita ! Il fallait s’y attendre, sans une seconde de doute. On avait beau se repaître encore, avec une gourmandise intacte, d’un Around Robert Wyatt unanimement salué comme une réussite exemplaire, fort justement récompensé et placé très haut sur la grande pile des préférences de Citizen Jazz (voir ici notre
Bis non repetita ! Il fallait s’y attendre, sans une seconde de doute. On avait beau se repaître encore, avec une gourmandise intacte, d’un Around Robert Wyatt unanimement salué comme une réussite exemplaire, fort justement récompensé et placé très haut sur la grande pile des préférences de Citizen Jazz (voir ici notre 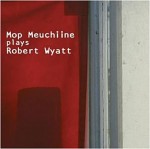 La musique de
La musique de