Forever Young
 Inutile de me chercher, vous risqueriez de ne pas me trouver. Je suis quelque part, pas très loin mais ailleurs... Occupé avec le nouveau disque de Neil Young, un double live qui s’appelle Earth. Je vous vois venir : encore ce type ? depuis tout ce temps ? Eh bien oui, encore lui, qu’on surnomme le loner parce qu’il a des allures de vieux loup solitaire un peu efflanqué (c’était aussi le titre d’une des compositions de son premier disque, ce qui a pu contribuer à faire naître ce surnom). Le gars du genre bougon, un peu obsessionnel aussi, qui a accumulé des paquets de disques depuis les années 60, quand il était l’un des membres de Buffalo Springfield. Et qui vous raconte, dans un récent et remarquable Very Good Trip, une émission de Michka Assayas sur France Inter, qu’il a fini par se remettre à la fumette après avoir arrêté. Avec ou sans, il s’est rendu compte qu’il restait créatif alors pourquoi se priver, je vous le demande ? C’est bien simple : si je fais une exception pour les années 80 qu’il a traversées non sans mal (comme bien d’autres d’ailleurs), j’ai une indulgence absolue pour sa musique. Et pour lui, de façon plus générale. J’ai même lu son bouquin du début à la fin. La plupart du temps, au moment où j’achète un nouveau disque de lui, je sais ce que je vais entendre, ce n’est pas la surprise qui aiguise mon appétit, mais plutôt le plaisir de retrouver un son et une voix qui, loin de satisfaire aux critères de la perfection façon télé-crochet avec jury has been, me font souvent dresser les poils des bras. C’est comme ça, je ne maîtrise pas la chose. Neil Young, c’est un musicien de chevet, si vous me passez l’expression. Présent chez moi depuis ma primo-adolescence et en particulier grâce à l’album, son deuxième en solo, Everybody Knows This Is Nowhere (sûrement mon préféré, soit dit en passant). Il durera jusqu’à ma propre fin, c’est certain.
Inutile de me chercher, vous risqueriez de ne pas me trouver. Je suis quelque part, pas très loin mais ailleurs... Occupé avec le nouveau disque de Neil Young, un double live qui s’appelle Earth. Je vous vois venir : encore ce type ? depuis tout ce temps ? Eh bien oui, encore lui, qu’on surnomme le loner parce qu’il a des allures de vieux loup solitaire un peu efflanqué (c’était aussi le titre d’une des compositions de son premier disque, ce qui a pu contribuer à faire naître ce surnom). Le gars du genre bougon, un peu obsessionnel aussi, qui a accumulé des paquets de disques depuis les années 60, quand il était l’un des membres de Buffalo Springfield. Et qui vous raconte, dans un récent et remarquable Very Good Trip, une émission de Michka Assayas sur France Inter, qu’il a fini par se remettre à la fumette après avoir arrêté. Avec ou sans, il s’est rendu compte qu’il restait créatif alors pourquoi se priver, je vous le demande ? C’est bien simple : si je fais une exception pour les années 80 qu’il a traversées non sans mal (comme bien d’autres d’ailleurs), j’ai une indulgence absolue pour sa musique. Et pour lui, de façon plus générale. J’ai même lu son bouquin du début à la fin. La plupart du temps, au moment où j’achète un nouveau disque de lui, je sais ce que je vais entendre, ce n’est pas la surprise qui aiguise mon appétit, mais plutôt le plaisir de retrouver un son et une voix qui, loin de satisfaire aux critères de la perfection façon télé-crochet avec jury has been, me font souvent dresser les poils des bras. C’est comme ça, je ne maîtrise pas la chose. Neil Young, c’est un musicien de chevet, si vous me passez l’expression. Présent chez moi depuis ma primo-adolescence et en particulier grâce à l’album, son deuxième en solo, Everybody Knows This Is Nowhere (sûrement mon préféré, soit dit en passant). Il durera jusqu’à ma propre fin, c’est certain.
 Now playing… Je me suis rendu au Triton (une double salle de concert sise aux Lilas) le 14 mai dernier pour assister au concert de Patrick Gauthier venu présenter le répertoire de Clinamens, son nouveau disque paru chez
Now playing… Je me suis rendu au Triton (une double salle de concert sise aux Lilas) le 14 mai dernier pour assister au concert de Patrick Gauthier venu présenter le répertoire de Clinamens, son nouveau disque paru chez  Now playing… Karl Jannuska est un musicien prisé de ses pairs. Ce ne sont pas Olivier Bogé, Tony Paeleman, Pierre Perchaud, Thomas Savy, Sophie Alour, Tam De Villiers, pour n’en citer qu’un échantillon, qui me diront le contraire, car ceux-là l’ont côtoyé et en connaissent les inspirations tant mélodiques que rythmiques. Le batteur canadien est ce qu’on peut appeler une valeur sûre dont
Now playing… Karl Jannuska est un musicien prisé de ses pairs. Ce ne sont pas Olivier Bogé, Tony Paeleman, Pierre Perchaud, Thomas Savy, Sophie Alour, Tam De Villiers, pour n’en citer qu’un échantillon, qui me diront le contraire, car ceux-là l’ont côtoyé et en connaissent les inspirations tant mélodiques que rythmiques. Le batteur canadien est ce qu’on peut appeler une valeur sûre dont  Now playing… Je sais, pour avoir échangé brièvement avec lui sur le sujet, que Fabrice Martinez se défend d’avoir subi l’influence de King Crimson en composant « Rebirth » qui ouvre son nouveau disque. Dont acte, mais tout de même : la basse grondante de Bruno Chevillon, la frappe sèche aux accents brufordiens d’Éric Échampard, les claviers de Fred Escoffier et leurs stridences frippiennes… Que les crimsoniens de tout poil me jettent le premier riff s’ils n’y entendent pas un début de parentèle avec leur groupe fétiche. C’est puissant et ça vient des entrailles… Et puis qu’importe : par leur entrée en fanfare, ces trois minutes introductives sont annonciatrices d’un disque qui semble né d’un cercle vertueux. Comment ? En rassemblant des amis de longue date dans un studio – Ferber en l’occurrence – dont le maître des lieux, le toujours juste Maïkôl Seminatore, sera capable de vous mitonner le son aux petits oignons que vous avez en tête. Quelque chose d’un peu « à l’ancienne », avec un orgue Hammond, une bonne vieille basse électrique, une batterie qui claque, des synthétiseurs comme autrefois, un peu de distorsion et autres effets qui vous rapprochent – cette fois ce n’est pas moi qui le dis – d’un « esprit Motown ». Et vous, vous enregistrerez dans les conditions du live, sans céder aux sirènes du re-recording, pour célébrer une renaissance et laisser libre cours à vos élans. Car tel est aussi le titre de cet album plein de jus : Rebirth, une nouvelle production à mettre au crédit d’ONJ Records, décidément en pleine forme. Avec de tels arguments, on en chercherait presque le 33 tours…
Now playing… Je sais, pour avoir échangé brièvement avec lui sur le sujet, que Fabrice Martinez se défend d’avoir subi l’influence de King Crimson en composant « Rebirth » qui ouvre son nouveau disque. Dont acte, mais tout de même : la basse grondante de Bruno Chevillon, la frappe sèche aux accents brufordiens d’Éric Échampard, les claviers de Fred Escoffier et leurs stridences frippiennes… Que les crimsoniens de tout poil me jettent le premier riff s’ils n’y entendent pas un début de parentèle avec leur groupe fétiche. C’est puissant et ça vient des entrailles… Et puis qu’importe : par leur entrée en fanfare, ces trois minutes introductives sont annonciatrices d’un disque qui semble né d’un cercle vertueux. Comment ? En rassemblant des amis de longue date dans un studio – Ferber en l’occurrence – dont le maître des lieux, le toujours juste Maïkôl Seminatore, sera capable de vous mitonner le son aux petits oignons que vous avez en tête. Quelque chose d’un peu « à l’ancienne », avec un orgue Hammond, une bonne vieille basse électrique, une batterie qui claque, des synthétiseurs comme autrefois, un peu de distorsion et autres effets qui vous rapprochent – cette fois ce n’est pas moi qui le dis – d’un « esprit Motown ». Et vous, vous enregistrerez dans les conditions du live, sans céder aux sirènes du re-recording, pour célébrer une renaissance et laisser libre cours à vos élans. Car tel est aussi le titre de cet album plein de jus : Rebirth, une nouvelle production à mettre au crédit d’ONJ Records, décidément en pleine forme. Avec de tels arguments, on en chercherait presque le 33 tours… Now playing… Pour ne rien vous cacher, le saxophoniste Julien Pontvianne est selon moi un drôle de loustic. Un énorme point d’interrogation, qui prend un malin plaisir à ne pas vous fournir les réponses aux questions que pose sa musique. C’est à vous d’essayer de vous faufiler dans son monde de silence et d’y trouver une place. Rien de péjoratif dans cette manière de qualifier celui dont j’avais déjà salué le talent très singulier à l’occasion de la publication de
Now playing… Pour ne rien vous cacher, le saxophoniste Julien Pontvianne est selon moi un drôle de loustic. Un énorme point d’interrogation, qui prend un malin plaisir à ne pas vous fournir les réponses aux questions que pose sa musique. C’est à vous d’essayer de vous faufiler dans son monde de silence et d’y trouver une place. Rien de péjoratif dans cette manière de qualifier celui dont j’avais déjà salué le talent très singulier à l’occasion de la publication de 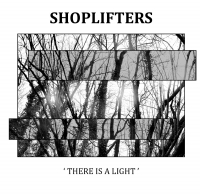 Now playing… Ce n’est pas parce que les musiciens formant le groupe Shoplifters ont eu la gentillesse de me demander d’écrire les
Now playing… Ce n’est pas parce que les musiciens formant le groupe Shoplifters ont eu la gentillesse de me demander d’écrire les 
 Now playing… Oui, oui, vous avez bien lu : CharlElie Couture. Mais que vient donc faire ici ce monsieur qu’on estampille à tort « variété française » et qui est avant tout un rockeur « fort rêveur » ? C’est que ce bonhomme-là, je l’aime bien, et ça ne date pas d’hier. Je ne prétends pas connaître sa vingtaine d’albums sur le bout des doigts, même si j’ai écouté la plupart d’entre eux, et je ne l’évoque pas ici parce qu’il est natif de Nancy, une ville que j’habite depuis… bien longtemps. Je ne m’attarderai pas non plus sur le cas de celui qui vit à New York depuis une douzaine d’années, par ailleurs peintre tout aussi singulier que le chanteur porteur d’une longue barbiche pointue dont la voix nasillarde est une énigme pour beaucoup. Pas facile d’expliquer en quelques mots la sympathie que le monsieur m’inspire, mais j’ai l’impression qu’il est un homme libre, ou du moins aussi libre que possible dans ce monde étrange et gris fabriqué par des humains égarés.
Now playing… Oui, oui, vous avez bien lu : CharlElie Couture. Mais que vient donc faire ici ce monsieur qu’on estampille à tort « variété française » et qui est avant tout un rockeur « fort rêveur » ? C’est que ce bonhomme-là, je l’aime bien, et ça ne date pas d’hier. Je ne prétends pas connaître sa vingtaine d’albums sur le bout des doigts, même si j’ai écouté la plupart d’entre eux, et je ne l’évoque pas ici parce qu’il est natif de Nancy, une ville que j’habite depuis… bien longtemps. Je ne m’attarderai pas non plus sur le cas de celui qui vit à New York depuis une douzaine d’années, par ailleurs peintre tout aussi singulier que le chanteur porteur d’une longue barbiche pointue dont la voix nasillarde est une énigme pour beaucoup. Pas facile d’expliquer en quelques mots la sympathie que le monsieur m’inspire, mais j’ai l’impression qu’il est un homme libre, ou du moins aussi libre que possible dans ce monde étrange et gris fabriqué par des humains égarés.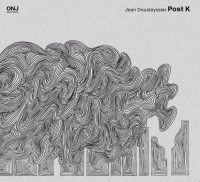 Now playing… Il s’en passe de belles du côté des soufflants de l’ONJ. Il y a quelques mois, Fidel Fourneyron avait relevé avec brio le défi d’un exercice de
Now playing… Il s’en passe de belles du côté des soufflants de l’ONJ. Il y a quelques mois, Fidel Fourneyron avait relevé avec brio le défi d’un exercice de  Now playing... Neuf ans environ après Pan Harmonie, le batteur Dré Pallemaerts réunit à nouveau sa formation de rêve : Mark Turner au saxophone, Bill Carrothers au piano et Jozef Dumoulin aux claviers et Rhodes. L’album s’appelle
Now playing... Neuf ans environ après Pan Harmonie, le batteur Dré Pallemaerts réunit à nouveau sa formation de rêve : Mark Turner au saxophone, Bill Carrothers au piano et Jozef Dumoulin aux claviers et Rhodes. L’album s’appelle 
 Petit retour en arrière. Lorsque Circles est sorti au mois de janvier chez
Petit retour en arrière. Lorsque Circles est sorti au mois de janvier chez  Dans les deux romans qu’il m’est arrivé de commettre (
Dans les deux romans qu’il m’est arrivé de commettre (