Sylvain Rifflet : « ReFocus »
 On peut dire que Sylvain Rifflet est un membre à part entière, pour ne pas dire un titulaire – il est vrai qu’en cette époque de destruction méticuleuse, haineuse et dogmatique de notre modèle social, on hésite à recourir à certains mots qui pourraient laisser penser qu’on rêve encore, crétins naïfs que nous sommes, à une certaine permanence des idées solidaires – du petit club de mes Musiques Buissonnières. Voici quelques années maintenant que je suis son parcours avec la plus extrême attention. En suivant les liens ci après, vous trouverez ici-même ou du côté de Citizen Jazz différentes traces écrites qui sont autant de manifestations de l’intérêt majeur que je porte au travail du saxophoniste. Qu’il se présente sous son nom en exposant ses Beaux-Arts ; qu’il énonce en quartet son Alphabet ou roule avec lui des Mechanics ; qu’il suive de très près avec Jon Irabagon la piste singulière du clochard céleste Moondog et son mouvement perpétuel ; qu’il raconte Paris sous la forme de Short Stories en compagnie de son complice flûtiste Joce Mienniel ; qu’il voyage dans le temps ou l’espace dans le souffle d’Art Sonic et ses disques lumineux que sont Cinque Terre ou Le Bal Perdu, Rifflet s’avance en musicien majeur de la scène musicale européenne. Je me contenterai de cette poignée de références qui devraient vous convaincre du talent du monsieur.
On peut dire que Sylvain Rifflet est un membre à part entière, pour ne pas dire un titulaire – il est vrai qu’en cette époque de destruction méticuleuse, haineuse et dogmatique de notre modèle social, on hésite à recourir à certains mots qui pourraient laisser penser qu’on rêve encore, crétins naïfs que nous sommes, à une certaine permanence des idées solidaires – du petit club de mes Musiques Buissonnières. Voici quelques années maintenant que je suis son parcours avec la plus extrême attention. En suivant les liens ci après, vous trouverez ici-même ou du côté de Citizen Jazz différentes traces écrites qui sont autant de manifestations de l’intérêt majeur que je porte au travail du saxophoniste. Qu’il se présente sous son nom en exposant ses Beaux-Arts ; qu’il énonce en quartet son Alphabet ou roule avec lui des Mechanics ; qu’il suive de très près avec Jon Irabagon la piste singulière du clochard céleste Moondog et son mouvement perpétuel ; qu’il raconte Paris sous la forme de Short Stories en compagnie de son complice flûtiste Joce Mienniel ; qu’il voyage dans le temps ou l’espace dans le souffle d’Art Sonic et ses disques lumineux que sont Cinque Terre ou Le Bal Perdu, Rifflet s’avance en musicien majeur de la scène musicale européenne. Je me contenterai de cette poignée de références qui devraient vous convaincre du talent du monsieur.
Le voici qui revient, pour nous surprendre une fois encore avec ReFocus, même s’il avait annoncé la couleur depuis plusieurs années en faisant part de sa passion ancienne pour Stan Getz. Sylvain Rifflet avait eu l’occasion en effet d’évoquer un projet de nature très particulière : faire revivre à sa façon le Focus de celui qu’on surnommait « The Sound ». Pour mémoire, il faut se souvenir que Focus est un album enregistré en 1961 pour le label Verve, où Stan Getz jouait du saxophone ténor accompagné d’un orchestre à cordes, dans une collaboration avec le compositeur et arrangeur Eddie Sauter. Le travail d'orchestration de ce dernier ne comportait pas de thèmes composés pour Stan Getz, l’arrangeur ayant choisi de lui ménager des espaces dans lesquels le saxophoniste pourrait improviser. Getz a enregistré en direct avec les cordes sur une moitié des compositions environ, et a pratiqué ce qu’on appelle l’overdub sur les autres. Focus se présente comme une sorte de pont entre jazz et musique classique. Faites donc un tour par ICI pour l’écouter...
Sylvain Rifflet donc. Le même principe en 2017 chez lui qu’en 1961 chez Stan Getz, soit : s’associer à des cordes, ici celles de l’ensemble Appassionato dirigé par Mathieu Herzog ; travailler en étroite collaboration avec un arrangeur : c’est Fred Pallem (Le Sacre du Tympan) qui est en action et a partagé avec lui une partie du travail de composition ; choisir une même dominante bleue pour la pochette ; être publié sur le même label : Verve, privilège que bien peu de musiciens français se sont vu accorder. Et puis, pour lancer chacun des disques, une composition urgente, comme un écho entre les deux, à plus de cinquante ans de distance. Focus commençait par « I’m late, I’m late » (je suis en retard) tandis que ReFocus ouvre sur « Night Run » (course nocturne).

Attention toutefois : le disque de Sylvain Rifflet ne consiste pas en une reprise de celui de Stan Getz, puisque les compositions de ReFocus sont originales. Dans un entretien récemment accordé à Citizen Jazz, il explique sa démarche : « On est repartis des moyens de 1961 et on s’est interrogés sur la démarche de Sauter et Getz s’ils avaient été inspirés comme je le suis moi-même par Philip Glass ou Terry Riley et toute cette branche répétitive et tonale contemporaine américaine ». On comprend que pour voisines, presque identiques même, que soient les deux méthodes, le résultat est différent et en ce qui concerne Rifflet, ReFocus est un disque qui s’ancre pleinement dans son parcours de musicien. Un pied dans l’histoire du jazz, l’autre dans le temps présent et, sans doute, le regard déjà tourné vers demain.
Sûr de son fait, Sylvain Rifflet a choisi une rythmique d’une grande souplesse en recourant aux services de Simon Tailleu à la contrebasse (si vous ne connaissez pas ce musiciens, vous pourrez toujours approfondir le sujet en écoutant Sfumato du quintet d’Émile Parisien, qui est l’un des grands disques de 2016) et de Jeff Ballard à la batterie. L’Américain, qu’on connaît entre autres par sa présence dans le trio de Brad Mehldau, reprend en quelque sorte le flambeau de Roy Haynes qui tenait les baguettes aux côtés de Stan Getz.
On peut légitimement éprouver des craintes à l’idée d’une association entre une formation de jazz et un ensemble à cordes. À vouloir trop concilier, on encourt le risque de mijoter une musique sirop. Les exemples ne manquent pas. Fort heureusement, Sylvain Rifflet déjoue ce piège haut les anches avec un disque d’une grande sobriété aux couleurs du soir, parfois mélancolique, souvent rêveur, toujours sous tension. ReFocus est un disque enchanteur aux accents cinématographiques qui, de surcroît, souligne la force intérieure qui fait vibrer le jeu de Sylvain Rifflet. Oui... parce qu’à force de souligner les richesses de son parcours depuis toutes ces années, on pourrait oublier qu’il est aussi un magnifique saxophoniste. Ce qu’il est, soyez-en certains.
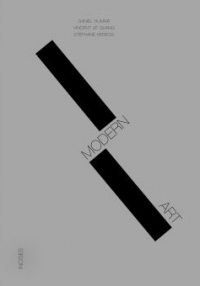 J’ai abandonné depuis longtemps l’idée de palmarès, considérant l’exercice assez vain. Sélectionner une poignée de disques parmi les dizaines reçues dans l’année, non merci, c’est souvent trop injuste pour beaucoup et un poil narcissique. Néanmoins, l’évidence peut parfois vous persuader qu’un disque en particulier, celui que vous tenez entre les mains et dont vous venez de faire la découverte, occupera une place de choix dans votre petit Panthéon. C’est le cas, sans le moindre doute, pour Modern Art, une réussite flagrante signée par un trio de « polyartistes », sur le label Incises.
J’ai abandonné depuis longtemps l’idée de palmarès, considérant l’exercice assez vain. Sélectionner une poignée de disques parmi les dizaines reçues dans l’année, non merci, c’est souvent trop injuste pour beaucoup et un poil narcissique. Néanmoins, l’évidence peut parfois vous persuader qu’un disque en particulier, celui que vous tenez entre les mains et dont vous venez de faire la découverte, occupera une place de choix dans votre petit Panthéon. C’est le cas, sans le moindre doute, pour Modern Art, une réussite flagrante signée par un trio de « polyartistes », sur le label Incises.  Que peut-on donc écrire qui ne l’ait déjà été au sujet de John Coltrane, dont on a célébré cet été le cinquantenaire de la disparition ? Pas grand-chose, me semble-t-il… L’exercice paraît vain aujourd’hui et peu nombreux sont celles ou ceux qui ne le considèrent pas comme un musicien majeur de l’histoire du jazz. Voire un musicien majeur du XXe siècle, tout simplement. Sa trajectoire stratosphérique – chez lui, tout ou presque s’est joué en à peine plus de dix ans ; le lyrisme exacerbé de son phrasé et la puissance sans équivalent de son jeu ; les mille histoires que racontait chacun de ses chorus ; son ascension inexorable dans une quête mystique ; sa recherche d’un langage universel en forme de cri ; le bouleversement qu’il avait su provoquer chez ses pairs au point parfois de susciter chez eux une remise en question ; la magnificence du quartet qu’il avait formé de 1961 à 1966 (avec McCoy Tyner au piano, Elvin Jones à la batterie et Jimmy Garrison à la contrebasse) ; l’incroyable accumulation d’enregistrements en un temps très court et particulièrement durant la période allant de A Love Supreme (décembre 1964) à Meditations (novembre 1965) ; le déchirement des derniers mois jusqu’à un ultime enregistrement studio, Expression, où le saxophoniste semblait avoir trouvé une sorte de paix intérieure. Voici donc, résumés, quelques repères pour expliquer le phénomène.
Que peut-on donc écrire qui ne l’ait déjà été au sujet de John Coltrane, dont on a célébré cet été le cinquantenaire de la disparition ? Pas grand-chose, me semble-t-il… L’exercice paraît vain aujourd’hui et peu nombreux sont celles ou ceux qui ne le considèrent pas comme un musicien majeur de l’histoire du jazz. Voire un musicien majeur du XXe siècle, tout simplement. Sa trajectoire stratosphérique – chez lui, tout ou presque s’est joué en à peine plus de dix ans ; le lyrisme exacerbé de son phrasé et la puissance sans équivalent de son jeu ; les mille histoires que racontait chacun de ses chorus ; son ascension inexorable dans une quête mystique ; sa recherche d’un langage universel en forme de cri ; le bouleversement qu’il avait su provoquer chez ses pairs au point parfois de susciter chez eux une remise en question ; la magnificence du quartet qu’il avait formé de 1961 à 1966 (avec McCoy Tyner au piano, Elvin Jones à la batterie et Jimmy Garrison à la contrebasse) ; l’incroyable accumulation d’enregistrements en un temps très court et particulièrement durant la période allant de A Love Supreme (décembre 1964) à Meditations (novembre 1965) ; le déchirement des derniers mois jusqu’à un ultime enregistrement studio, Expression, où le saxophoniste semblait avoir trouvé une sorte de paix intérieure. Voici donc, résumés, quelques repères pour expliquer le phénomène. Être fille de, c’est bien, sans nul doute. Surtout quand papa, qui vient de fêter ses 90 printemps, est – j’ose espérer qu’il me pardonnera cette façon de le qualifier – un personnage historique du jazz en France. On imagine que
Être fille de, c’est bien, sans nul doute. Surtout quand papa, qui vient de fêter ses 90 printemps, est – j’ose espérer qu’il me pardonnera cette façon de le qualifier – un personnage historique du jazz en France. On imagine que