
Disques de l'année... L’exercice peut paraître vain, tout comme l’idée d’un palmarès, mais comme l'ami Franpi s'y est collé, alors j'y vais de ma petite liste. Ici je vous propose en toute simplicité un rapide retour en arrière sur les mois qui viennent de s’écouler, en essayant, sans trop réfléchir toutefois, de penser aux disques (je me suis volontairement limité à ce qu’on appelle communément le jazz) dont les musiques me trottent dans la tête… C’est très injuste pour tous les autres – si nombreux – dont une petite sélection tout aussi incomplète vous est proposée à la fin de cette note. Je précise enfin que l’ordre de cette douzaine dorée ne répond à aucune logique particulière.
Libre(s)Ensemble
Pour sa démarche libertaire, ses élans et le souffle de ses influences, qui vont d’Ornette Coleman à King Crimson en passant par le Liberation Music Orchestra. Du grand art pour un grand ensemble. La bande à Tocanne frappe fort, elle qui nous séduisait déjà beaucoup avec 4 New Dreams et continue de nous passionner avec Mad Kluster Vol. 1. Libre(s)Ensemble n'en finit pas de tourner en boucle par ici…
Artaud : Music From Early Times
Trop méconnu et pourtant quel disque ! Vincent Artaud, compositeur, arrangeur, multi instrumentiste, réinvente son propre monde un peu mystérieux, celui des origines, entre grands espaces inquiets et paysages brûlants. Une certaine vision de l’infini passée inaperçue pour des raisons tout aussi mystérieuses… Il n’est jamais trop tard pour bien faire.
Perrine Mansuy Quartet : Vertigo Songs
Parce qu’il y a chez la pianiste et ses complices ce brin de folie onirique dont le charme opère instantanément. Une apparence de classicisme sous une trame très mélodique qui cède vite la place à un univers poétiquement décalé. La guitare de Rémy Decrouy est envoûtante, les percussions de Jean-Luc Difraya sont des enluminures et le chant de Marion Rampal nous embarque dans ses espiègleries. Perrine Mansuy nous enchante…
Sphère : Parhélie
Jean Kapsa, Antoine Reininger, Maxime Fleau. Ils sont jeunes, ils ont du talent à revendre. Leur premier disque, d’une grande maturité, n’est jamais démonstratif. La sérénité de leur propos vient apporter un contrepoint pacifié au quartet Festen, une autre formation subtilement créatrice de tension dont deux des musiciens du trio Sphère sont les membres très actifs. Tout ce petit monde est décidément passionnant.
Ping Machine : Des trucs pareils
Coup de cœur pour ce quasi big band aux envolées chaudes et puissantes, au sein duquel chaque musicien s’exprime dans un état de liberté dont on ressent vite le besoin à la manière d’une dépendance. Une réponse flamboyante aux fossoyeurs récurrents du jazz, qui est ici plus que vivant. Il bouillonne !
Maria Laura Baccarini : Furrow
Ou comment faire voler en éclats le répertoire de Cole Porter jusqu'à le rendre méconnaissable et lui donner une nouvelle dimension, fulgurante, entre jazz et rock, au point de dessiner parfois le portrait d’une version contemporaine du rock progressif. La voix de l’italienne est ici l’un des six instruments d’un groupe terriblement inventif. On se réjouit des prestations inspirées de Régis Huby ou Eric Echampard... et des autres !
Pierrick Pédron : Cheerleaders
Les majorettes du saxophoniste sont un peu énigmatiques. Rêve ? Réalité ? Allez savoir. Elles sont ici le prétexte à une suite d’histoires dans laquelle le sextet de Pierrick Pédron, ne cherche pas seulement à donner un prolongement au captivant Omry. Il est l’affirmation singulière d’une puissance aux couleurs presque rock et d’une créativité dont le jazz a le secret. Bref, c’est assez explosif et très chaleureux. Comme Pierrick Pédron lui-même.
Samuel Blaser : Boundless
Le jeune Helvète est un tromboniste prolifique qui n’hésite pas à bousculer notre confort douillet pour nous inviter à partager ses déambulations très imaginatives. Son association en quatuor dans lequel le guitariste Marc Ducret est parfait comme d’habitude, séduit par un cheminement complexe mais toujours débordant de vitalité. Quelques mois plus tôt, Blaser nous offrait avec Consort In Motion une relecture originale de Monteverdi, avec l’appui du regretté Paul Motian. Il était aussi de la fête des 4 New Dreams de Bruno Tocanne.
Stéphane Kerecki & John Taylor : Patience
Un duo presque nocturne, contrebasse et piano. Deux générations dont la conversation est une démonstration lumineuse. Ce disque est à sa manière une incarnation de l’harmonie vers lequel on revient naturellement, en toute confiance.
Stéphane Belmondo : The Same As It Never Was Before
Ici, il faudrait parler d’épanouissement. Le trompettiste est au meilleur d’une forme qui doit aussi beaucoup au talent de ses comparses et particulièrement d’une paire américaine de grande expérience, le pianiste Kirk Lightsey et le batteur Billy Hart. Un disque à savourer, tranquillement, pour sa plénitude et la sagesse qu’il dégage.
Lionel Belmondo "Hymne au Soleil" : Clair Obscur
Frère du précédent, le saxophoniste poursuit sa quête, celle du passage entre des univers qui ne sont séparés les uns des autres que dans les esprits les plus étroits. Suite d’Hymne au Soleil, Clair Obscur jette de nouveaux ponts entre la musique dite classique du début du XXe siècle et le jazz. Son « Nocturne », qui va de Gabriel Fauré à John Coltrane, est magnifiquement emblématique de la démarche d’un musicien habité.
Giovanni Mirabassi : Adelante
Le pianiste italien remet le couvert ! Dix ans après Avanti, Adelante se présente comme un manifeste avec sa succession d’hymnes puisés dans le patrimoine mondial de la résistance à l’oppression. Cette apologie de la liberté s’exprime dans toute la puissance d’une interprétation solitaire et méditative.
Et pour quelques galettes de plus
Je n’oublie pas, parmi des dizaines et des dizaines d’autres : Canto Negro (Henri Texier Nord Sud Quintet), Dig It To The End (Tonbruket), Five (Prysm), Songs Of Freedom (Nguyen Lê), The Crow (Plaistow), Avec deux ailes (Sébastien Llado Quartet), Heterotopos (D!Evrim), Seven Seas (Avishai Cohen), Prétextes (Christophe Dal Sasso), Downtown Sorry (Roberto Negro Trio), Nos sons unis (Big 4), Tower # 1 (Marc Ducret)… à vous de compléter maintenant.
Il faudrait plusieurs vies, quand on y réfléchit...
 [Carnet de notes buissonnières # 008] Jacques Schwarz-Bart est originaire de la Guadeloupe. Fils d’un couple d’écrivains célèbres, Simone et André Schwarz-Bart, il est connu pour être un musicien accompli qui a découvert très jeune le gwoka et ses rythmes complexes. Comme bon nombre de ses condisciples, il est passé par la Berklee School of Music de Boston avant de croquer la Grosse Pomme où il a rencontré quelques grands noms du jazz. Le saxophoniste a notamment fait partie du RH Factor, la formation entre jazz et funk de Roy Hargrove, le trompettiste récemment disparu. Jacques Schwarz-Bart a enregistré plusieurs albums sous son nom, autant de projets véhiculant son désir de marier à chaque fois sa passion conjuguée pour le gwoka et le jazz. Un homme de fusion, en quelque sorte.
[Carnet de notes buissonnières # 008] Jacques Schwarz-Bart est originaire de la Guadeloupe. Fils d’un couple d’écrivains célèbres, Simone et André Schwarz-Bart, il est connu pour être un musicien accompli qui a découvert très jeune le gwoka et ses rythmes complexes. Comme bon nombre de ses condisciples, il est passé par la Berklee School of Music de Boston avant de croquer la Grosse Pomme où il a rencontré quelques grands noms du jazz. Le saxophoniste a notamment fait partie du RH Factor, la formation entre jazz et funk de Roy Hargrove, le trompettiste récemment disparu. Jacques Schwarz-Bart a enregistré plusieurs albums sous son nom, autant de projets véhiculant son désir de marier à chaque fois sa passion conjuguée pour le gwoka et le jazz. Un homme de fusion, en quelque sorte.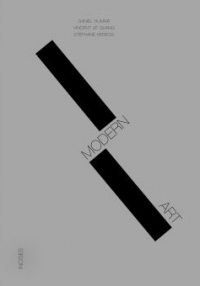 J’ai abandonné depuis longtemps l’idée de palmarès, considérant l’exercice assez vain. Sélectionner une poignée de disques parmi les dizaines reçues dans l’année, non merci, c’est souvent trop injuste pour beaucoup et un poil narcissique. Néanmoins, l’évidence peut parfois vous persuader qu’un disque en particulier, celui que vous tenez entre les mains et dont vous venez de faire la découverte, occupera une place de choix dans votre petit Panthéon. C’est le cas, sans le moindre doute, pour Modern Art, une réussite flagrante signée par un trio de « polyartistes », sur le label Incises.
J’ai abandonné depuis longtemps l’idée de palmarès, considérant l’exercice assez vain. Sélectionner une poignée de disques parmi les dizaines reçues dans l’année, non merci, c’est souvent trop injuste pour beaucoup et un poil narcissique. Néanmoins, l’évidence peut parfois vous persuader qu’un disque en particulier, celui que vous tenez entre les mains et dont vous venez de faire la découverte, occupera une place de choix dans votre petit Panthéon. C’est le cas, sans le moindre doute, pour Modern Art, une réussite flagrante signée par un trio de « polyartistes », sur le label Incises.  C’est étrange tout de même… John Taylor nous a brutalement quittés pendant l’été, s’éclipsant alors qu’il était tout entier en musique, devant son piano. Le 17 juillet dernier en effet, alors qu’il se produisait avec le quartet Nouvelle Vague du contrebassiste Stéphane Kérecki au festival Saveurs Jazz de Segré, un malaise cardiaque l’a terrassé. Il est mort quelques heures plus tard. Ce musicien anglais avait 72 ans. On ressent à distance le choc, le sentiment brutal d’un vide que nul n’aurait pu imaginer quelques instants plus tôt. Et si cette disparition a quelque chose de tragiquement beau (qui ne rêverait pas de partir en plein accomplissement de sa passion, sans avoir le temps d’être gagné par l’idée même de la mort ?), on peut deviner l’état de sidération dans lequel ont dû être plongés celles et ceux qui le côtoyaient en ces moments de joie soudain baignés de larmes.
C’est étrange tout de même… John Taylor nous a brutalement quittés pendant l’été, s’éclipsant alors qu’il était tout entier en musique, devant son piano. Le 17 juillet dernier en effet, alors qu’il se produisait avec le quartet Nouvelle Vague du contrebassiste Stéphane Kérecki au festival Saveurs Jazz de Segré, un malaise cardiaque l’a terrassé. Il est mort quelques heures plus tard. Ce musicien anglais avait 72 ans. On ressent à distance le choc, le sentiment brutal d’un vide que nul n’aurait pu imaginer quelques instants plus tôt. Et si cette disparition a quelque chose de tragiquement beau (qui ne rêverait pas de partir en plein accomplissement de sa passion, sans avoir le temps d’être gagné par l’idée même de la mort ?), on peut deviner l’état de sidération dans lequel ont dû être plongés celles et ceux qui le côtoyaient en ces moments de joie soudain baignés de larmes. Je le disais récemment dans
Je le disais récemment dans  Time will tell, comme disent nos voisins d’outre-Manche. Il paraît en effet que le temps produit ses effets, évacuant par le soupirail des heures qui passent le superflu ou l’insignifiant. Seul resterait ce qui est habité de l’essentiel. Il en va en musique comme en toutes choses et je ne serai pas le dernier à admettre qu’un enthousiasme trop appuyé – celui de l’instant auquel je succombe non sans joie, parce que mon approche de la soixantaine n’est pas encore parvenue à éradiquer chez moi des élans quasi adolescents – peut faire suite à une prise de distance, voire un oubli partiel ou total. Comme si s’opérait en nous une distinction entre un plaisir non intrinsèquement durable (mais plaisir tout de même, ce qui, convenons-en, est loin d’être méprisable et peut même s’avérer indispensable au quotidien) et la nécessité, plus indicible, de se confronter à une énergie d’essence vitale qui soulève chez nous une force allant bien au-delà du poil qui se hérisse durant quelques secondes. Et qu'on ne compte pas sur moi pour établir une liste des disques dont j’ai apprécié la forte séduction qu’ils ont pu opérer le temps de quelques écoutes et qui, les semaines passant, sont venus se glisser quelque part, à l’écart, dans les recoins de ma mémoire où ils sont parfois enfouis pour toujours, avec peu d’espoir de remonter un jour à la surface. Heureusement d’ailleurs ! Mais j’avoue qu’il m'arrive régulièrement de consulter la liste des albums que j’ai écoutés au cours des douze ou dix-huit derniers mois et de me rendre compte que bon nombre d’entre eux ne résonnent plus beaucoup en moi et que, dans le pire des cas, je n’en garde pas le moindre souvenir. Sont-ils dispensables pour autant ? Pas forcément, sauf que la hiérarchie qui s'établit de fait est bien là, plutôt impitoyable. Peut-être aussi que nos capacités à maintenir vives en nous des œuvres puissantes sont limitées et que, par obligation physique, nous nous trouvons confrontés à la nécessité d'une sélection. En d’autres termes, notre mémoire vive n’étant pas extensible à l’infini, elle doit opérer son propre ménage interne pour préserver la qualité de son fonctionnement. Je laisse ce questionnement aux experts... dont je ne suis pas.
Time will tell, comme disent nos voisins d’outre-Manche. Il paraît en effet que le temps produit ses effets, évacuant par le soupirail des heures qui passent le superflu ou l’insignifiant. Seul resterait ce qui est habité de l’essentiel. Il en va en musique comme en toutes choses et je ne serai pas le dernier à admettre qu’un enthousiasme trop appuyé – celui de l’instant auquel je succombe non sans joie, parce que mon approche de la soixantaine n’est pas encore parvenue à éradiquer chez moi des élans quasi adolescents – peut faire suite à une prise de distance, voire un oubli partiel ou total. Comme si s’opérait en nous une distinction entre un plaisir non intrinsèquement durable (mais plaisir tout de même, ce qui, convenons-en, est loin d’être méprisable et peut même s’avérer indispensable au quotidien) et la nécessité, plus indicible, de se confronter à une énergie d’essence vitale qui soulève chez nous une force allant bien au-delà du poil qui se hérisse durant quelques secondes. Et qu'on ne compte pas sur moi pour établir une liste des disques dont j’ai apprécié la forte séduction qu’ils ont pu opérer le temps de quelques écoutes et qui, les semaines passant, sont venus se glisser quelque part, à l’écart, dans les recoins de ma mémoire où ils sont parfois enfouis pour toujours, avec peu d’espoir de remonter un jour à la surface. Heureusement d’ailleurs ! Mais j’avoue qu’il m'arrive régulièrement de consulter la liste des albums que j’ai écoutés au cours des douze ou dix-huit derniers mois et de me rendre compte que bon nombre d’entre eux ne résonnent plus beaucoup en moi et que, dans le pire des cas, je n’en garde pas le moindre souvenir. Sont-ils dispensables pour autant ? Pas forcément, sauf que la hiérarchie qui s'établit de fait est bien là, plutôt impitoyable. Peut-être aussi que nos capacités à maintenir vives en nous des œuvres puissantes sont limitées et que, par obligation physique, nous nous trouvons confrontés à la nécessité d'une sélection. En d’autres termes, notre mémoire vive n’étant pas extensible à l’infini, elle doit opérer son propre ménage interne pour préserver la qualité de son fonctionnement. Je laisse ce questionnement aux experts... dont je ne suis pas.
 Il est parfois des disques qui semblent tombés du ciel… La veille, on ignore encore jusqu'à leur existence et puis, un beau matin, votre boîte aux lettres – ou plutôt l’orifice dans la porte d’entrée qui fait office de boîte aux lettres, au grand dam du facteur qui fulmine régulièrement contre son exigüité et qui vous le fait savoir en glissant un avis de passage notifiant l’échec de sa livraison et sa volonté stupide de réitérer dès le lendemain à la même heure, c’est-à-dire une fois de plus en votre absence, second ratage qui vous conduira au bout du troisième jour au bureau de Poste le plus proche – résonne de la chute d’un paquet inattendu sur le tapis rectangulaire destiné à adoucir la brutalité d’une atterrissage non désiré. Plouf ! Une enveloppe matelassée attend désormais qu’on veuille bien rompre la solitude dans laquelle elle a tout juste eu le temps de se morfondre depuis son échouage. Scritch ! Scratch ! Scrontch !* A quoi il faudrait aussi ajouter un « Aïe ! » douloureux, assorti de quelques grossièretés que ma retenue naturelle m’interdit de reproduire ici, soit autant d’expressions spontanées consécutives à la vilaine et douloureuse coupure que cette saloperie de papier a mesquinement provoqué sur mon doigt fragilisé par une petite onzaine de milliers de comprimés d’anticoagulant absorbés à doses quotidiennes durant plus de 30 ans.
Il est parfois des disques qui semblent tombés du ciel… La veille, on ignore encore jusqu'à leur existence et puis, un beau matin, votre boîte aux lettres – ou plutôt l’orifice dans la porte d’entrée qui fait office de boîte aux lettres, au grand dam du facteur qui fulmine régulièrement contre son exigüité et qui vous le fait savoir en glissant un avis de passage notifiant l’échec de sa livraison et sa volonté stupide de réitérer dès le lendemain à la même heure, c’est-à-dire une fois de plus en votre absence, second ratage qui vous conduira au bout du troisième jour au bureau de Poste le plus proche – résonne de la chute d’un paquet inattendu sur le tapis rectangulaire destiné à adoucir la brutalité d’une atterrissage non désiré. Plouf ! Une enveloppe matelassée attend désormais qu’on veuille bien rompre la solitude dans laquelle elle a tout juste eu le temps de se morfondre depuis son échouage. Scritch ! Scratch ! Scrontch !* A quoi il faudrait aussi ajouter un « Aïe ! » douloureux, assorti de quelques grossièretés que ma retenue naturelle m’interdit de reproduire ici, soit autant d’expressions spontanées consécutives à la vilaine et douloureuse coupure que cette saloperie de papier a mesquinement provoqué sur mon doigt fragilisé par une petite onzaine de milliers de comprimés d’anticoagulant absorbés à doses quotidiennes durant plus de 30 ans.