Pourquoi j’écrirai (peut-être) encore quelques articles…
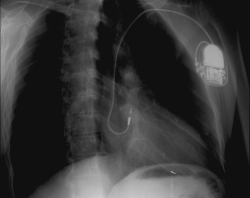 Dans un récent billet de blog intitulé Pourquoi je n’écris plus (beaucoup) d’articles, notre très jeune camarade Raphaëlle T. alias Belette évoque les raisons pour lesquelles elle est aujourd’hui réticente à l’idée d’écrire sur le jazz, qu’il s’agisse de chroniques de disques ou de comptes rendus de concerts. Elle liste non sans à propos un certain nombre de « tics » et d’expressions toutes faites dont usent et abusent les rédacteurs, elle évoque les contraintes qui s’imposent à lui (ou elle) quant à la longueur des textes et leur documentation… Bref, toute une série de raisons pour lesquelles elle éprouve une légitime lassitude face à l’exercice.
Dans un récent billet de blog intitulé Pourquoi je n’écris plus (beaucoup) d’articles, notre très jeune camarade Raphaëlle T. alias Belette évoque les raisons pour lesquelles elle est aujourd’hui réticente à l’idée d’écrire sur le jazz, qu’il s’agisse de chroniques de disques ou de comptes rendus de concerts. Elle liste non sans à propos un certain nombre de « tics » et d’expressions toutes faites dont usent et abusent les rédacteurs, elle évoque les contraintes qui s’imposent à lui (ou elle) quant à la longueur des textes et leur documentation… Bref, toute une série de raisons pour lesquelles elle éprouve une légitime lassitude face à l’exercice.
Je suis d’autant plus sensible à son argumentation qu’il n’est pas une semaine, pour ne pas dire un jour, sans que je me sente assailli par ce genre de questionnement. Rarement satisfait d’un écrit, je sais que je n’échappe pas toujours aux pièges cités dans cette note opportune, je m’arrache les cheveux qui me restent pour imaginer des formulations qui soient un tant soit peu originales, sans forcément y parvenir, je déploie des efforts inconsidérés pour raconter des histoires qui feront, comme le dirait un autre camarade, « péter les formes de la chronique et en faire un exercice de style pour la transformer en sensation ». Parfois ça marche, mais parfois seulement.
Et puis, quand on y songe, à quoi bon ? N’y a-t-il pas mieux à faire en ce bas monde que de s’échiner sur son clavier pour essayer de communiquer à un autre invisible ce petit grain de folie qu’on appelle la passion ? Ne travaillons-nous pas exclusivement à la marge ? Nos élucubrations ne sont-elles pas destinées à un cercle restreint de spécialistes qui n’apprennent pas grand-chose en lisant notre prose, si ce n’est que nous aimons leur musique et prenons plaisir à le faire savoir ? Notre production laborieuse est-elle suivie d’un minimum d’effets qui exercent une influence sur le cours des choses ? Sommes-nous légitimes (surtout moi qui ne suis pas musicien) pour parler de musique ? Pas sûr…
Dans ces moments de doute, je me prends à rêver d’isolement et d’arrêt du temps. Moi qui suis comme beaucoup d’autres un bénévole (ce qui signifie que mes différents travaux d’écriture prennent place en dehors du cadre d’un travail m’occupant environ 38 heures par semaine, donc le soir et le week-end), je suis saisi quotidiennement par un besoin radical : me couper de tous les réseaux une bonne fois pour toutes et prendre enfin le temps de me plonger dans ces innombrables bouquins (mon grand regret sera de n’avoir pas assez lu) que je délaisse depuis des années au profit de vilaines galettes qui défilent en sarabande sur ma chaîne au point que, parfois, elles n’y font qu’un passage éphémère. Retrouver mes vieux disques, ceux dont je sais la présence à mes côtés depuis une éternité mais que peut-être, je n’écouterai plus jamais. Enfiler un bon gros manteau et des chaussures de marche pour me perdre en longues randonnées main dans la main. Allumer un feu dans une grande cheminée et me repaître d'un vide existentiel dans un silence seulement troublé par le crépitement des flammes. Dire et faire plein de bêtises avec mes petites-filles. Bref me transformer en ermite vieux schnock et jouir en cercle restreint de tous les trésors, matériels ou non, accumulés au fil du temps et dont je ne profite pas autant que je le souhaiterais. Me couper du monde extérieur et fermer définitivement les yeux sur ses horreurs. Être enfin égoïste…
Et puis viendront un petit message, un encouragement, un remerciement, un témoignage émouvant, une citation, une proposition, aussi. Non pas pour écrire une chronique, mais pour réfléchir à un texte qui puisse illustrer la pochette d’un disque. Ou pour assurer à intervalles réguliers la programmation et l’animation d’une émission de radio. Ou se lancer à nouveau dans une exposition. Alors au fil des amitiés, on se retrouve gagné par la fièvre, à composer des textes au calibrage impitoyable (parfois dans une grande urgence), à prendre des notes qu’on lira plus ou moins fidèlement au micro, à écrire des portraits, voire une fiction, qui prendront place au cœur d’expositions imaginées avec un complice photographe. L’écriture d’un premier livre suscite des échanges chaleureux qui sont autant de stimulations, au point qu’on en vienne à vouloir récidiver comme si l’histoire de la littérature n’attendait que ça, en imaginant un objet vaguement littéraire un peu bizarre dont les fragments viendront zigzaguer malicieusement parmi une cinquantaine d’instantanés. Et même à établir la liste de tous ces petits livres qu’on a en tête (au moins cinq ou six) et dont on repousse l’écriture à plus tard, quand on aura le temps. Dans ces moments, les doutes s’envolent, on ne pense plus aux avis péremptoires émis sur le bien-fondé et les motivations d’une chronique ou d’impressions post-concert. On avait la tête sous l’eau et la voici qui émerge pour avaler un grand bol d’air avant de replonger.
Que faire ?
Respirer. Si dire que tout cela est un privilège. Penser aussi que si une chose est dite avec le cœur, même maladroitement, alors elle peut être dite. Foin des railleurs et de ceux qui savent. Ne pas trop réfléchir à des stratégies de communication. Ne pas se sentir obligé mais seulement porté par une vague. Faire au mieux, sculpter, faire naître des formes pour donner envie. Essayer d'écrire une histoire, des histoires. Partager. Se bercer d’illusions en pensant que, peut-être, au détour d’une phrase, une personne (et pourquoi pas plusieurs ?) aura éprouvé le besoin d’en savoir un peu plus, de se lancer à la rencontre d’une musique qu’elle n’aurait pas eu la possibilité de connaître sans cet acte écrit. Ou plus simplement que cette personne aura ressenti pendant quelque temps une pointe de bien-être. Être soi-même, sans artifice.
Tout est affaire d’humilité et de modestie : l’exercice de l’écriture a ses défauts et ses limites. Il est bon de les connaître, de ne pas trop se prendre au sérieux, de savoir rester à sa place sans cuistrerie et de ne pas rechigner à remettre l’ouvrage sur le métier autant que faire se peut. C’est une mécanique parfois austère, mais dont les rouages sont huilés par les passions qui nous habitent. Il n’est pas honteux, après tout, d’avoir envie de les transmettre. Avec la plus grande sincérité, quitte, parfois, à prendre le risque d’un enthousiasme pas toujours justifié a posteriori et dont il ne sera pas interdit de se moquer. Surtout, à bientôt 58 ans, je refuse (pour l’instant) de me laisser gagner par une humeur un poil top aigre qui, pour le coup, n’a aucune raison d’être si on la met en balance avec la cruauté ambiante de notre village mondialisé et mis en coupe réglée chaque jour un peu plus par la rapacité ou la folie d’une minorité. Je suis encore trop jeune pour tomber dans cet ultime gouffre. On verra un peu plus tard…
 J'ai reçu depuis quelque temps plusieurs témoignages de confiance et des remerciements assez émouvants qui m'interpellent vraiment. Au début de la semaine, un vieux pote amoureux de musique, travailleur acharné du partage de ses passions, me demandait l'autorisation de reproduire l'une des chroniques de mon blog dans son magazine. Hier, je recevais un message d'un pianiste qui tenait à me faire part du plaisir pris à la lecture d'un de mes textes ; il voulait m'en remercier, un comble alors que de mon point de vue, c'est plutôt moi le débiteur. Au cours de l'hiver, un autre musicien m'a sollicité, un peu dans l'urgence, pour que j'écrive le rédactionnel devant figurer sur la pochette de son nouveau disque. Un exercice de style dont j'ai essayé de m'acquitter au mieux, avec les moyens du bord, ceux de l’écriveur que je suis et dont je dispose tant bien que mal. On m'a aussi demandé si j'acceptais qu'un extrait d'une de mes chroniques figure sur le catalogue de la prochaine saison d'une salle de concert. Je travaille actuellement sur la rédaction du dossier de presse associé à la parution du disque d'un jeune guitariste. Tout récemment enfin, mon complice Jacky Joannès a relevé le défi - c’est moi qui l’ai lancé, je le reconnais - d'une prochaine exposition unissant textes et photographies ; celle-ci, programmée au mois d'octobre 2016, sera principalement consacrée aux saxophonistes et aux clarinettistes et devrait s'appeler « La part des anches ». J'ai même prévu de réaliser le petit livre de l'exposition avant qu'elle ne commence, afin de le proposer lors du vernissage.
J'ai reçu depuis quelque temps plusieurs témoignages de confiance et des remerciements assez émouvants qui m'interpellent vraiment. Au début de la semaine, un vieux pote amoureux de musique, travailleur acharné du partage de ses passions, me demandait l'autorisation de reproduire l'une des chroniques de mon blog dans son magazine. Hier, je recevais un message d'un pianiste qui tenait à me faire part du plaisir pris à la lecture d'un de mes textes ; il voulait m'en remercier, un comble alors que de mon point de vue, c'est plutôt moi le débiteur. Au cours de l'hiver, un autre musicien m'a sollicité, un peu dans l'urgence, pour que j'écrive le rédactionnel devant figurer sur la pochette de son nouveau disque. Un exercice de style dont j'ai essayé de m'acquitter au mieux, avec les moyens du bord, ceux de l’écriveur que je suis et dont je dispose tant bien que mal. On m'a aussi demandé si j'acceptais qu'un extrait d'une de mes chroniques figure sur le catalogue de la prochaine saison d'une salle de concert. Je travaille actuellement sur la rédaction du dossier de presse associé à la parution du disque d'un jeune guitariste. Tout récemment enfin, mon complice Jacky Joannès a relevé le défi - c’est moi qui l’ai lancé, je le reconnais - d'une prochaine exposition unissant textes et photographies ; celle-ci, programmée au mois d'octobre 2016, sera principalement consacrée aux saxophonistes et aux clarinettistes et devrait s'appeler « La part des anches ». J'ai même prévu de réaliser le petit livre de l'exposition avant qu'elle ne commence, afin de le proposer lors du vernissage. J’entendais ce matin une courte rubrique de France Inter appelée la Playlist dont le slogan est « On aime, on en parle ». En l’écoutant, j’ai pensé au chemin que j’essaie d’emprunter ici ou dans le cadre de mes chroniques pour Citizen Jazz. Il s’agit bien en effet de trouver les mots les plus appropriés pour donner envie à nos lecteurs de découvrir des disques qu’on aime et d’aller encourager les musiciens sur scène.
J’entendais ce matin une courte rubrique de France Inter appelée la Playlist dont le slogan est « On aime, on en parle ». En l’écoutant, j’ai pensé au chemin que j’essaie d’emprunter ici ou dans le cadre de mes chroniques pour Citizen Jazz. Il s’agit bien en effet de trouver les mots les plus appropriés pour donner envie à nos lecteurs de découvrir des disques qu’on aime et d’aller encourager les musiciens sur scène. Pour une fois, il ne sera pas ici question de musique... Encore que l’atelier d’écriture auquel j’ai eu la chance de participer du mois de janvier jusqu’à samedi dernier (six séances de quatre heures) résonne dans ma tête d’une vraie musique des mots : pas seulement les miens, mais aussi ceux de mes camarades qui, tous, ont accepté de plancher sur les exercices proposés par l’attentif et bienveillant
Pour une fois, il ne sera pas ici question de musique... Encore que l’atelier d’écriture auquel j’ai eu la chance de participer du mois de janvier jusqu’à samedi dernier (six séances de quatre heures) résonne dans ma tête d’une vraie musique des mots : pas seulement les miens, mais aussi ceux de mes camarades qui, tous, ont accepté de plancher sur les exercices proposés par l’attentif et bienveillant 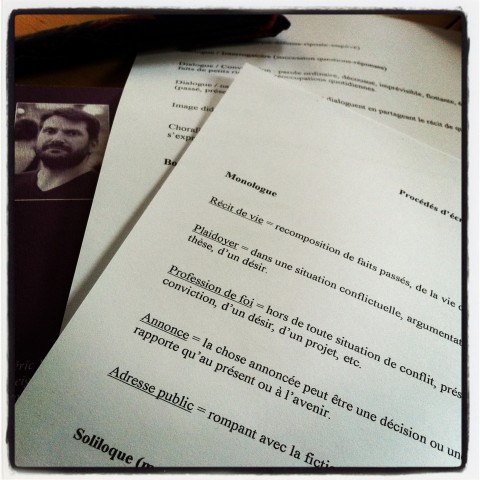
 J’ignore encore si je tirerai le moindre profit de l’atelier d’écriture auquel je viens de m’inscrire auprès du Théâtre de la Manufacture à Nancy. Six séances de quatre heures sous la coordination d’un animateur qui va s’efforcer d'extirper de son groupe (une petite quinzaine d’adultes consentants) quelques fruits tombés de l'arbre d’une imagination pas toujours débridée, tout en proposant à ses victimes de réfléchir à la construction de personnages et de dialogues.
J’ignore encore si je tirerai le moindre profit de l’atelier d’écriture auquel je viens de m’inscrire auprès du Théâtre de la Manufacture à Nancy. Six séances de quatre heures sous la coordination d’un animateur qui va s’efforcer d'extirper de son groupe (une petite quinzaine d’adultes consentants) quelques fruits tombés de l'arbre d’une imagination pas toujours débridée, tout en proposant à ses victimes de réfléchir à la construction de personnages et de dialogues.
 Oui, je sais. Pas une note depuis trois semaines. Je réinvente peut-être la jachère, après tout. Un peu de silence pour qu'ensuite, les phrases repoussent mieux. Mais le monde a d'autres soucis que la régularité de publication du côté de chez mes notes, n'est-ce pas ?
Oui, je sais. Pas une note depuis trois semaines. Je réinvente peut-être la jachère, après tout. Un peu de silence pour qu'ensuite, les phrases repoussent mieux. Mais le monde a d'autres soucis que la régularité de publication du côté de chez mes notes, n'est-ce pas ?