Divorce à la Danoise
 Hasse Poulsen a divorcé. Et alors, me demanderez-vous, en quoi cela nous regarde-t-il ? Je pourrais vous donner raison, parce qu’en effet la vie privée des gens ne nous concerne pas. Mais un avis si tranché risquerait de vous priver d’un bonheur musical que je vais évoquer ici en quelques lignes. Non sans vous proposer au préalable un rapide rappel « historique ».
Hasse Poulsen a divorcé. Et alors, me demanderez-vous, en quoi cela nous regarde-t-il ? Je pourrais vous donner raison, parce qu’en effet la vie privée des gens ne nous concerne pas. Mais un avis si tranché risquerait de vous priver d’un bonheur musical que je vais évoquer ici en quelques lignes. Non sans vous proposer au préalable un rapide rappel « historique ».
2003, Metz, Les Trinitaires : j’assiste à un concert du clarinettiste Louis Sclavis venu interpréter son répertoire Napoli’s Walls inspiré des fresques murales d’Ernest Pignon-Ernest dans la ville de Naples. Médéric Collignon est là, tout en cornet, yeux exorbités et scats survoltés. Vincent Courtois, plus discret fait entendre le chant de son violoncelle. Je découvre un guitariste dissonant et abrasif, de haute stature : Hasse Poulsen. Depuis cette époque lointaine, ce géant danois a su imposer son talent, en particulier au sein du trio Das Kapital, sans doute l’une des plus belles inventions du jazz de la décennie passée. Il est aussi un explorateur, en duo (avec Tom Rainey, Fabien Duscombs, Hélène Labarrière…), en quartet avec The Langston Project pour dire les textes de Langston Hugues ou dans le cadre d’une formation aux accents volontiers psychédéliques telle que SighFire. Tout récemment, sa guitare électrique est venue griffer le jazz gourmand et pétulant de Frizione, disque du saxophoniste Romano Pratesi entouré d’un véritable all stars (incluant Glenn Ferris, Stephan Oliva, Claude Tchamitchian, Christophe Marguet).
Ce ne sont là que quelques exemples pour vous donner une idée de son activité polymorphe et rageusement créative. Mais attention : Hasse Poulsen – vous allez enfin savoir pourquoi je vous raconte toutes ces choses – est aussi un excellent interprète, dont les « chansons » avaient frappé juste à l’occasion de la parution il y a cinq ans de The Man They Cass Ass… Sings Until Everything Is Sold. J’en avais rédigé la chronique pour Citizen Jazz. J’y écrivais notamment : « Un songwriter de premier plan doublé d’un magnifique chanteur vient de voir le jour et s’expose enfin après de longues années de maturation ». Vous commencez à comprendre : lorsqu’un chroniqueur de haut niveau vit les heures difficiles de la séparation après vingt ans de vie commune, on devine que ce qu’il a à dire dépassera très largement le cadre de l’intimité d’un couple volant en éclats. Fin du rappel.
Le temps est donc venu pour l’homme qu’on appelle Ass de partager Not Married Anymore, dont le titre parle de lui-même. Quinze compositions enregistrées en quatre jours au fin fond du Danemark, avec la complicité des compatriotes Henrik S. Simonsen et de Tim Lutte, sans oublier le rôle important joué par Gilles Olivesi pour le travail sur le son. Ici, pas de fioritures, c’est un enregistrement urgent, presque brut, qui est proposé, avec ce côté roots qui colle parfaitement à la nudité du propos. Les violons et les flonflons n’ont pas leur place ici. Voix + guitare + contrebasse + batterie et basta. Pas question d’une super production. Pas de solos non plus, ce n’est pas le moment d’en rajouter. Avec cet album très personnel, Poulsen dévoile un répertoire dont les premières compositions remontent à 2014 et parlent d’amour, de rupture, de regrets, d’espoir, en lien direct ou indirect avec son histoire. Autant de sentiments qui sont les siens, bien sûr, mais aussi ceux qui peuvent traverser chacun·e d’entre nous. Ce qu’Hasse Poulsen confirme : « Quand le privé ressemble à un regard involontaire dans une chambre, ça devient insupportable et embarrassant. J’espère que les chansons de Not Married Anymore ne donnent pas une telle impression de partage de détails banals et sans importance d’une vie sans intérêt. J’espère parler des émotions – souvent contradictoires – qu’on rencontre dans beaucoup de moments de vie ». Rassurons-le, cette exposition aux oreilles de tou·te·s n’est jamais dérangeante au prétexte qu’elle ferait de nous des voyeurs. Ces histoires d’amour, qu’elles finissent mal ou pas, sont universelles. Et ici fort justement racontées.
L’album mêle ballades aux accents folk, country, bluegrass ou jazz, avec çà et là une pointe de rock à l’état brut et quelques tentations psychédéliques. Hasse Poulsen rend à sa manière un hommage appuyé à ceux qui habitent son Panthéon musical depuis toujours ou presque : Johnny Cash, Bob Dylan, Paul Simon, Elvis Costello ou Tom Waits. On pourrait ajouter Leonard Cohen. Cette sédimentation heureuse – dans un contexte qui ne l’est pas – fait de Not Married Anymore un disque qu’on ne cherchera pas à classer. Il est celui, je me répète, d’un songwriter au sens le plus noble et le plus intemporel du terme. Avec pas mal de titres qu’on serait tenté de fredonner (au premier rang desquels « Not Married Anymore »), si l’on ne craignait de paraître incongru en les chantonnant…
Pour terminer cette note, j’aimerais partager un souvenir : l’année dernière, j’avais réuni à Paris quelques amis musiciens que je voulais associer à un événement personnel. Hasse Poulsen était de ceux-là. Il est arrivé, immense sur son vélo de course, sourire timide aux lèvres, simple comme bonjour. J’ignorais tout des moments pénibles qu’il traversait à cette époque. Il n’en a rien laissé paraître, alors que nous levions tous notre verre à une histoire qui, elle, était heureuse. Presque dix-huit mois plus tard, je mesure toute l’élégance de l’homme, au-delà de son immense talent de musicien. Je suis donc bien placé pour vous dire que Not Married Anymore est un écho supplémentaire de cette classe naturelle qui transpire de chacun de ses mots, de chacune de ses notes.
Musiciens : Hasse Poulsen (chant, guitares), Henrik S. Simonsen (contrebasse), Tim Lutte (batterie), Gilles Olivesi (effets).
Titres : Not Married Anymore / Drink to my Health / Ask Yourself / A Single Day / At the End of a Rope / What Kind of a World / Thanks for the Fight / This is the Day / Hollow Old Bone / I Need a New Girl / In a Dead Man’s Skull / What’s On Your Mind / Ship Full of Ghosts / Thousand Voices / Only Sometimes
Label : Das Kapital Records
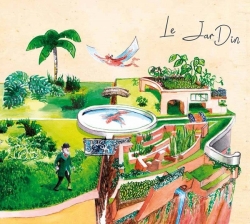 Quand on a – sans préméditation aucune – reçu un éveil musical passant, après les années d’enfance chantonnée, par le rock puis son évolution progressive (qu’on devrait plutôt qualifier de prospective, pour reprendre la suggestion d’Aymeric Leroy). Quand on a ensuite découvert le jazz-rock anglais (l’École de Canterbury par exemple) puis le jazz-rock américain (Miles Davis, Mahavishnu Orchestra), soit une belle ouverture vers le jazz, cet univers dans lequel je suis entré à pas de loup par la musique de John Coltrane, il y a de fortes chances pour qu’un disque revendiquant des influences multiples attire mon attention. La production discographique est abondante : aussi une sélection, instinctive ou intuitive, s’opère naturellement au cœur de toute la musique à écouter, avec pour conséquence la mise en avant de certains albums (pendant que d’autres sont mis de côté, malheureusement).
Quand on a – sans préméditation aucune – reçu un éveil musical passant, après les années d’enfance chantonnée, par le rock puis son évolution progressive (qu’on devrait plutôt qualifier de prospective, pour reprendre la suggestion d’Aymeric Leroy). Quand on a ensuite découvert le jazz-rock anglais (l’École de Canterbury par exemple) puis le jazz-rock américain (Miles Davis, Mahavishnu Orchestra), soit une belle ouverture vers le jazz, cet univers dans lequel je suis entré à pas de loup par la musique de John Coltrane, il y a de fortes chances pour qu’un disque revendiquant des influences multiples attire mon attention. La production discographique est abondante : aussi une sélection, instinctive ou intuitive, s’opère naturellement au cœur de toute la musique à écouter, avec pour conséquence la mise en avant de certains albums (pendant que d’autres sont mis de côté, malheureusement). Ce qui fait le charme de ce qu’on appelle parfois « la musique de jazz » - je reprends ici une formulation chère à Henri Texier – c’est peut-être sa versatilité. Derrière ce mot, se cache selon moi l’idée d’une musique changeante, capable de satisfaire des appétits d’une grande diversité et de répondre aux variations d’humeur. Elle peut être plus ou moins imprégnée de fantaisie, rester au plus près de la mélodie ou s’en écarter au profit d’une quête plus atonale et exploratoire, quand elle n'est pas bruitiste. Elle est toujours atmosphérique. Elle peut vous rassurer ou au contraire vous mener sur des chemins incertains. Elle chuchote au creux de l’oreille ou crie sa révolte. À chaque moment – une saison, un jour, une heure, une fraction de seconde – correspond un état particulier du jazz. Mais quelle qu’en soit la tonalité, cette musique est l’expression d’un cœur qui bat. Une pulsation.
Ce qui fait le charme de ce qu’on appelle parfois « la musique de jazz » - je reprends ici une formulation chère à Henri Texier – c’est peut-être sa versatilité. Derrière ce mot, se cache selon moi l’idée d’une musique changeante, capable de satisfaire des appétits d’une grande diversité et de répondre aux variations d’humeur. Elle peut être plus ou moins imprégnée de fantaisie, rester au plus près de la mélodie ou s’en écarter au profit d’une quête plus atonale et exploratoire, quand elle n'est pas bruitiste. Elle est toujours atmosphérique. Elle peut vous rassurer ou au contraire vous mener sur des chemins incertains. Elle chuchote au creux de l’oreille ou crie sa révolte. À chaque moment – une saison, un jour, une heure, une fraction de seconde – correspond un état particulier du jazz. Mais quelle qu’en soit la tonalité, cette musique est l’expression d’un cœur qui bat. Une pulsation.